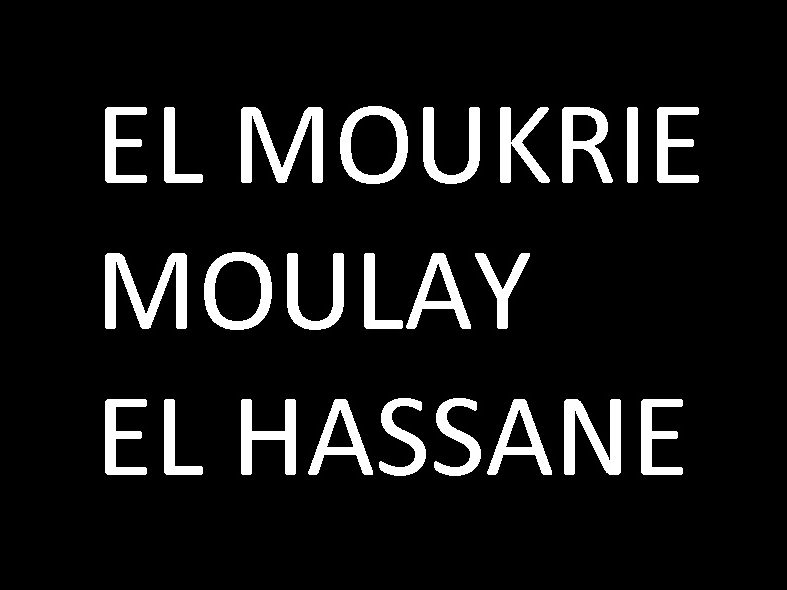Avec la publication de ce livre, la Société américaine de chimie rend hommage au génie chimique à l’occasion de ce qui peut être considéré, faute d’une date précise, comme le centenaire approximatif de son émergence en tant que profession distincte.
Le thème central du livre est l’identification historique et le développement du génie chimique en tant que profession à part entière, distincte non seulement de toutes les autres formes d’ingénierie, mais particulièrement de toutes les formes de chimie, y compris la chimie appliquée et la chimie industrielle.
Les vingt-deux chapitres du volume représentent largement l’industrie et l’éducation, et proviennent des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne, du Japon, de l’Italie et de l’Inde. Le premier chapitre, rédigé par F. J. Van Antwerpen, secrétaire et directeur exécutif émérite de l’American Institute of Chemical Engineers, était le document de référence du symposium sur lequel le livre est basé. Plusieurs chapitres se concentrent sur l’émergence précoce du génie chimique en tant que discipline distincte de la chimie, tandis que d’autres traitent de développements plus récents où le génie chimique a occupé une place particulièrement importante, comme dans le cas de l’énergie nucléaire. D’autres chapitres offrent des aperçus anecdotiques et biographiques de figures clés de l’histoire de la profession, et l’un d’eux aborde les problèmes d’identité professionnelle. Le dernier chapitre, rédigé par D. F. Othmer, examine des aspects importants de l’avenir du génie chimique.
Il a été mentionné précédemment l’absence de toute date généralement acceptée pour marquer l’émergence du génie chimique en tant que profession distincte. La raison en est que le génie chimique a deux racines principales qui se sont développées selon des calendriers différents. Une racine était principalement chimique et d’origine principalement européenne, tandis que l’autre était principalement physique et d’origine principalement nord-américaine. La première racine est caractérisée par l’approche de la chimie industrielle, qui a atteint son développement principal au milieu du XIXe siècle et dans laquelle les chimistes et les ingénieurs mécaniciens ont collaboré pour fabriquer des produits chimiques à grande échelle. La seconde est caractérisée par l’approche des opérations unitaires, qui a connu son développement majeur aux États-Unis au début du XXe siècle et où le M.I.T. a joué un rôle prééminent.
Un point très important est que les deux concepts ont fusionné dès le début aux États-Unis, mais n’ont commencé à converger que relativement récemment en Europe. La signification majeure de ce facteur sur l’histoire et le développement global de la profession est démontrée dans plusieurs chapitres.
Dans l’introduction de son célèbre manuel (J), George E. Davis mentionne que « La première reconnaissance publique de l’ingénieur chimiste semble avoir été faite en 1880, année où une tentative a été faite pour fonder une ‘Société des ingénieurs chimistes’ à Londres. » La tentative initiale a échoué, mais elle fournit une date aussi valable que toute autre pour établir le point d’origine du génie chimique en tant que profession distincte. Cependant, même les revendications britanniques d’origine sont contestables. Ivan Levinstein, écrivant dans le Journal de la Société chimique industrielle en 1886, a déclaré : « Nous ne possédons pas ce que l’on pourrait appeler des ingénieurs chimistes, ou du moins ils sont très peu nombreux » (2). Ε. K. Muspratt, écrivant dans le même numéro, a déclaré : « Il est très difficile de trouver un gestionnaire qui ait une connaissance de l’ingénierie combinée à une connaissance de la chimie. Ces hommes doivent être éduqués, et c’est seulement maintenant, après que les Allemands et les Français ont montré la voie pendant quarante ans, que nous commençons à suivre cette voie » (3).
Le génie chimique est la quatrième forme d’ingénierie la plus universellement populaire, après le génie civil, électrique et mécanique. Ceux-ci sont connus sous le nom de « big four » de l’ingénierie, et il n’y a ni cinquième de manière cohérente ni proche. Le génie chimique, à l’avant-garde de l’avancement scientifique non seulement dans les applications des sciences chimiques, mais aussi dans un éventail beaucoup plus large de domaines connexes, doit veiller à ne pas perdre l’élan du premier siècle de son développement face à ce qui pourrait être une perte émergente de son identité professionnelle.
Parmi les nombreuses œuvres antérieures sur les aspects de l’histoire du génie chimique, l’historien sérieux devrait être conscient des livres (4-7), articles (8-10) et manuscrits (11-13) cités ci-dessous.
Enfin, je tiens à remercier ma femme Pamela et mes filles Lesley, Jane et Pamela pour leurs nombreuses gentillesses pendant la préparation de ce travail. Je tiens également à remercier le Petroleum Research Fund de l’American Chemical Society de m’avoir honoré en me décernant une bourse d’opportunités éducatives spéciales pour organiser et diriger le symposium international de l’ACS sur lequel est basé ce livre.
Literature Cited
- Davis, G. E. « A Handbook of Chemical Engineering, » 2nd ed.; Davis
Bros. Ltd.: Manchester, England, 1904; Vols. 1 and 2. - Levinstein, I. J. Soc. Chem. Ind., London 1886, 5, 353.
- Muspratt, Ε. K. J. Soc. Chem. Ind., London 1886, 5, 414.
- Van Antwerpen, F. J.; Foudrinier, S. « Highlights, the First Fifty Years of
the American Institute of Chemical Engineers: » A.I.Ch.E.: New York,
1958. - Dixon, W. T.; Fisher, A. W., Jr. « Chemical Engineering in Industry; »
A.I.Ch.E.: New York, 1958. - Piret, E . L. « Chemical Engineering Around the World; » A.I.Ch.E.: New
York, 1958. - Miall, S. « A History of the British Chemical Industry; » Ernest Benn Ltd.:
London, England, 1931. - Hougen, O. A. « Seven Decades of Chemical Engineering, » Chem. Eng.
Prog. 1977, 73(1), 89. - Pigford, R. L. « Chemical Technology: The Past 100 Years, » Chem. Eng.
News 1976, 54(15), 190. - Dodge, B. F.; Guthrie, H. D.; Van Antwerpen, F. J. « The Origin and
Development of Chemical Engineering in the United States, » presented
at the 4th Interamerican Congress of Chemical Engineering, Buenos
Aires, Argentina, Apr. 1969. - Trescott, M. M. « Unit Operations in the Chemical Industry: An American
Innovation in Modern Chemical Engineering, » Univ. of Illinois: Urbana,
IL, 1979. - Guédon, J.-C. « Chemical Engineering by Design: The Emergence of Unit
Operations in the United States, » Institut d’histoire et de sociopolitique
des sciences, Univ. de Montréal, Quebec, Canada, 1979. - Stephenson, R. M. « A Selective Historical Bibliography of Chemical Engi
neering, » Univ. of Connecticut: Storrs, CN, 1979.
Royal Military College of Canada WILLIAM F . FURTER
Kingston, Ontario K7L 2W3
August 21, 1979
Les origines du génie chimique F. J. VAN ANTWERPEN 16 Sun Road, West Millington, NJ 07946
Le génie chimique, né et nourri aux États-Unis et reconnu comme une branche distincte de l’ingénierie, a parcouru un long chemin de développement. Cet article sur ses origines trace la naissance de la discipline, en se préoccupant particulièrement de pourquoi et comment elle a évolué aux États-Unis et non en Europe, où tous les éléments techniques existaient également. L’article traite principalement de l’émergence du concept de génie chimique, et l’auteur décrit seulement de manière générale les périodes ultérieures de croissance et de changement ; aucune tentative n’est faite pour retracer les origines conceptuelles des périodes ultérieures.
Toute discussion sur l’histoire d’une discipline dynamique telle que le génie chimique doit retracer des concepts. Et c’est là une tâche difficile. La chronique des processus chimiques et de leurs variations et changements, ou de l’équipement chimique avec ses innombrables conceptions nouvelles, est beaucoup plus facile, sauf lorsque nous essayons d’isoler et d’inspecter le pourquoi et le qui.
En traçant les origines des idées, les insights éclairants ne sont généralement pas simples à reconstruire. On ne peut pas, comme les anthropologues, espérer trouver l’origine unique de l’homme, ou décider comme l’ont fait les ornithologues que le reptile est le précurseur de l’oiseau, ou, pour cette question, avoir le choix entre même deux débuts, à l’instar des physiciens qui sont maintenant incertains si tout a été commencé par Dieu ou un big bang, et ne se sentent pas vraiment à l’aise à l’idée qu’ils pourraient être l’un.
Le génie chimique, à un moment donné (où que vous choisissiez de placer ce moment), et le génie chimique actuel ont eu de nombreuses, nombreuses origines, et le génie chimique du futur se retracera à des concepts que nous ne prévoyons pas maintenant. Ainsi, une première mise en garde : cette discussion sur les origines du génie chimique n’est pas une tentative de faire plus que quelques commentaires historiques sur quelques éléments qui ont conduit au génie chimique moderne. Deuxième mise en garde : je n’essaierai pas de décrire notre histoire en termes de processus ou d’équipements.
Nous devrions faire quelques distinctions ; bien que le génie chimique soit une profession, il est à tout moment une collection de faits, d’hypothèses et d’art de conception. La collection change continuellement, tout comme nos esprits changent, et tout comme nos impressions de fait et de vérité changent, le génie chimique change. Certes, les processus chimiques et les industries chimiques sont des domaines dans lesquels le génie chimique est utilisé, mais ils ne sont pas le génie chimique en soi. L’équipement de processus, bien qu’étant soumis à l’attention méticuleuse des ingénieurs chimistes, n’est pas le génie chimique. Cela peut sembler évident et redondant, mais bien qu’il soit plus facile de pointer du doigt un processus ou un évaporateur qui a bénéficié du génie chimique, voire qui doit son existence en tant qu’entité économique au génie chimique, on ne peut pas les considérer comme autre chose que les artefacts de notre artifice.
Considérez la facilité relative de retracer l’évolution des choses mécaniques. J’ai utilisé cette illustration lors d’une conférence (J) que j’ai donnée pour célébrer le 85e anniversaire d’Olaf Hougen.
« Si l’on demande généralement comment Bell a inventé le téléphone, la plupart des individus supposeraient que son origine complète était dans son esprit, et que tout ce dont on avait besoin était un accident fortuit avec de l’acide et un appel à l’aide à M. Watson. Bell avait de bons exemples pour l’inspirer ; le télégraphe était bien établi ; le télégraphe multiple, un système permettant d’envoyer plusieurs messages télégraphiques simultanément sur un seul fil, avec des tonalités d’interruption de différentes fréquences, avait été pensé ; un dispositif, appelé capsule manométrique, dans lequel la voix actionnait une membrane pour produire des distorsions de flamme, existait ; et un autre dispositif, via une membrane activée par la voix, traçait (à travers un stylet) des motifs vocaux sur une plaque de verre traitée avec du noir de fomp* (1).
Ainsi, nous connaissons les éléments mécaniques préalables du téléphone. Le point que j’essaie de faire est qu’il est beaucoup plus facile de retracer l’histoire d’un objet fini que de suivre des concepts. Nous avons d’innombrables horloges et précurseurs ; mais qui a pensé à mesurer le temps en premier ? Montrez-moi un monument en son honneur. Seul à travers l’autobiographie saurons-nous jamais qui a été inspiré à faire quoi avec quelle idée.
Un autre exemple. Pendant la guerre, une réalisation majeure utilisant le génie chimique a été l’usine chimique qui a été utilisée pour séparer le plutonium fabriqué dans la pile de Hanford.
DuPont a accepté de concevoir et de construire l’usine de séparation même avant d’être certain qu’une pile pouvait être construite qui deviendrait critique et si elle produirait du plutonium. La conception était bien avancée avant que le plutonium ne soit produit en quantité. Le problème dans l’usine de séparation, qui n’avait jamais été rencontré auparavant, était la manipulation à distance du plutonium, le traitement à distance, le contrôle à distance, et, très important, la réparation à distance. Un concept illustratif et intrigant de cette expérience chimique suit.
Les grues à distance, suspendues, blindées, pouvaient utiliser des clés à chocs délicatement équilibrées pour déconnecter l’équipement radioactif et le remonter pour l’enterrer. Mais comment garantir que le remplacement s’ajusterait exactement en place ? Les ingénieurs concepteurs ont emprunté un concept à la radio et conçu un équipement avec des broches inférieures, tout comme sur les tubes radio, qui s’ajustaient précisément dans des fentes désignées. Peut-être que cela semble mineur (mais ce n’était pas le cas), mais cela sert à illustrer mon propos sur le concept ; seulement à travers l’autobiographie il est possible de retracer les concepts et comment ils sont utilisés et réutilisés. Si Kekulé n’avait pas parlé de son rêve à propos de serpents, nous ne serions pas seulement plus pauvres par manque d’une charmante intuition, mais nous nous demanderions encore comment il a jamais compris la structure du benzène.
Qui a eu l’idée d’un ingénieur chimiste en premier ? Nous ne le savons pas. J’ai mentionné dans mon histoire des 50 premières années de l’American Institute of Chemical Engineers (2), que le terme ingénieur chimiste est apparu en 1839 dans un Dictionnaire des arts, manufactures et mines, et qu’en 1879, les mots étaient également utilisés sur un dessin publié. Ainsi, l’idée d’un ingénieur associé aux processus chimiques existait très tôt, en fait seulement vingt et un ans après la formation en Angleterre de la première société d’ingénierie, l’Institute of Civil Engineers, fondée en 1818 avec des efforts d’organisation remontant à 1771. Quelques autres dates pour mettre tout en perspective :
- 1608 : Premiers produits chimiques exportés du Nouveau Monde
- 1747 : Fondation de la première école de génie civil par les Français
- 1818 : Première société d’ingénierie, le génie civil, en Grande-Bretagne
- 1836 : Tentatives pour organiser des ingénieurs civils aux États-Unis
- 1843 : Formation d’une société nationale d’ingénierie en Hollande
- 1847 : Formation d’une société nationale d’ingénierie en Belgique et en Allemagne
- 1848 : Formation d’une société nationale d’ingénierie en France
- 1848 : Formation de la Boston Civil Engineering Society (BSCE) (a duré jusqu’à la fusion avec l’ASCE en 1974)
- 1852 : Première société nationale d’ingénierie, l’American Society of Civil Engineers (ASCE), formée aux États-Unis.
Le terme « ingénieur » n’était pas nouveau : notre armée révolutionnaire avait des officiers et un corps du génie ; en Angleterre, John Smeaton se signait « ingénieur civil » en 1782.
Dans son excellent article (3) sur l’évolution des opérations unitaires, W.K. Lewis souligne que « Les industries chimiques modernes ont commencé avec le procédé Le Blanc en France pendant la Révolution française » et que « l’expansion de l’industrie chimique au XIXe siècle a été extraordinaire. De plus, bon nombre de ses développements étaient d’exceptionnelles réalisations d’ingénierie. Les hommes qui ont réalisé ces résultats se considéraient comme des chimistes… plutôt que des ingénieurs » (3). De plus, comme le souligne l’article de Lewis et d’autres également, en 1881, une tentative sérieuse a été faite en Angleterre par George E. Davis pour créer une société d’ingénieurs chimistes.
De plus, Lewis, qui, avec Walker et McAdams, peut être considéré comme l’un des premiers et des plus connus défenseurs du concept d’opération unitaire, affirme que « Hausbrand (un Allemand qui a publié un livre sur la rectification et la distillation en 1893) est sans conteste le père du traitement moderne du génie chimique des opérations unitaires, dans lequel les problèmes sont résolus en appliquant les principes fondamentaux de la science physique au cas spécifique. Il a été le premier ingénieur de conception de procédés au monde. Notez que Lewis n’a pas dit que Hausbrand était le père des opérations unitaires, mais du « traitement moderne du génie chimique des opérations unitaires » (3). Le terme « opérations unitaires » a été inventé par Arthur D. Little en 1915.
Mais pour revenir au développement du génie chimique… c’est un mystère pourquoi il n’a pas été adopté et encouragé en Europe. Certainement, le concept a été énoncé ; Davis en Angleterre a non seulement tenté de fonder une société, mais il a peut-être effectué la première analyse enregistrée du génie chimique. Il l’a fait d’abord dans une série de conférences sur le génie chimique en 1887 à la Manchester Technical School, puis dans son Handbook of Chemical Engineering publié en 1901-1902, et cela a dû bien se vendre car une deuxième édition a été publiée en 1904.
L’élément conceptuel, l’aperçu intellectuel, était présent en Angleterre, en France et en Allemagne. Pourquoi l’échec à capitaliser ? En réponse à une question de l’auteur, E.W. Thiele, au moment où il présentait deux volumes sur la distillation et la rectification pour la Library of Historical Chemical Engineering volumes collectés par l’American Institute of Chemical Engineers, a déclaré que les volumes étaient la source de données pour lui et W.L. McCabe au moment où ils ont développé la construction étape par étape bien connue pour déterminer le nombre de plateaux idéaux nécessaires pour établir une différence de concentration dans une colonne. Les deux volumes qui sont parus en français étaient tous deux d’Ernest Sorel ; l’un portait sur la distillation et l’autre sur la rectification de l’alcool. Sorel, soit dit en passant, se présente comme un ancien ingénieur de fabrication de l’État (Ancien de mfg de l’État). Pourquoi alors les États-Unis ?
Alexis de Tocqueville, dans ses deux volumes sur la démocratie en Amérique, un enregistrement d’observations et d’opinions faites lors d’un séjour de neuf mois aux États-Unis en 1831, avait quelque chose à dire sur le caractère des Américains et leur force technique (3) :
« L’esprit des Américains est hostile aux idées générales ; il ne cherche pas les découvertes théoriques… l’observation s’applique aux arts mécaniques. En Amérique, les inventions de l’Europe sont adaptées avec sagacité ; elles sont perfectionnées et adaptées avec une habileté admirable aux besoins du pays. Les fabricants existent, mais la science de la fabrication n’est pas cultivée ; et ils ont de bons ouvriers, mais très peu d’inventions » (4). Il développe ce thème dans le Volume II, dans la section intitulée « L’exemple de l’Américain ne prouve pas qu’un peuple démocratique n’ait aucune aptitude et aucun goût pour la science, la littérature ou l’art » (4) et commence ainsi : « Il faut reconnaître que dans peu des nations civilisées de notre époque, les hautes sciences ont fait moins de progrès qu’aux États-Unis. » Cela semble pire que cela ne l’est, car de Tocqueville l’attribue à une religion austère, à un pays neuf et abondant, à l’esprit du gain, etc., etc. Cependant, il nous attribue quelque chose. « En Amérique, la partie purement pratique de la science est admirablement comprise, et une attention particulière est portée à la partie théorique qui est immédiatement nécessaire à l’application. Sur ce point, l’Américain fait toujours preuve d’une pensée claire, libre, originale et inventive. Mais presque personne aux États-Unis ne se consacre aux parties essentiellement théoriques et abstraites de la connaissance humaine. « Rien n’est plus nécessaire à la culture de la science supérieure… que la méditation… et rien n’est moins adapté à la méditation que la structure de la société démocratique… chacun est en mouvement… certains à la recherche du pouvoir et d’autres à la recherche du gain » (5). Peut-être que j’ai insisté trop longtemps sur de Tocqueville – je dois admettre ma fascination – mais l’analyse en 1831 correspond toujours aux conditions pendant le développement du génie chimique 50 à 60 ans plus tard. Le premier cours de génie chimique a été offert au M.I.T. lorsque le professeur de chimie industrielle, Lewis Mill Norton, a fondé le désormais célèbre Cours X – Génie Chimique. C’était en 1888, un an après la conférence de Davis à Manchester. Bien qu’il ait la prééminence, le M.I.T. n’a pas revendiqué l’invention. Le président de l’institution, dans son rapport de décembre 1888, révélait déjà que 11 membres de la deuxième année « ont déjà suivi le cours » (6) (le M.I.T. avait une première année commune pour les étudiants en ingénierie), puis il entreprenait d’expliquer de quoi il s’agissait.
« Le génie chimique a été peu connu dans ce pays ou en Angleterre, et peut-être pas du tout, sous ce nom ; bien que sa profession soit reconnue en France et en Allemagne. Le génie chimique n’est pas principalement un chimiste, mais un ingénieur mécanique. Cependant, c’est un ingénieur mécanique qui a accordé une attention particulière aux problèmes de la fabrication chimique. Il existe un grand nombre d’industries qui nécessitent des constructions, pour des opérations chimiques spécifiques, qui peuvent être construites de la meilleure façon, ou ne peuvent être construites que par des ingénieurs ayant une connaissance des processus chimiques impliqués. Cette catégorie d’industries ne cesse d’augmenter, tant en nombre qu’en importance. Jusqu’à présent, les constructions requises ont, en général, été conçues, et les travaux sur elles ont été supervisés et menés, soit par des chimistes, ayant une connaissance insuffisante des principes de l’ingénierie et peu familiers de l’ingénierie, voire de la pratique de la construction ; soit par des ingénieurs dont les conceptions étaient certainement soit plus laborieuses et coûteuses que nécessaire, soit moins efficaces que souhaitable, car ils ne comprenaient pas pleinement les objectifs visés, n’ayant aucune familiarité, ou peu de familiarité, avec les conditions chimiques dans lesquelles les processus de fabrication concernés devaient être réalisés. C’était pour répondre à cette demande d’ingénieurs ayant une bonne connaissance de la chimie générale et appliquée que le cours de génie chimique a été créé.
« L’enseignement à donner, tout en suivant principalement la voie de l’ingénierie mécanique, comprend une étude approfondie de la chimie industrielle, avec des travaux pratiques en laboratoire. Des recherches spéciales sur les combustibles et le tirage, en référence à la combustion, seront une caractéristique du cours. Le plan d’études n’a pas encore été entièrement défini ; mais un comité permanent de la Faculté, composé des professeurs principalement concernés, portera son attention, tout au long de l’année, sur le développement ultérieur de ce département, qui, on le croit, ajoutera beaucoup à la force et à l’utilité de l’école » (6).
On se demande si la profession était vraiment reconnue en France et en Allemagne, ou si ces mots servent de justification à encore un autre cours dans le programme ? La brindille était définitivement orientée vers le génie mécanique, car dans le catalogue du M.I.T. pour 1888-1889, la description du Cours X était la suivante : « Cette formation est conçue pour répondre aux besoins des étudiants qui désirent une formation générale en génie mécanique et consacrer une partie de leur temps à l’étude de l’application de la chimie aux arts, en particulier à ces problèmes d’ingénierie liés à l’utilisation et à la fabrication de produits chimiques » (7).
Et plus tard… « Les études d’ingénierie générale dans le cours de génie chimique coïncident pour la plupart avec le travail des étudiants en génie mécanique » (7).
Un examen du programme le confirme. Les cours comprenaient la Construction des Engrenages, le Mécanisme des Machines de Moulin, et la Cinématique des Pistons, etc. La chimie était analytique: Éléments de chimie organique (Perkin n’avait que 32 ans), Chimie industrielle—Cours et Laboratoire, Chimie appliquée, Thermochimie, et Chimie appliquée comprenant une thèse. Appelé génie chimique à l’époque, il est reconnaissable aujourd’hui comme chimie industrielle et peut-être (notez le peut-être) était une combinaison des techniques européennes d’un chimiste travaillant avec un ingénieur mécanique dans la conception d’une usine. Le peut-être est en hommage aux conclusions de W. K. Lewis (8) en 1958 selon lesquelles : « Davis, [dans les] Conférences de Manchester trente ans avant la création du terme, a présenté le concept essentiel des opérations unitaires, et en particulier une compréhension de sa valeur pour les éducateurs ; que Davis doit être crédité de l’initiation de la profession moderne du génie chimique ; que le programme de Norton différenciait entre la chimie d’une industrie qui est toujours spécifique à cette industrie d’une part, et les opérations mécaniques et physiques communes à de nombreuses industries d’autre part » (8). De plus, Lewis conclut que sur la base de la description d’un cours de quatrième année dans le catalogue du M.I.T. : « ‘Chimie appliquée… (qui traitait) des matériaux, des méthodes de transport, de l’évaporation et de la distillation, etc., etc., consacrée à une discussion des appareils utilisés dans la fabrication et de la chimie appliquée considérée du point de vue de l’ingénierie… c’était le premier cours sur les opérations unitaires jamais intégré dans un programme organisé de génie chimique » (8). On doit respecter l’opinion et la conjecture de W. K. Lewis car lui, Walker, and McAdams ont été les premiers à exposer les opérations unitaires – ce concept qui a donné la première accélération distinctive du génie chimique par rapport à la chimie industrielle. Mes raisons de douter des conclusions catégoriques de Lewis reposent sur l’opinion d’autres personnes de la même époque.
« A. H. White : « Au printemps 1919, lorsque le Colonel William H. Walker et moi étions encore en uniforme militaire, il m’a dit qu’il allait partir en juin avec W. K. Lewis et W. H. McAdams dans son chalet du Maine et écrire un manuel sur le génie chimique » (9).
C. M. A. Stine en 1928 : « Le chimiste ingénieur est un produit relativement récent de notre développement industriel ; il y a une vingtaine d’années, on en parlait à peine. Lorsque l’American Institute of Chemical Engineers a été créé, la conception du génie chimique était plutôt floue. Ce qui était réalisé était en fait le fait que ceux qui étaient engagés dans des opérations industrielles devaient compléter les résultats du chercheur purement chimique afin d’adapter ces résultats à l’usage du fabricant… »
« Les caractéristiques qui différencient le plus le chimiste ingénieur d’aujourd’hui (1928) des activités antérieures de ceux qui s’intéressaient au domaine sont probablement le traitement quantitatif de ces différentes opérations unitaires, et c’est ce traitement exact et quantitatif de ces opérations qui constitue le domaine du génie chimique moderne » (10).
A. D. Little en 1928, après avoir décrit le cours X et son association initiale avec une « formation générale en génie mécanique » (11) : « Même à cette époque et pendant de nombreuses années après, il y avait peu de distinction entre la chimie industrielle et le génie chimique. Le chimiste ingénieur était encore un ingénieur mécanicien qui avait acquis quelques connaissances en chimie » (11).
Ainsi, je dois conclure qu’une association de Davis et Norton, entre autres, avec les opérations, plus tard incluse dans le concept d’opération unitaire, ne signifiait pas qu’ils les avaient découvertes. Ces opérations n’étaient pas nouvelles même au temps de Hausbrand, Sorel, Norton et Davis, et c’est l’éloquence verbale d’A. D. Little qui a délimité le pays où nos premiers pionniers trouveraient la pépite.
Pour mémoire, la toute première personne — la toute première — à pouvoir se dire ingénieur chimiste en vertu d’un diplôme était William Page Bryant, qui, après avoir obtenu son diplôme du MIT en 1891, est rapidement entré dans le secteur de l’assurance et a passé la majeure partie de sa vie en tant qu’auditeur pour le Boston Board of Fire Underwriters. Apparemment, c’était un individu exceptionnel avec une mémoire prodigieuse, et ses camarades de classe l’ont loué dans l’annuaire en ces termes : « W. P. Bryant, le géant intellectuel, peut répéter mot pour mot presque tout ce qu’il a jamais entendu » (12).
D’autres universités aux États-Unis ont rapidement suivi le MIT dans ce domaine. Le deuxième programme de génie chimique a été proposé à l’Université du Michigan en 1898. Les premiers départements de génie chimique ont été créés à l’Université de Pennsylvanie en 1892, à l’Université Tulane en 1894, à l’Université du Wisconsin en 1898 et à l’Armour Institute of Technology en 1900, où, selon White, « le premier travail de laboratoire en génie chimique a été offert ici en 1908, avec des études dirigées sur des opérations unitaires telles que l’évaporation, la cristallisation, la filtration et le séchage » (13).
En spéculant davantage sur la raison pour laquelle le génie chimique s’est développé comme il l’a fait aux États-Unis, les remarques de C.M.A. Stine — finalement vice-président de DuPont et président de l’AIChE — donnent-elles une meilleure indication que de Tocqueville ? Probablement.
« La formation de l’AIChE a certainement aidé. C’était la seule société de ce type au monde et elle a donné une focalisation aux ingénieurs chimistes et à leurs publications » (14).
Elle a obtenu le soutien des grands pionniers tels que Little, White, Walker, John Olsen et McCormack Meade (rédacteur en chef de la publication The Chemical Engineer) qui méritaient apparemment des éloges particuliers, comme celui donné par John C. Olsen, premier secrétaire de l’AIChE, lorsqu’il écrivait : « l’origine de toute institution humaine ou société mène invariablement à une personnalité exceptionnelle dont l’initiative et le travail ont été responsables de sa croissance précoce et de son développement. Dans le cas de l’AIChE, il s’agissait de Richard K. Meade » (11).
On soupçonne également que les arguments contre la formation d’une société d’ingénieurs chimistes, exprimés par le président de l’ACS de l’époque, Marston T. Bogert, et son insistance pour dire que les ingénieurs chimistes et les chimistes industriels étaient les mêmes, ont donné à la société à naître un objectif : prouver que nous sommes différents. Bogert, il convient de le souligner (je le connaissais : c’était un gentleman courtois et attentionné avec une sincère préoccupation pour la chimie dans toutes ses manifestations), a essayé d’assurer aux fondateurs de l’AIChE qu’il n’opposait en aucune manière la formation d’une société d’ingénieurs chimistes.
La formation de l’AIChE, avec son engagement naissant envers l’avenir, a organisé de manière cohérente les protagonistes dévoués de la profession dans une quête d’abord d’identité, puis de systèmes et d’applications qui confirmaient cette identité et leur revendication d’unicité.
Et ces nouveaux hommes, insistant sur la spécificité de leur appel — qu’ils n’étaient pas des chimistes industriels, mais plutôt des ingénieurs — ont trouvé leur chemin, lentement mais sûrement. Et l’industrie en a profité.
Une prémisse fondamentale liée au développement d’une discipline d’ingénierie est qu’elle est requise par une industrie établie. On suppose généralement que les industries des procédés chimiques aux États-Unis ont été développées après la Première Guerre mondiale. Jusque-là, l’Allemagne est créditée d’être la puissance chimique prééminente. Ce n’est pas le cas. De nombreuses avancées que nous considérons comme modernes étaient fermement établies dès 1908, l’année de la fondation de l’AIChE.
En cette année-là, les États-Unis ont lancé la première chloruration à grande échelle de l’eau ; William H. Walker a reçu la médaille Nichols pour son travail en génie chimique. Les dix premières années du XXe siècle ont vu d’autres développements remarquables dans l’industrie chimique. J.B.F. Herreshoff a développé le premier procédé américain de contact pour l’acide sulfurique en 1900 ; la société Semet-Solvay a produit du benzène, du toluène et du naphta solvant pur à partir du gaz de cokerie ; David Wesson, l’un des fondateurs de l’AIChE, a décoloré l’huile de coton à l’aspirateur ; A.J. Rossi a commencé la fabrication électrolytique du ferrotitane à Niagara Falls. L’année suivante, le premier geyser de pétrole a été découvert ; la société Monsanto a été créée pour fabriquer de la saccharine ; Diamond Alkali a été organisée ; et les débuts de l’industrie de la soie artificielle, ou du rayon, étaient en cours. Un an plus tard, la Hooker Electrochemical Company a démarré et J.V.N. Dorr a inventé le classificateur mécanique en 1904.
Ces développements fondamentaux devaient plus tard devenir d’énormes industries. Les accélérateurs de caoutchouc ont été découverts par George Oenslager de Goodrich en 1906 et le processus de cyanamide pour la fixation de l’azote a été développé en 1905. La même année, le plastique phénolformaldéhyde a été développé par L.H. Baekeland, qui est devenu plus tard président de l’AIChE. L’année précédant la fondation de l’AIChE, le processus de fabrication du cyanamide de calcium a commencé à Niagara Falls ; E.L. Oliver a produit le premier filtre à vide continu ; et la première papeterie de kraft en Amérique du Nord a fonctionné à Québec. Toute cette activité témoignait de l’établissement d’une énorme industrie chimique ; en fait, la production chimique en dollars et en tonnes en Amérique en 1910 était supérieure à celle de l’Angleterre et de l’Allemagne combinées, et c’est dans ce contexte que les ingénieurs chimistes sont entrés en scène.
Mais bien qu’il y ait eu une industrie chimique inorganique florissante, les États-Unis d’Amérique avaient peu de choses dans le domaine organique. La Première Guerre mondiale a révélé de manière dramatique notre dépendance à l’égard de l’Allemagne pour les colorants, les intermédiaires de colorants, les produits pharmaceutiques et de nombreux autres produits chimiques organiques, qui étaient largement coupés par un blocus naval. Nous dépendions également de sources étrangères pour les approvisionnements en azote et en potasse pour les engrais. Il n’y avait pas d’ammoniac synthétique. Notre azote fixe venait du nitrate chilien ; une petite quantité d’azote atmosphérique était combinée à de l’oxygène par le processus à arc désormais obsolète, et la fixation de l’azote par le processus de la cyanamide était pratiquée à petite échelle. Même si les États-Unis avaient une grande industrie chimique d’ici 1917, il n’y avait toujours pas de synthèses haute pression pour la fabrication de méthanol et d’ammoniac, pas de caoutchouc synthétique, et pas d’essence haute octane. (En fait, le nombre d’octane n’avait pas encore été conçu.) Le craquage thermique des hydrocarbures venait de commencer ; il n’y avait pas encore de fibres synthétiques, pas encore de détergents synthétiques, et peu de plastiques organiques.
« Le génie chimique en tant que science, distinguée du nombre total de sujets compris dans les cours portant ce nom, n’est pas un composé de chimie et de génie mécanique et civil, mais une science en soi, dont la base est constituée par ces opérations unitaires qui, dans leur séquence et coordination appropriées, constituent un processus chimique tel qu’il est mené à l’échelle industrielle. Ces opérations, telles que le broyage, l’extraction, la torréfaction, la cristallisation, la distillation, le séchage à l’air, la séparation, et ainsi de suite, ne relèvent pas de la chimie en tant que telle ni du génie mécanique. Leur traitement de manière quantitative, avec une exposition appropriée des lois les régissant ainsi que des matériaux et équipements qui y sont liés, relève du domaine du génie chimique. C’est cet accent sélectif sur les opérations unitaires elles-mêmes dans leurs aspects quantitatifs qui différencie le génie chimique de la chimie industrielle, qui concerne principalement les processus et produits généraux » (16).
En 1922, les ingénieurs chimistes enterrent encore le fantôme d’un prédécesseur obsédant. Un autre extrait significatif du document de W. K. Lewis, cité précédemment, porte sur le développement historique du génie chimique depuis : « . . . 1910 où il n’y avait que 869 étudiants en génie chimique sur un total de 23 241 de toutes sortes. La Première Guerre mondiale a précipité une demande énorme de diplômés, reflétée dans un recensement de 5 743 étudiants en génie chimique en 1920, un chiffre qui a atteint un pic abrupt de 7 054 en 1921-22. Cette expansion du nombre d’étudiants résultait largement de l’établissement de programmes dans des écoles partout dans le pays. Les politiques de ces écoles étaient modelées par les idéaux éducatifs de Walker et Little » (17).
Le développement du génie chimique était le produit de plusieurs forces différentes : le besoin d’une industrie en talent d’ingénierie spécialisé ; la croissance des programmes à travers une définition de ce qu’il fallait enseigner ; et une organisation professionnelle formée pour promulguer, faire connaître et maintenir des normes, plus bien sûr l’observation de de Tocqueville sur les préférences de développement des Américains alors qu’ils s’efforçaient de fonder un complexe industriel.
Les périodes suivantes de développement dans l’éducation du génie chimique étaient les suivantes :
- 1925-1935 : Les opérations unitaires étaient toujours le thème dominant, mais on mettait davantage l’accent sur les bilans matière et énergie.
- 1935-1945 : La thermodynamique appliquée et le contrôle des processus ont acquis de l’importance, mais le développement n’implique pas nécessairement moins d’accent sur les opérations unitaires.
- 1945-1955 : La cinétique chimique appliquée et la conception des processus ont pris de l’importance. Les opérations unitaires ont perdu leur caractère distinctif car elles ont été consolidées dans d’autres concepts.
- 1955— : Une emphase de plus en plus grande est mise sur la science de l’ingénierie. Plutôt que de mettre l’accent sur les opérations unitaires, la tendance actuelle est de se concentrer sur les sciences de l’ingénierie de base ; par exemple, au lieu des opérations unitaires telles que l’écoulement des fluides, le transfert de chaleur, la distillation, l’absorption, le séchage, etc., on utilise le transfert de masse et d’énergie.
En regardant en arrière sur les années au cours desquelles tous ces changements ont eu lieu, on se rend compte avec un pincement au cœur que ces développements étaient le résultat des idées des ingénieurs chimistes s’appuyant sur les réalisations d’autres ingénieurs chimistes, et que, dans l’ensemble, leurs contributions ont été surtout consignées dans des images techniques et les qualités humaines de ces enseignants, ingénieurs et chercheurs sont préservées comme des impressions, soigneusement conservées, uniquement dans l’esprit des étudiants et des collaborateurs. Nous avons surtout besoin d’organiser davantage de programmes dédiés à ceux qui seront considérés en l’an 2000 comme des anciens dignes de louange.
J’ai réalisé une histoire partielle sur Olaf Hougen, qui, avec Watson, a provoqué l’éloignement progressif des opérations unitaires en tant que thème dominant du génie chimique vers l’exploration ingénierique large et sophistiquée qu’elle est aujourd’hui. Quelle meilleure façon de conclure cette histoire incomplète et inadéquate des origines que de répéter les paroles du professeur Hougen à la fin de sa magnifique conférence du bicentenaire sur l’histoire du génie chimique intitulée « Sept décennies d’histoire du génie chimique » et publiée en janvier 1977 par C E P, « pour exhorter chaque département de génie chimique à rédiger son propre historique – à conserver par l’American Institute of Chemical Engineers. »
Nous avons déjà environ 20 de ces histoires consignées ; il en reste environ 110 à rédiger.
Mais allons plus loin et invitons chaque entreprise à faire de même, car une grande partie de l’histoire et du progrès de notre profession a été faite lorsque la théorie a rencontré une pratique pratique et difficile. Nous devrions être autorisés à savoir quoi, qui, et surtout pourquoi.
Literature Cited
- Van Antwerpen, F. J. « Hougen, Olaf Andreas, His Impact on Chemical
Engineering: A Retrospective, » to be published. - Van Antwerpen, F. J.; Fourdrinier, Sylvia « Highlights of the First Fifty Years
of the American Institute of Chemical Engineers; » AIChE: New York, 1958. - Lewis, W. K. AIChE Symp. Ser. 1959, 55 (26), 1,3.
- de Tocqueville, Alexis « Democracy in America; » (Reeve, Bowen, Bradley
translation,) Vintage Books, Random House: New York, Vol. 1, p. 326. - Ibid., Vol. 2, pp. 36, 43.
- « Report of the President (ΜIT) for the Academic Year 1887-1888. »
- « MIT Catalogue, 1888-1889. »
- Lewis, W. K. « MIT Catalogue, 1888-1889, » pp. 3, 5.
- Van Antwerpen, F. J.; Fourdrinier, Sylvia « MIT Catalogue, 1888-1889, » p.56.
- Stine, C. M. A. « Chemical Engineering in Modern Industry, » AIChE Trans.
1928, 5. - Little, A. D. « Twenty-five Years of Chemical Engineering Progress; » AIChE:
New York, 1933. - Ferguson, J. Scott, personal communication
- White, A. H. « Twenty-five Years of Chemical Engineering Progress; » AIChE:
New York, 1933. - Olsen, J. C. AIChE Trans. 1932, 28, 299.
- Hougen, O. The Chemical Engineer 1965, 191.
- « Report of the Committee of Chemical Engineering Education of the
American Institute of Chemical Engineers » 1922. - Lewis, W. K. « Report of the Committee of Chemical Engineering Education
of the American Institute of Chemical Engineers, » 1972, p. 5.
RECEIVED May 7, 1979.
Génie chimique : Comment a-t-il commencé et évolué ? JOHN T. DAVIESI Département de génie chimique, Université de Birmingham, Birmingham B15 211, Angleterre. Le génie chimique a évolué à partir d’un mélange d’artisanat, de mysticisme, de théories erronées et de conjectures empiriques. Les métiers de la fabrication de savon et de la distillation ont pénétré en Europe du Nord en provenance de la Méditerranée aux XIIe-XIVe siècles. Cependant, les améliorations étaient très lentes jusqu’à la Révolution scientifique des XVIIe et XVIIIe siècles. Ce n’est qu’à ce moment-là que les interprétations mystiques ont été remplacées par des théories scientifiques : bien que les premières théories soient souvent erronées, elles ont néanmoins joué un rôle prépondérant dans la stimulation de la réflexion. Sont inclus ici des détails sur le génie des procédés chimiques développé entre 1740 et 1913, en particulier la production d’alcalis, la carbonisation du charbon, la fabrication de l’acide sulfurique, les engrais agricoles et la distillation. L’origine de l’approche par opérations unitaires est également discutée. La chimie appliquée a, à travers les âges, été intéressante et utile à l’homme. La teinture, la distillation, le raffinage des métaux et la fabrication du vin, du verre, du savon et du ciment sont pratiqués depuis longtemps dans des unités de petite échelle. Le génie chimique est la technique de mise à l’échelle de telles opérations et processus, certaines des installations à grande échelle fonctionnant de manière continue et avec un contrôle automatique. Ainsi, le génie chimique vise à réduire les coûts par des méthodes de production de masse, par l’optimisation et la réduction des coûts de main-d’œuvre. Il est également préoccupé par le contrôle qualité grâce à une instrumentation améliorée liée aux systèmes de contrôle automatique. Comment tout cela a-t-il commencé ? Comment les découvertes fortuites, les formules magiques, la superstition et la religion ont-elles donné naissance (i) à la révolution scientifique et (ii) à la possibilité de mettre à l’échelle les processus chimiques et de les contrôler de près ? De la Grèce antique à la Révolution scientifique du XVIIe siècle, les Grecs anciens étaient préoccupés par les formes et les formes. Ils aimaient également l’enquête, la raison et la connaissance pour elles-mêmes.
Dans leur philosophie, l’intérêt intellectuel d’une théorie comptait bien plus que le profit ou l’utilité ; une vision d’ensemble était plus importante qu’une analyse en composants séparés. Par exemple, Épicure (qui a prospéré vers 300 av. J.-C.) valorisait les théories uniquement pour fournir des explications naturalistes des phénomènes que la superstition attribuait à l’agence des dieux. S’il existait plusieurs explications naturalistes possibles, Épicure considérait qu’il était inutile de choisir entre elles.
Ainsi, les théories, bien que nombreuses dans le monde antique, étaient peu testées : le manque d’instruments offrait peu d’opportunités, mais il y avait encore moins d’intérêt. Les théories n’étaient généralement pas liées aux métiers connus : Aristote (384-322 av. J.-C.) mentionnait que l’eau pure pouvait être obtenue en évaporant l’eau de mer, mais ne fournissait aucune théorie à ce sujet. Pline (au Ier siècle ap. J.-C.) décrivait une méthode primitive de condensation dans laquelle l’huile obtenue par chauffage de la colophane était recueillie sur de la laine placée dans la partie supérieure de l’appareil. Des alambics typiques des Ier et IVe siècles sont présentés dans les Figures 1 et 2 ; des alambics simples sont également décrits dans les textes arabes des VIIe et VIIIe siècles ap. J.-C.
À partir du VIIe siècle ap. J.-C., le « feu grec » était utilisé dans la guerre, en particulier pour incendier les navires ennemis. Il a contribué de manière significative aux victoires navales byzantines de cette époque. Beaucoup de spéculations ont été faites sur la nature du « feu grec ». Une étude récente (3) conclut que le lance-flammes utilisait du pétrole brut chaud, ou peut-être un distillat de celui-ci. Le liquide était propulsé (par de l’air pompé dans le réservoir d’alimentation chauffé) à travers une buse et émergeait comme un jet turbulent qui était allumé. Tout le processus pourrait être décrit comme un génie chimique précoce.
Au Ier siècle ap. J.-C., Pline enregistra l’utilisation empirique de l’huile pour calmer une mer agitée, et Plutarque mentionna également cette pratique. Une partie de ces connaissances empiriques a peut-être traversé directement la prétendue « Période sombre » de l’Europe, bien que l’interprétation des effets soit alors devenue plutôt mystique. Par exemple, Bède, dans sa célèbre histoire de 731 ap. J.-C., mentionne qu’au VIIe siècle, une huile sacrée était utilisée pour apaiser les mers par temps houleux.
À cette époque, le calme de la mer était attribué à la sainteté de l’huile plutôt qu’à ses propriétés physiques. Cependant, l’huile sacrée était principalement de l’huile d’olive, qui est maintenant connue pour bien se répandre et être très efficace pour apaiser une mer agitée. Il semble donc que la connaissance des propriétés apaisantes des huiles n’ait peut-être pas été complètement perdue pendant les « Périodes sombres » de l’Europe.
Mais en Europe, l’autorité religieuse et personnelle régnait en maître sur les métiers et les compétences pratiqués au Moyen Âge (voir Figure 3). Environ 2 000 ans se sont écoulés depuis les discussions des anciens Grecs avant que l’inédite confluence de changements culturels, religieux et technologiques ne produise un environnement dans lequel des tests approfondis de théories par des expériences systématiques et des observations soient devenus une pratique acceptée, de sorte que les théories trop vagues (ou trop mystiques) ou trop compliquées pour être testées ne sont plus prises au sérieux.
Les premières manifestations de cette perspective moderne peuvent être vaguement retracées aux XIIe et XIIIe siècles. C’est à cette époque que les idées d’Aristote sur la dignité et la confiance en soi de l’homme ont commencé à être ravivées : les philosophies du droit, du gouvernement et de l’univers physique ont commencé à être examinées. Pierre Abélard, le philosophe catholique français du début du XIIe siècle, était optimiste quant au pouvoir de la raison humaine d’atteindre la connaissance du naturel et du surnaturel. Il soutenait que c’est en doutant que nous parvenons à questionner, et en questionnant que nous percevons la vérité. Il croyait au pouvoir du raisonnement – selon lui, le scepticisme sain était un tremplin vers la compréhension. Son attitude interrogatrice s’étendait même aux apôtres et aux saints Pères, qu’il pensait susceptibles de commettre des erreurs : seules les Écritures, disait-il, étaient infaillibles.
Également vers le milieu du XIIe siècle, la production d’alcool, par distillation de substances fermentées, fut découverte à Salerne. L’influence des alchimistes arabes était forte dans le sud de l’Italie (voir Figure 4), et bon nombre de leurs écrits étaient traduits en latin. Au XIIIe siècle, le métier de fabrication de savon (décrit dans la Bible et par Pline au Ier siècle ap. J.-C.) avait atteint l’Angleterre. Au XIVe siècle, la distillation du vin pour produire de l’alcool devint une industrie mineure, et des boissons alcoolisées fortes étaient prescrites pour divers maux. En même temps, l’utilisation de boissons fortes sucrées à base d’alcool (liqueurs) fut introduite dans le nord de l’Europe depuis l’Italie (4).
Au XVe siècle, la Renaissance était à son apogée, balayant l’Italie puis faisant sentir son impact au nord des Alpes. La Renaissance comprenait un intérêt enthousiaste pour la carte du monde redécouverte et la géographie de Ptolémée, ainsi que pour les traditions mathématiques de Platon et Pythagore, dont le célèbre théorème impliquait une déduction raisonnée à partir d’axiomes postulés. La puissance intellectuelle de l’homme était redécouverte, mais dans un nouveau contexte, celui du christianisme. Cette religion impliquait une croyance en un Seigneur régent, conduisant directement à la conviction qu’il existait des lois régissantes. Également au XVe siècle, la technologie et les compétences artisanales étaient améliorées ; par exemple, la distillation du vin et de la bière pour obtenir de l’alcool devenait plus populaire, et un tube de refroidissement sur l’alambic sous la forme d’une bobine ou d’un serpent était introduit.
Cependant, même à travers le XVIe siècle, les progrès scientifiques réels restaient plutôt limités et une grande partie de la tradition classique était préservée. Léonard de Vinci, dans son dessin de 1509 représentant les tourbillons et les bulles dans l’eau turbulente (voir Figure 5), se préoccupait encore des formes plutôt que de tester une théorie. Cependant, certaines théories étaient en discussion. Copernic remettait en question la théorie acceptée du mouvement planétaire et proposait que le soleil, et non la Terre, soit le centre du système planétaire.
La technologie et l’artisanat (comme la distillation, voir Figures 6 et 7) continuaient également de progresser au cours du XVIe siècle. La fabrication du verre se développait pour répondre à la demande croissante de vitres, de bouteilles et de vaisselle. En alchimie, Paracelse mentionnait les différentes « opérations » utilisées, dont la calcination, la sublimation, la dissolution, la putréfaction, la distillation, la coagulation et la coloration : « Celui qui montera et franchira ces sept étapes viendra à un endroit si merveilleux qu’il verra et expérimentera de nombreuses choses secrètes dans la transmutation de toutes les choses naturelles » (6). Cette idée, liée aux opérations de laboratoire, était peut-être la première intimation du concept d' »opérations unitaires ». La fabrication du sel était axée sur la coagulation des impuretés dans la saumure, l’évaporation et la cristallisation. Le traitement du sucre impliquait le pressage, l’évaporation et la cristallisation (voir Figure 8).
Au début du XVIIe siècle, les horloges et les instruments optiques capables de tester les théories scientifiques étaient encore améliorés. En même temps, les idées et les conflits de la Réforme se propageaient et prenaient racine. Cette répudiation de l’autorité humaine et la liberté pour les individus de s’adonner à des discussions critiques sur les idées les uns des autres étaient peut-être liées à la structure plutôt instable de la société européenne. Cette instabilité était sans aucun doute accentuée par les vagues fréquentes d’épidémies qui balayaient l’Europe (la Grande Peste de Londres [1664-1665] n’était pas un phénomène isolé). Dans ces circonstances de bouleversements sociaux drastiques, l’intelligence et l’alphabétisation croissante avaient une plus grande ampleur qu’auparavant (9). Quelles que soient les causes de la Réforme, cependant, l’attitude consistant à remettre en question l’autorité établie était essentielle avant qu’une science expérimentale critique puisse prospérer.
La Révolution scientifique du XVIIe siècle (associée à des noms tels que Kepler, Gilbert, Galilée, Torricelli, Pascal et Newton) était donc le résultat de la convergence de trois facteurs (9) :
- L’enthousiasme de la Renaissance (et le contexte chrétien de celle-ci).
- Les idées antiautoritaires de la Réforme.
- Les techniques optiques, horlogères et métallurgiques améliorées.
En particulier, l’utilisation d’instruments plus précis tels que les horloges, les télescopes, les thermomètres et les microscopes composés a permis de tester les théories scientifiques de manière beaucoup plus précise et étendue qu’auparavant. C’est ainsi que s’est originée la floraison de l’activité scientifique qui a eu lieu au XVIIe siècle ; la technologie et les nouvelles théories ont commencé (et continuent) à progresser main dans la main, renforçant mutuellement l’une et l’autre. Galilée a commencé ses expériences sur la période d’oscillation des pendules en 1581, ce qui a conduit à l’invention de l’horloge à pendule d’une précision nettement améliorée.
Au cours des premières décennies du XVIIe siècle, le philosophe anglais Francis Bacon évoquait l’importance de l’expérimentation et de l’observation. Selon lui, la connaissance était utile pour donner à l’homme la souveraineté sur la nature. Il prônait un échange vif de points de vue intellectuels et considérait que la critique destructive était particulièrement importante. Il soulignait également l’importance des généralisations et d’une approche fondamentale, les théories testées devant être appliquées également dans de nouvelles circonstances. Pour de tels tests, affirmait-il, certaines observations sont particulièrement précieuses car elles permettent de choisir entre deux théories rivales. « Nous devons mettre la nature sur le gril pour la contraindre à répondre à nos questions » (10).
Les théories étaient désormais devenues publiques plutôt que privées ; elles étaient diffusées plus largement grâce à l’invention relativement récente de l’imprimerie. La confiance dans la nouvelle méthode scientifique augmentait rapidement : bon nombre des nouvelles théories (par exemple, les théories de Newton de 1666-1687) étaient confirmées par des expériences. En particulier, les nouvelles expériences et observations montraient de manière décisive que les théories contemporaines étaient supérieures à celles des anciens – la physique d’Aristote (selon laquelle les corps se déplacent uniquement s’ils sont poussés) était incorrecte, et les cartes de Ptolémée avaient clairement été erronées.
Avec cette nouvelle confiance en soi en Europe, l’activité scientifique progressait ; alors qu’avant le XVIIe siècle, la science expérimentale de base n’était pas rentable ni sur le plan intellectuel ni financier, soudainement les nouvelles théories, avec leur élégance, leurs tests précis avec les nouveaux instruments, et leur utilité en navigation et pour faire la guerre, rendaient la science très importante. Les théories qui faisaient des prédictions précises et résistaient à des tests répétés étaient clairement les meilleures théories dans cette société. La Révolution scientifique avait eu lieu ; l’approche scientifique était établie comme une philosophie.
Les contraintes distinctives de cette philosophie sont les quatre critères (9) :
- Le scientifique utilise des mots et des symboles de manière relativement explicite et formelle, contrairement aux mots vagues et émotifs utilisés en poésie et en religion (amour, grâce, rédemption, etc.).
- Il a une forte appréciation esthétique de l’élégance des théories générales fondamentalement simples (bien qu’elles soient peut-être abstraites et mathématiques).
- Il formule des prédictions précises et réalise des tests expérimentaux précis pour vérifier si le
Je m’excuse pour la coupure dans la traduction. Voici la suite et la fin de la traduction du texte :
Les contraintes distinctives de cette philosophie sont les quatre critères (9) :
- Le scientifique utilise des mots et des symboles de manière relativement explicite et formelle, contrairement aux mots vagues et émotifs utilisés en poésie et en religion (amour, grâce, rédemption, etc.).
- Il a une forte appréciation esthétique de l’élégance des théories générales fondamentalement simples (bien qu’elles soient peut-être abstraites et mathématiques).
- Il formule des prédictions précises et réalise des tests expérimentaux précis pour vérifier si les théories fonctionnent avec précision sur des plages de plus en plus larges (c’est-à-dire qu’une théorie scientifique est potentiellement falsifiable).
- Il est prêt, face à la critique et à la réfutation, à échanger ou à modifier sa théorie en faveur d’une meilleure.
Chine et Arabie On peut se demander pourquoi il n’y a pas eu de développement spectaculaire comparable de la science dans l’ancienne Chine ou en Arabie entre les IXe et XIIe siècles. Pourquoi n’y a-t-il eu qu’une révolution scientifique ? La coïncidence triple qui a initié la révolution a été discutée ci-dessus. Il n’y a jamais eu de situation comparable en Chine, où la religion confucéenne (avec son grand respect pour les archives de l’antiquité, un intérêt dominant pour les problèmes sociaux et moraux, que la maxime « les prudents ne se trompent jamais »), la langue écrite inflexible (un nouveau symbole est nécessaire pour chaque nouveau concept) et le manque d’esprit compétitif (contrairement à celui entre les différents États européens) ont tous conspiré contre toute activité scientifique suffisante pour faire une percée.
De plus, les anciens Chinois recrutaient leurs meilleurs érudits pour le service de l’État, les éloignant ainsi des affaires pratiques de la vie. Un tel système préservait efficacement le statu quo. Le résultat a été que les exploits technologiques (comme les murs et canaux étendus et les rendements élevés des cultures grâce au compostage) ont été réalisés sans théories abstraites : la technique était celle d’un million d’hommes, chacun avec une petite cuillère. Il n’y avait jamais un grand intérêt pour les forces inanimées, et l’initiative locale n’était pas encouragée (les systèmes d’irrigation étaient contrôlés par les autorités centrales). Ainsi, malgré la compétence, la ténacité et les épidémies fréquentes de peste en Chine, le climat intellectuel est resté assez différent de celui de l’Europe post-Renaissance.
En Arabie, la science était la plus forte entre les IXe et XIIe siècles. La tradition était continue depuis la fin de l’Antiquité, basée sur la science et les métiers grecs. Il n’y a pas eu de redécouverte excitante soudaine comme en Europe à la Renaissance. Bien qu’il y ait eu des réalisations considérables en mathématiques et en astronomie, les métiers et les attitudes intellectuelles changeaient très lentement ; en fait, les alchimistes pratiquaient encore leur art dans la ville ancienne de Fès (Maroc) jusqu’en environ 1956. Même aujourd’hui, certaines des alambics utilisés là-bas pour distiller des parfums sont d’une forme datant des premiers siècles après J.-C., lorsque les Arabes ont amélioré l’appareil de distillation en le refroidissant (avec de l’eau) le tube partant de la tête de l’alambic. Ils ont découvert un certain nombre d’huiles essentielles en distillant des plantes et des jus, et ont également distillé du pétrole brut pour obtenir des esprits blancs (4). Mais les alchimistes, cherchant la transmutation des métaux de base en or, essayaient de faire un seul grand bond en avant. Ils ne savaient pas (comme nous le savons maintenant) comment avancer en testant, en modifiant ou en remplaçant leurs théories par de meilleures. Par conséquent, les alchimistes reculaient constamment, défaits dans leur objectif principal. La religion arabe n’était pas favorable à la connaissance mondaine pour elle-même, ni à l’amélioration par le changement. Les aspects critiques que la science arabe avait à ses grands jours ont été progressivement remplacés par des attitudes plus mystiques, l’accent étant mis en alchimie sur les exercices spirituels plutôt que sur les expériences scientif
iques.
Cependant, c’est du monde arabe, via la Sicile et l’Espagne, que les métiers des Grecs d’Alexandrie ont été transmis à l’Europe aux XIIe et XIVe siècles (voir Figure 4).
Par le XVème siècle, la Renaissance était à son apogée, balayant l’Italie puis se faisant sentir au nord des Alpes. La Renaissance comprenait un intérêt passionné pour la carte du monde redécouverte et la géographie de Ptolémée, ainsi que pour les traditions mathématiques de Platon et de Pythagore, dont le fameux théorème impliquait une déduction raisonnée à partir d’axiomes postulés. Le pouvoir intellectuel de l’homme était redécouvert, mais dans un nouveau contexte, celui du christianisme. Cette religion impliquait une croyance en un Seigneur gouvernant, conduisant directement à la conviction qu’il existait des lois régissantes. Au cours du XVe siècle, la technologie et les compétences artisanales étaient en train de s’améliorer ; par exemple, la distillation du vin et de la bière pour obtenir de l’alcool devenait plus populaire, et un tube de refroidissement sur l’alambic sous la forme d’une bobine ou d’un serpent était introduit.
Même au cours du XVIe siècle, les progrès scientifiques réels restaient plutôt limités et une grande partie de la tradition classique était préservée. Léonard de Vinci, dans son dessin de 1509 représentant les tourbillons et les bulles dans l’eau turbulente (voir Figure 5), était encore préoccupé par les formes plutôt que par le test d’une théorie. Cependant, certaines théories étaient discutées. Copernic remettait en question la théorie acceptée du mouvement planétaire et proposait que le soleil, et non la Terre, était le centre du système planétaire.
La technologie et les métiers (comme la distillation, voir Figures 6 et 7) continuaient également de progresser au cours du XVIe siècle. La fabrication du verre s’étendait pour répondre à la demande croissante de vitres, de bouteilles et de vaisselle. En alchimie, Paracelse mentionnait les diverses « opérations » utilisées, dont la calcination, la sublimation, la dissolution, la putréfaction, la distillation, la coagulation et la coloration : « Celui qui montera maintenant et passera ces sept étapes viendra à un endroit si merveilleux qu’il verra et expérimentera de nombreuses choses secrètes dans la transmutation de toutes les choses naturelles » (6). Cette idée, liée aux opérations de laboratoire, était peut-être la première allusion au concept d' »opérations unitaires ». La fabrication du sel concernait la coagulation des impuretés dans la saumure, l’évaporation et la cristallisation. Le traitement du sucre impliquait le pressage, l’évaporation et la cristallisation (voir Figure 8).
Au début du XVIIe siècle, les horloges et les instruments optiques capables de tester les théories scientifiques étaient encore améliorés. En même temps, les idées et les conflits de la Réforme se propageaient et prenaient racine. Cette répudiation de l’autorité humaine et la liberté des individus à se livrer à des discussions critiques sur les idées les uns des autres étaient peut-être liées à la structure plutôt instable de la société européenne. Cette instabilité était sans aucun doute accentuée par les vagues fréquentes d’épidémies qui balayaient l’Europe (la grande peste de Londres [1664-1665] n’était pas un phénomène isolé). Dans ces circonstances de bouleversements sociaux drastiques, l’intelligence et l’augmentation de l’alphabétisation avaient une plus grande portée qu’auparavant (9). Quelles que soient les causes de la Réforme, cependant, l’attitude de remise en question de l’autorité établie était essentielle avant qu’une science expérimentale critique puisse prospérer.
La Révolution scientifique du XVIIe siècle (associée à des noms tels que Kepler, Gilbert, Galilée, Torricelli, Pascal et Newton) était donc le résultat de la confluence de trois facteurs (9) :
- l’excitation de la Renaissance (et le contexte chrétien de celle-ci) ;
- les idées antiautoritaires de la Réforme ;
- les techniques optiques, chronométriques et métallurgiques améliorées.
En particulier, les instruments plus précis tels que les horloges, les télescopes, les thermomètres et les microscopes composés ont permis de tester les théories scientifiques de manière beaucoup plus exacte et étendue que jamais auparavant. C’est ainsi que fleurissait l’activité scientifique qui s’est produite au XVIIe siècle ; la technologie et les nouvelles théories ont commencé (et continuent) à avancer main dans la main, se renforçant mutuellement. Galilée commença ses expériences sur la période d’oscillation des pendules en 1581, ce qui conduisit à l’invention de l’horloge à pendule beaucoup plus précise.
Au cours des premières décennies du XVIIe siècle, le philosophe anglais Francis Bacon écrivait sur l’importance de l’expérience et de l’observation. Selon lui, la connaissance était utile pour donner à l’homme la souveraineté sur la nature. Il préconisait un échange actif de points de vue intellectuels et pensait que la critique destructive était particulièrement importante. Il soulignait également l’importance des généralisations et d’une approche fondamentale, affirmant que les théories testées devaient également être appliquées dans de nouvelles circonstances. Pour de tels tests, affirmait-il, certaines observations sont particulièrement précieuses car elles permettent de choisir entre deux théories rivales. « Nous devons torturer la nature pour la contraindre à répondre à nos questions » (10).
Les théories devenaient maintenant publiques plutôt que privées ; elles étaient diffusées plus largement par la presse, relativement récemment inventée. La confiance dans la nouvelle méthode scientifique augmentait rapidement : bon nombre des nouvelles théories (par exemple, les théories de Newton de 1666-1687) étaient confirmées par des expériences. En particulier, les nouvelles expériences et observations montraient de manière décisive que les théories actuelles étaient supérieures à celles des anciens – la physique d’Aristote (les corps ne bougent que s’ils sont poussés) était incorrecte, et les cartes de Ptolémée étaient clairement erronées.
Avec cette nouvelle confiance en soi en Europe, l’activité scientifique avançait ; alors qu’avant le XVIIe siècle, la science expérimentale de base n’était pas rentable, ni intellectuellement ni financièrement, soudainement les nouvelles théories, avec leur élégance, leurs tests rigoureux avec les nouveaux instruments et leur utilité en navigation et en guerre, rendaient la science très importante. Les théories qui faisaient des prédictions précises et résistaient à des tests répétés étaient clairement les meilleures théories dans cette société. La Révolution scientifique avait eu lieu ; l’approche scientifique s’était établie comme une philosophie.
Les contraintes distinctives de cette philosophie sont les quatre critères (9) :
- Le scientifique utilise des mots et des symboles de manière relativement explicite et formelle, contrairement aux mots vagues et émotifs utilisés en poésie et en religion (amour, grâce, rédemption, etc.).
- Il a une forte appréciation esthétique de l’élégance des théories générales fondamentalement simples (bien qu’elles soient peut-être abstraites et mathématiques).
- Il formule des prédictions précises et réalise des tests expérimentaux précis pour vérifier si les théories fonctionnent avec précision sur des plages de plus en plus larges (c’est-à-dire qu’une théorie scientifique est potentiellement falsifiable).
- Il est prêt, face à la critique et à la réfutation, à échanger ou à modifier sa théorie en faveur d’une meilleure.
Chine et Arabie On peut légitimement se demander pourquoi il n’y a pas eu de développement spectaculaire comparable de la science dans l’ancienne Chine ou en Arabie entre les 9e et 12e siècles. Pourquoi n’y a-t-il eu qu’une seule révolution scientifique ? La triple coïncidence qui a initié la révolution a été discutée ci-dessus.
En Chine, il n’y a jamais eu une situation comparable. La religion confucianiste (avec son grand respect pour les archives de l’antiquité, un intérêt dominant pour les problèmes sociaux et moraux, selon le principe que les prudents ne se trompent jamais), la rigidité de la langue écrite (un nouveau symbole est nécessaire pour chaque nouveau concept) et l’absence d’esprit compétitif (contrairement à celui entre les différents États européens) ont tous conspiré contre toute activité scientifique suffisante pour faire une percée.
De plus, les anciens Chinois recrutaient leurs meilleurs érudits pour le service de l’État, les éloignant ainsi des affaires pratiques de la vie. Un tel système préservait efficacement le statu quo. Le résultat était que les exploits technologiques (comme les murailles et canaux étendus et les rendements élevés des cultures grâce au compostage) étaient réalisés sans théories abstraites : la technique consistait en un million d’hommes chacun avec une petite cuillère. Il n’y avait jamais eu un grand intérêt pour les forces inanimées, et l’initiative locale n’était pas encouragée (les systèmes d’irrigation étaient contrôlés par les autorités centrales). Ainsi, malgré la compétence, la ténacité et les épidémies fréquentes de peste en Chine, le climat intellectuel y est resté assez différent de celui de l’Europe post-Renaissance.
En Arabie, la science était la plus forte entre les 9e et 12e siècles. La tradition était continue depuis l’Antiquité tardive, basée sur la science et l’artisanat grecs. Il n’y a pas eu de redécouverte excitante soudaine comme en Europe à la Renaissance. Bien qu’il y ait eu des réalisations considérables en mathématiques et en astronomie, les métiers et les attitudes intellectuelles évoluaient très lentement. En fait, les alchimistes pratiquaient toujours leur art dans la ville ancienne de Fès (Maroc) jusqu’environ 1956. Même aujourd’hui, certaines des alambics utilisés là-bas pour distiller des parfums ont une forme remontant aux premiers siècles après J.-C., lorsque les Arabes ont amélioré l’appareil de distillation en refroidissant (avec de l’eau) le tube menant de la tête de l’alambic. Ils découvraient plusieurs huiles essentielles en distillant des plantes et des jus, et distillaient également du pétrole brut pour obtenir des esprits blancs (4). Mais les alchimistes, cherchant la transmutation des métaux vils en or, essayaient de faire un seul grand saut en avant. Ils ne savaient pas (comme nous le savons maintenant) comment progresser en testant, en modifiant ou en remplaçant leurs théories par de meilleures. Par conséquent, les alchimistes retombaient continuellement, vaincus dans leur objectif principal. La religion arabe n’était pas favorable à la connaissance mondaine pour elle-même, ni à l’amélioration par le changement. Les aspects critiques que la science arabe avait dans ses grands jours ont été progressivement remplacés par des attitudes plus mystiques, l’accent en alchimie étant mis sur les exercices spirituels plutôt que sur les expériences scientifiques. Cependant, c’est du monde arabe, via la Sicile et l’Espagne, que les métiers des Grecs d’Alexandrie ont été transmis à l’Europe aux XIIe et XIVe siècles (voir Figure 4).
Chimie : La Théorie Atomique Moderne (1661-1811) À la fin du XVIIe siècle, malgré les connaissances empiriques des alchimistes et l’amélioration considérable de la compréhension de la physique, la chimie se développait lentement et avec de grandes difficultés. La naissance de la chimie en tant que science peut peut-être être datée de la publication par Robert Boyle en 1661 de « The Skeptical Chymist ». Dans ce livre, Boyle critiqua sévèrement l’approche des alchimistes, dont les recherches étaient orientées vers des objectifs pratiques tels que la fabrication d’or et de médicaments. Leurs théories plutôt mystiques de la matière étaient si vagues et ambiguës qu’elles pouvaient couvrir toutes sortes de phénomènes découverts par la suite. Boyle soutenait que la chimie devait être moins étroitement liée à des objectifs immédiats spectaculaires, mais que des tests expérimentaux systématiques étaient nécessaires. Cet esprit d’investigation le poussa à analyser diverses substances, et il rejeta la théorie alors courante selon laquelle les quatre éléments étaient la terre, l’air, le feu et l’eau. Au lieu de cela, il avança l’opinion que seules les substances à partir desquelles rien de différent ne pouvait être obtenu par décomposition devraient être considérées comme les éléments de la matière.
Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, il y eut un intérêt considérable pour les bases alcalines et les terres, ainsi que pour l’isolement de nouveaux métaux. Parmi les chimistes célèbres de l’époque, citons le Français H. L. Duhamel. En 1736, il publia son travail comparant le sel de mer (c’est-à-dire NaCl) et le sel digestif (c’est-à-dire KCl), montrant que l’acide était le même dans les deux cas, mais que les bases étaient différentes. Un an plus tard, il établit l’identité des bases élémentaires du sel commun et de la soude (carbonate de sodium) en chauffant le sel commun avec de l’acide sulfurique pour obtenir du sulfate de sodium, puis en réduisant cela avec du charbon, en traitant le produit avec de l’acide acétique pour obtenir de l’acétate de sodium, et enfin en le chauffant pour produire du carbonate de sodium (11).
Lavoisier, à partir de 1772, expérimenta avec diverses substances combustibles, et en 1789, il interpréta ses résultats en termes du concept d’éléments de Boyle, parmi lesquels figuraient de nombreux métaux et non-métaux solides, ainsi que les gaz oxygène, hydrogène et azote. Le concept d’affinité chimique a été développé à cette époque en tant que classification empirique des substances selon leurs réactivités chimiques relatives. Même au début du XIXe siècle, la chimie n’était toujours pas quantitative ; elle devait attendre le rôle prépondérant d’une théorie. La théorie atomique de John Dalton (1803-1808) servit admirablement cet objectif. Dalton visualisait les atomes de chaque élément comme étant tous exactement semblables, tandis que ceux des éléments différents avaient des poids différents mais caractéristiques. Selon cette théorie, les composés sont formés par l’union d’atomes d’éléments différents dans des proportions simples. De cette théorie, Dalton prédisait que les changements chimiques entre les substances ne se produiraient que dans certains rapports de poids simples, et il confirma cette prédiction expérimentalement.
Avec la théorie d’Avogadro (1811), qui stipulait que les particules des éléments gazeux sont normalement constituées de plusieurs atomes regroupés en ensembles (qu’il appelait « molécules »), et son hypothèse ultérieure selon laquelle des volumes égaux de tous les gaz contiennent le même nombre de molécules, la théorie atomique était pratiquement complète.
Processus chimiques et distillation (1740-1913) Une productivité agricole plus élevée sur place, ainsi que la disponibilité de produits alimentaires bon marché importés en Grande-Bretagne depuis le Nouveau Monde, ont permis à la fois une forte augmentation de la population et un déplacement des gens de la campagne vers les villes. Cette concentration de main-d’œuvre et de richesse a ensuite rendu possible la révolution industrielle, c’est-à-dire que les processus artisanaux pouvaient être pratiqués à une bien plus grande échelle, bien que de manière plutôt empirique. Par exemple, au Royaume-Uni en 1785, il y avait 971 savonniers produisant en moyenne 16 tonnes chacun, mais d’ici 1830, il n’y avait que 309 savonniers, produisant en moyenne 170 tonnes par an chacun (12). En Amérique du Nord, la fabrication du savon est restée un artisanat domestique jusqu’en 1800, avec peu de développements industriels.
Alcali. Les savonniers, ainsi que les fabricants de textiles et de verre, nécessitaient des quantités croissantes d’alcali pour leurs processus, et en Grande-Bretagne, il était obtenu (jusqu’environ 1806) entièrement à partir des cendres de certaines plantes et algues. Mais vers la fin du XVIIIe siècle, les approvisionnements en alcali devenaient insuffisants et coûteux. La rareté se reflète dans le fait que Lord Macdonald of the Isles gagnait £10 000 par an (une somme énorme à l’époque) grâce à sa part dans les bénéfices de la combustion d’algues écossaises pour produire du carbonate de sodium. Les cendres d’alcali étaient également importées en Grande-Bretagne depuis l’Amérique et l’Espagne. En France, la situation d’approvisionnement était pire. En 1776, la situation politique et financière rendait incertaine la continuité des importations de cendres dans ce pays (en particulier depuis l’Espagne), et un prix était offert par l’Académie des sciences française pour un nouveau processus commercial permettant de produire de l’alcali sodé à partir de sel commun. Les réactions de Duhamel (mentionnées précédemment) étaient bien sûr complètement économiquement inefficaces, mais il avait été clairement établi à partir de telles études de chimie pure que le sel commun, le sulfate de sodium et le carbonate de sodium étaient liés par l’élément sodium, et qu’un processus commercial pourrait donc être réalisé. Cependant, cela ne s’est pas avéré facile, et ce n’est qu’en 1789 que Nicolas Le Blanc a conçu son processus (décrit plus tard) pour fabriquer de l’alcali à partir de sel commun. Il n’a pas basé son processus sur la théorie alors courante de l’affinité chimique, qui suggérait que le fer devrait être utilisé pour produire de l’alcali à partir de sulfate de sodium en raison de l’affinité élevée du fer pour le sulfate (13, 14). En fait, la théorie de la chimie précise du processus Le Blanc est restée obscure jusqu’à environ 100 ans plus tard, et Le Blanc a bien pu concevoir son processus au moyen d’une analogie simple mais fallacieuse avec la fusion du minerai de fer (13, 14). Il a breveté (15) le processus en 1791, et en 1794-1795, une petite usine a été exploitée à Franciade (près de Saint-Denis, sur la Seine en France) par Le Blanc, Dize et Shee (16). Cependant, le processus s’est avéré économiquement peu rentable, et ce n’est qu’en 1808 qu’il a prospéré, lorsqu’il y a eu une remise spéciale de la taxe sur le sel et lorsque les approvisionnements en cendres d’alcali se sont révélés sérieusement insuffisants parce que les importations d’alcali étranger étaient activement découragées (13). En 1810, plusieurs usines d’alcali étaient en activité en France ; cette année-là, celle de Marseille a produit 1000 tonnes. En 1814, sa production était de 3500 tonnes, et en 1820, elle était de 9000 tonnes (17). En Grande-Bretagne, le processus Le Blanc a été introduit entre 1802 et 1806, mais la Grande-Bretagne faisait un commerce très étendu et importait toujours beaucoup de cendres alcalines. Par conséquent, le processus Le Blanc n’y s’est pas développé rapidement. Il n’a été solidement établi qu’en 1823 ; mais d’ici 1840, tellement d’alcali était fabriqué en Grande-Bretagne par le processus Le Blanc qu’il y en avait assez pour approvisionner le marché local et créer un surplus pour l’exportation vers l’Amérique.
La méthode Le Blanc (utilisée à grande échelle en Grande-Bretagne jusqu’en 1885) produisait de l’alcali en chauffant d’abord du sel et de l’acide sulfurique par lots pour donner du NS04 et du gaz HCl. Le sulfate de sodium solide était ensuite chauffé dans des fours rotatifs (voir Figure 9) avec un mélange de calcaire et de charbon pour produire un produit solide (cendres noires) à partir duquel le carbonate de sodium était ensuite extrait. Un sulfure de calcium très sale restait. L’élimination de celui-ci posait problème, mais le gaz HCl était encore pire. À l’usine Le Blanc d’origine à Franciade, la petite quantité de gaz HCl produite était en partie rejetée dans l’atmosphère, mais une partie était convertie en chlorure d’ammonium en recueillant le HCl dans une chambre en plomb, puis en introduisant de la vapeur d’ammoniac (15,16). Mais en Grande-Bretagne dans les années qui ont suivi 1823, les quantités de chlorure d’hydrogène issues du processus Le Blanc étaient si énormes que le traitement à l’ammoniac n’était pas réalisable : le HCl était rejeté directement dans l’atmosphère (voir Figure 10), causant d’importants dégâts aux cultures et aux arbres à proximité des usines. Cela a nécessité des compensations financières considérables (19).
En 1836, William Gossage a eu l’heureuse inspiration d’utiliser un vieux moulin à vent, qui se trouvait près de son usine, comme tour d’absorption pour éliminer le gaz HCl. Il a rempli le vieux moulin avec de la genêtière et du bois de la campagne environnante, et a irrigué cette tour emballée avec un flux descendant d’eau, introduisant le gaz HCl par le haut (11). Cette simple tour d’absorption a très bien fonctionné, et c’est ainsi qu’est née empiriquement ce qui est encore une opération standard en génie chimique. Gossage dans son brevet de 1836 a clairement indiqué l’importance de l’utilisation de surfaces étendues sur lesquelles l’eau est amenée à passer dans la même direction que la fumée et le gaz. Des tours en pierre ou en briques, remplies de brindilles, de briques cassées ou de coke, ont rapidement été largement utilisées pour absorber le gaz HCl du processus Le Blanc, bien que la solution de HCl provenant du bas devait toujours être éliminée, généralement en la déversant dans une rivière.
Une voie plus directe vers l’alcali à partir de sel commun est le procédé ammoniac-soude (1863 +), impliquant une réaction chimique entre le CO 2 et une solution aqueuse concentrée de NaCl saturée d’ammoniac. Cette réaction a été découverte en 1811 par A. J. Fresnel, qui avait montré en laboratoire que NaHCO 3 pouvait être précipité à partir d’une solution de NaCl saturée en présence de bicarbonate d’ammonium (21). Mais les efforts répétés pour mettre à l’échelle la réaction à la production commerciale ont été, pendant de nombreuses décennies, tous frustrés en raison des difficultés à récupérer et à conserver l’ammoniac et à obtenir du CO 2 suffisamment pur et à l’utiliser sous pression. Ce n’est qu’en 1861 que le Belge Ernest Solvay, abordant les problèmes de l’absorption efficace du CO 2 et de la distillation et du recyclage de l’ammoniac avec des pertes minimales d’un point de vue technique, a réussi à mettre au point un procédé commercial. L’ingénierie était tellement importante pour le succès (en particulier la tour de carbonatation à haute efficacité (21) de 80 pieds de hauteur avec la saumure ammoniacale entrant par le haut et le gaz CO 2 par le bas, et contenant des plaques et des chapeaux de bulles) que le procédé ammoniac-soude a été appelé le procédé Solvay. En 1873, le procédé Solvay a été introduit en Angleterre par Ludwig Mond et John Brunner. En 1885, il remplaçait rapidement le procédé Le Blanc, sur lequel le procédé Solvay avait trois avantages : (1) une étape de séparation plus facile (filtration pour éliminer le NaHCO 3 précipité) ; (2) l’absence d’un sous-produit sale et difficile à éliminer ; et (3) un fonctionnement continu. Grâce au procédé Solvay, le prix du carbonate de sodium est passé d’environ 80 $ la tonne en 1870 à environ 24 $ la tonne en 1900. Une usine Solvay typique est illustrée dans la Figure 11.
The coal was first carbonized on a practical scale at the beginning of the 18th century to obtain coke for smelting iron ores, but it wasn’t until the end of that century that any by-products were recovered. Coal gas was produced for lighting by William Murdoch in 1795, and a few years later, he manufactured coal gas on a sufficient scale to light a factory in Birmingham (in the Soho area of that city) by gas flames. By 1823, in London alone, 250 x 10^6 cubic feet of coal gas per year were being produced, mainly for illumination, from coal carbonization plants. Associated with gas making were the by-products ammonia, coal tar, and coke. Ammonia was needed for nitrogenous fertilizers such as ammonium sulfate (and later for the Solvay process), and tar (after distillation) yielded a variety of useful products. Coke was used as fuel and in metallurgy (and also for packing absorption towers).
Sulfuric acid was required in increasing quantities for many developing industries (e.g., textile treatment, fertilizers, and alkali manufacture). In 1843, Liebig pronounced that it was no exaggeration to say that we may judge fairly the commercial prosperity of a country from the amount of sulfuric acid it consumes.
As early as the 1730s, Joshua Ward had begun manufacturing sulfuric acid in small batches by burning sulfur-containing substances and saltpeter (KN0_3) above a shallow layer of water under a glass bell. In 1746, Roebuck and Garbett in Birmingham (England) scaled-up the reaction, making a reaction chamber (about 6 sq ft) from lead sheets supported on a wooden framework. Other small plants soon followed, each making a few tons of acid per year. The effect of the larger scale of the lead chamber process on the price of sulfuric acid was striking—from £280 a ton in 1746 to £50 a ton a few decades later.
Freed from the limitations of glassware, the size of the acid chambers soon increased from a few hundred cubic feet to chambers, each with the capacity of a large concert hall, several being used in sequence. Quite early in the development of the chamber process (about 1800), it was made continuously by blowing the gases and steam through the chambers. It was also shown (in 1806) that the saltpeter served as an important intermediary. Before this, it had been thought that sulfuric acid resulted from the simple combustion of sulfur in air, with saltpeter supposed to accelerate the burning of sulfur. However, in 1806, Clement and Desormes in France showed that the action of the saltpeter was to decompose into nitrogen oxides, which then catalyzed the formation of sulfuric acid—the first clearly characterized example of a catalytic reaction. The catalyst had been found entirely by chance. By 1810, it was becoming clear from chemical theory that one part of sulfur should furnish about three parts of concentrated acid.
La science chimique a joué un rôle crucial dans l’avancement de la technologie chimique. Avec une meilleure compréhension et maîtrise des processus chimiques, les rendements ont augmenté de manière spectaculaire, passant d’environ 30 % à 80 %, voire 90 %. Vers 1830, Gay-Lussac en France a élaboré sa tour d’absorption pour récupérer les oxydes d’azote plutôt coûteux des gaz quittant les chambres d’acide sulfurique. Cependant, la tour s’est avérée difficile à exploiter et n’a été largement adoptée qu’en 1869.
La concentration de l’acide sulfurique était un autre aspect essentiel de la technologie chimique. Au milieu du XIXe siècle, Glover a développé sa tour garnie pour concentrer l’acide en utilisant les gaz chauds entrants des brûleurs de soufre, récupérant les oxydes d’azote dissous dans l’acide provenant de la tour de Gay-Lussac. La taille des chambres en plomb a été réduite de moitié après l’adoption généralisée des tours de Gay-Lussac et de Glover vers 1869.
En 1820, le Royaume-Uni produisait 3 000 tonnes d’acide sulfurique. Cependant, avec l’essor du procédé de soude Le Blanc, la production avait atteint 260 000 tonnes d’ici 1860. En 1900, elle atteignait près de 1 000 000 de tonnes, constituant un quart de la production mondiale.
Les engrais agricoles étaient essentiels pour améliorer les rendements des cultures. L’utilisation de fumier, de cendres de bois et de divers matériaux organiques pour la fertilisation remonte à l’Antiquité. Au XVIIIe siècle, on appliquait des os broyés sur le sol, mais leur faible solubilité limitait leur efficacité. Lawes, en 1841-1842, a créé une usine pour rendre le phosphate d’os plus soluble en le traitant d’acide sulfurique pour produire du superphosphate. Cela est devenu la plus grande utilisation de l’acide sulfurique, et d’ici 1861, 40 000 tonnes par an de matériaux phosphatés étaient solubilisées.
L’industrie du superphosphate a considérablement augmenté les rendements céréaliers, et Lawes a étendu ses opérations pour inclure des phosphates minéraux. Un engrais azoté synthétique, le sulfate d’ammonium, a été fabriqué au Royaume-Uni en 1815, et d’ici 1879, la production nationale avait atteint 40 000 tonnes par an. Le développement du procédé Haber en 1913 a permis la production industrielle d’ammoniac synthétique, révolutionnant la production d’ammoniac et contribuant à l’augmentation des rendements des cultures. Aujourd’hui, les engrais chimiques ont contribué à ce que les rendements par acre soient environ cinq fois supérieurs à ceux du Moyen Âge.
Le compostage des déchets organiques, pratiqué depuis longtemps par les Chinois, a peu évolué au fil des siècles, restant essentiellement une opération en lot à petite échelle. Avec l’adoption de ce processus par le monde occidental au cours du siècle actuel, des progrès ont été réalisés dans la compréhension des réactions chimiques fondamentales impliquées et dans l’application du compostage au traitement à grande échelle des déchets (29).
La pratique de la distillation a été introduite dans le nord de l’Europe depuis le monde arabe, via l’Espagne et l’Italie, au cours des XIIe-XIVe siècles. La distillation de boissons alcoolisées à partir du XIVe siècle a été décrite précédemment. Au XVIIe siècle, un peu de pétrole brut naturel était également distillé commercialement, et à Broseley (dans les Midlands de l’Angleterre), de l’huile extraite de la roche bitumineuse locale était distillée pour donner un distillat semblable à la térébenthine et un résidu de brai. En 1746, un brevet a été accordé au Royaume-Uni pour la distillation d’huiles de goudron de houille (30). Plus tard au XVIIIe siècle, le goudron de bois était distillé en Angleterre pour produire de l’huile de pin, et dès 1822, le goudron de houille était distillé (également en Grande-Bretagne) pour produire une huile légère (naphte), utilisée comme huile de lampe et solvant. Lorsque Macintosh a eu besoin en 1823 d’une huile légère pour dissoudre le caoutchouc utilisé pour ses vêtements imperméables, il l’a obtenue auprès d’une petite entreprise de distillation de goudron à Leith, qui obtenait son goudron de Birmingham.
En 1838, à Birmingham, des huiles de goudron lourdes (créosotes) étaient utilisées pour la préservation des traverses de chemin de fer et d’autres bois (30), et d’ici 1850, de nombreuses autres distilleries de goudron étaient en activité, exportant des huiles de goudron depuis la Grande-Bretagne. En 1860, la première raffinerie de pétrole a été construite en Pennsylvanie. Cependant, ces premières raffineries de goudron et de pétrole étaient extrêmement simples, car aucune fractionnisation étroite n’était nécessaire. Les produits étaient simplement collectés (condensation des vapeurs dans une bobine immergée dans l’eau) en fonction de la densité spécifique, qui variait avec le temps et la température de la distillation du lot d’huile. Bien que certaines de ces distilleries d’huile aient plus tard été connectées en série et fonctionnaient en continu, elles étaient, du point de vue thermique, assez inefficaces. Elles produisaient également uniquement des fractions à ébullition large.
La distillation d’alcool exigeait un équipement plus performant, et au début du XIXe siècle, plusieurs alambics ont été conçus dans lesquels les vapeurs passaient à travers des cylindres divisés en compartiments par des plaques perforées. Ces alambics horizontaux fonctionnaient par condensation partielle (4). En France, en 1818, J.B. Cellier a conçu un alambic pour produire du brandy à partir de grandes quantités de solution aqueuse diluée, utilisant une colonne verticale avec des plateaux à bulles.
En 1830, Aeneas Coffey de Dublin a conçu un alambic qui fonctionnait en continu et permettait une bonne séparation de l’alcool (31). Il alimentait le mélange préchauffé d’eau et d’alcool (provenant de la fermentation) dans une série verticale de chambres peu profondes placées les unes sur les autres, séparées par des plaques perforées, chauffées par de la vapeur vive, et utilisant le reflux (voir Figure 13). Avec un tel alambic, 85 % d’éthanol pouvaient être produits à partir d’une teneur initiale de 5 % en éthanol. L’alambic de Coffey a été le précurseur de la colonne moderne, et son efficacité dans la séparation de fractions à ébullition proche a conduit plus tard à son adoption pour les séparations d’hydrocarbures, par exemple le distillateur de benzène de Coupier (1863) pour purifier le benzène du toluène. La condensation partielle a également amélioré la séparation réalisée dans l’alambic de Coupier.
En 1869, une amélioration de l’efficacité thermique globale a été apportée aux alambics à goudron d’Oldbury, à Birmingham. Les vapeurs d’un alambic étaient passées à travers une bobine immergée dans le goudron en cours de préparation pour la prochaine distillation, le réchauffant et faisant évaporer toute eau associée (30). Mais ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle et au cours des premières décennies du XXe siècle que les grands progrès ont été réalisés, caractérisant désormais les opérations de distillation hautement efficaces et sélectives conçues par les ingénieurs chimistes. Par exemple, c’est en 1900 que des colonnes de fractionnement contenant des plateaux perforés ont été introduites dans les alambics à goudron d’Oldbury. Aujourd’hui, il est courant de fractionner des mélanges à ébullition proche tels que l’ortho- et le para-xylène par distillation. Une tour de fractionnement moderne pour le pétrole brut est présentée à la Figure 14.
Connaissances en génie chimique jusqu’en 1910
Pendant le XIXe siècle, l’accent était mis principalement sur le développement des procédés. La création réussie de nouveaux processus s’effectuait généralement à l’aide de machines et de structures relativement simples et empiriques, telles que des fours (parfois rotatifs, comme les revolvers de cendres noires dans le processus Le Blanc après 1853), ainsi que divers types de pots, fours et cuves de mélange conçus pour faciliter les réactions chimiques. Bien que certaines industries nécessitent une ingénierie substantielle, comme les colonnes et les tours dans le processus Solvay, l’importance du génie chimique est devenue de plus en plus évidente vers 1880. En cette année, une tentative a été faite pour fonder une Société des ingénieurs chimistes à Londres (26). À ce stade précoce, un ingénieur chimiste était considéré comme un ingénieur mécanique ayant une certaine connaissance de la chimie des procédés.
À la fin du siècle, l’utilisation du distillateur Coffey devenait plus répandue, bien que l’approche générale de l’équipement restait largement empirique. Cependant, les opérations de séparation, alors comme maintenant, étaient les étapes les plus coûteuses de nombreux procédés. Avec la demande croissante de produits chimiques de plus en plus purs, notamment pour la synthèse des colorants, une attention accrue a été portée à l’équipement de séparation.
Contrairement à la chimie, où l’influence de la science fondamentale était significative, le domaine du génie chimique a connu une influence moins prononcée. Alors que la théorie des éléments en chimie suggérait des possibilités de synthèse de substances telles que NaHCO3 à partir de NaCl, et plus tard, la théorie atomique a joué un rôle crucial dans le développement de divers nouveaux colorants (comme la théorie du noyau benzénique de Kekulé en 1865), l’équipement utilisé pour les séparations (par exemple, les tours d’absorption) est resté largement empirique. Les concepts de science pure tels que la deuxième loi de la thermodynamique (1854), les théories du transfert de chaleur, la caractérisation du flux de fluide par Reynolds (1883) ou la théorie des groupes sans dimension ont eu une influence minimale sur l’ingénierie mécanique, structurelle, voire sur la plomberie de l’industrie chimique.
Le choix des matériaux de construction pour les grandes cuves posait un problème complexe. Le verre s’est révélé inadapté aux processus à grande échelle. Par conséquent, divers matériaux chimiquement résistants tels que le plomb, la céramique, le fer à haute teneur en silicium, les cuves émaillées et les revêtements en caoutchouc (suggérés pour la première fois par Le Blanc pour contenir l’acide sulfurique) étaient envisagés et utilisés sur une base d’essai-erreur (33).
Il y a cent ans, George E. Davis était l’inspecteur des alcalis pour la région « Midland » de l’Angleterre. Sa fonction était de surveiller la pollution provenant non seulement des usines d’alcalis, mais aussi des nombreuses autres usines chimiques de la région. Il a ainsi eu accès à une grande variété de procédés chimiques, formant incidentalement les rudiments de l’éducation moderne en génie chimique.
Après sa démission de l’inspection des alcalis en 1884, Davis est devenu consultant indépendant, et en 1887, il a donné une série de conférences à l’école technique de Manchester (Angleterre) dans lesquelles il a analysé les diverses technologies de procédés chimiques contemporains en une série d’opérations de base (aujourd’hui appelées « opérations unitaires »). Davis (34) a souligné que toutes les usines de traitement chimique diverses étaient en grande partie des combinaisons et des séquences d’un nombre relativement restreint d’opérations telles que la distillation, l’évaporation, le séchage, la filtration, l’absorption et l’extraction. Davis a ainsi redécouvert les étapes (ou opérations) de Paracelse, typiques des préparations chimiques en laboratoire, mais peu familières aux ingénieurs chimistes de l’époque victorienne, plus orientés vers la mécanique. Les succès éblouissants des procédés chimiques du XIXe siècle n’ont pas aveuglé Davis sur l’importance, pour la conception des installations, de l’approche par opérations dans les nombreuses et variées industries chimiques dont il avait l’expérience. Il a publié ces idées à partir de ses conférences de 1887 dans le Chemical Trade Journal au cours des années suivantes. En 1901, il systématisa cette approche dans son Handbook of Chemical Engineering. Davis était motivé par une préoccupation pour la concurrence industrielle dans le domaine chimique en provenance des États-Unis et de l’Allemagne (26), et par la réalisation que l’agrandissement d’une usine chimique nécessitait un nouveau type d’ingénieur chimiste. Le livre a eu tellement de succès qu’une deuxième édition élargie de plus de mille pages est parue en 1904 (23, 26).
Dans la préface, Davis écrivait : « L’objectif de ce manuel n’est pas de permettre à quiconque de construire une usine d’un caractère particulier… mais d’illustrer les principes selon lesquels une usine de n’importe quel type peut être conçue et érigée lorsque certaines conditions et exigences sont connues. Nous ne pouvons pas tirer le meilleur parti de nos compétences à moins d’apprendre à examiner les principes sous-jacents à la construction des appareils avec lesquels nous devons travailler » (26). Dans l’édition de 1904, on trouve par exemple un calcul d’échantillon du bilan thermique sur une tour Glover traitée comme un évaporateur, montrant à quel point elle était inefficace à l’époque (« quel gaspillage de chaleur c’est » (23)). Il y a également une discussion sur l’efficacité de divers emballages, expliquant en termes de surfaces pourquoi le coke est de 1,5 à 2 fois plus efficace que les briques (23, 26). Mais en général, l’approche de Davis était encore empirique ; les opérations sont décrites comme des procédures d’utilité pratique et ne sont pas basées sur la physique fondamentale. Ni le travail d’Osborne Reynolds ni la théorie des groupes sans dimension n’avaient encore été assimilés par la profession. L’idée de Davis, il est intéressant de le noter, a été adoptée aux États-Unis beaucoup plus tard ; George E. Davis « a présenté le concept essentiel d’opérations unitaires et en particulier une compréhension de sa valeur pour l’éducation » (W. K. Lewis (35)). Au MIT, Arthur D. Little a inventé le terme « opérations unitaires » en 1915, et le manuel de W. K. Lewis était organisé sur la base du système de Davis. Les industries pétrolières et pétrochimiques, se développant à grande échelle aux États-Unis, ont sans aucun doute accéléré la croissance frappante et rapide de l’approche des opérations unitaires dans ce pays. En Angleterre également, le concept de Davis était accepté. En 1907, l’Université de Birmingham a lancé son cours de diplôme en ingénierie minière, et au cours de la session 1910-1911, des opérations de base telles que le concassage, le transport, le pompage et les séparations hydrauliques ont été incluses dans ce cours. Des conférences sur l’écoulement des fluides, notamment l’écoulement à travers des canaux fermés, l’écoulement à travers des orifices et le comportement des particules en chute libre, ont également été dispensées. En 1911-1912, un cours de conférences sur le raffinage du pétrole a été ajouté, et en 1912, ce sujet faisait partie d’un nouveau cours de diplôme intitulé « Exploitation pétrolière ». Les expériences de laboratoire associées comprenaient la distillation du pétrole brut. Au fil des ans, le côté raffinage du cours a pris de plus en plus d’importance, et en 1922, un département distinct d’ingénierie pétrolière a été créé à Birmingham. Il est intéressant de noter que certaines des recherches de ce département portaient sur l’hydrogénation du charbon – il y a 60 ans, l’ère des importations massives de pétrole bon marché était encore à venir et à partir! Le département d’ingénierie pétrolière de Birmingham a été rebaptisé plus tard (1946) Département de génie chimique.
Un autre cours précoce en Angleterre était celui du Battersea Polytechnic (Londres). Lors de la session 1914-1915, un cours intitulé « Génie chimique » a été mis en place, les opérations de base étant traitées de manière plus explicite que dans le manuel de Davis (36, 37).
Ingénierie chimique moderne Les processus continus sont devenus plus courants dans les années 1920 et 1930. Pour faire fonctionner ces processus et agrandir efficacement un procédé, il fallait comprendre les flux et la récupération de chaleur. Ainsi, la thermodynamique, les bilans matériels et thermiques, le transfert de chaleur, l’écoulement turbulent (en particulier le comportement des tourbillons aux interfaces (38)), ainsi que la cinétique des réactions et la catalyse sont devenus (et sont toujours) les bases sur lesquelles repose le génie chimique. L’analyse des groupes sans dimension, utilisée beaucoup plus tôt par les physiciens, a été utilisée plus largement par les ingénieurs chimistes. Bien sûr, les matériaux de construction (par exemple, les aciers inoxydables, le titane et les revêtements en Teflon) sont également importants, tout comme le contrôle automatique, les programmes informatiques, la recherche opérationnelle et la planification du chemin critique. Cependant, ces dernières techniques peuvent continuer à évoluer, et donc la thermodynamique, les bilans matériels et thermiques, l’écoulement turbulent et la cinétique des réactions des systèmes à écoulement continu doivent constituer un noyau dur des connaissances en génie chimique. Associées à ce noyau, on trouve les technologies des processus de séparation modernes (y compris l’extraction liquide-liquide et la distillation). Celles-ci sont particulièrement importantes car l’équipement de séparation dans une usine chimique typique coûte souvent beaucoup plus cher que le réacteur chimique lui-même.
La philosophie du génie chimique Outre les différences d’échelle de leurs opérations, il peut y avoir des motifs différents de théoriser et d’expérimenter entre les ingénieurs chimistes et les chimistes purs. Pour le chimiste pur, les motifs sont généralement la curiosité et le désir de voir un schéma simplificateur liant des phénomènes apparemment déconnectés.
Le motif de l’ingénieur, en revanche, est de créer quelque chose qui fonctionnera de manière satisfaisante, et l’ingénieur a généralement moins de choix que le scientifique pur dans les systèmes à étudier. De nombreux processus utiles et importants en génie chimique impliquent des matériaux très complexes, y compris des mélanges contenant de nombreux composants, et des liquides aux propriétés d’écoulement anormales. Pour traiter quantitativement ces systèmes de manière à ce que les effets des variations puissent être prédits avec précision, l’ingénieur chimiste doit modifier autant que possible les variables. Idéalement, cela se fait en les étudiant une par une, bien que cette procédure ne soit souvent pas physiquement possible.
Souvent, en traitant une situation pratique compliquée, l’ingénieur réduit arbitrairement le nombre de variables dans sa théorie en les combinant en groupes sans dimension, dont un exemple bien connu est le nombre de Reynolds caractérisant l’écoulement d’un fluide à travers un tuyau. Ces groupes sans dimension sont évalués en laboratoire et sont ensuite utilisés pour prédire le comportement dans une usine chimique à grande échelle. Cependant, cette procédure réduit quelque peu notre confiance dans nos prédictions ; bien que le groupe dans son ensemble puisse avoir varié considérablement dans les expériences en laboratoire, l’une ou plusieurs des variables à l’intérieur du groupe peuvent n’avoir pratiquement pas changé. En raison de cette confiance réduite dans l’utilisation des groupes sans dimension dans les prédictions à l’échelle, l’ingénieur chimiste construit généralement une usine pilote, de taille intermédiaire entre le système de laboratoire et l’usine de production à pleine échelle proposée, afin de vérifier si les prédictions de mise à l’échelle de sa théorie simplifiée fonctionnent suffisamment précisément.
Cependant, si l’ingénieur chimiste peut évaluer ses variables séparément (c’est-à-dire peut aller au fondamental), proposant ainsi une théorie suffisamment complexe mais néanmoins précise pour prédire le comportement de son système pratique compliqué, il peut éliminer l’étape de l’usine pilote, passant directement de l’étude en laboratoire à la conception et à la construction de l’usine de production à pleine échelle. Cela permet d’économiser des dépenses et du temps considérables.
Ces dernières années, la disponibilité facile des ordinateurs pour effectuer les calculs algébriques et l’utilisation répandue des méthodes de recherche opérationnelle ont rendu beaucoup plus facile pour l’ingénieur d’utiliser des corrélations mathématiques plus compliquées sur lesquelles baser ses prédictions. Cependant, cette approche est moins fondamentale qu’une théorie en chimie ou en physique qui lie des concepts précédemment non liés.
Tout comme il existe souvent plusieurs façons possibles de concevoir une expérience de laboratoire donnée en science pure (par exemple, dans la détection de particules fondamentales ou dans la synthèse d’une substance), il existe généralement de nombreuses façons possibles de concevoir une usine chimique. L’ingénieur chimiste, par exemple, concevant une usine pour produire un nouveau polymère, peut organiser la séquence requise de mélangeurs, de réacteurs, de refroidisseurs et d’autres équipements dans diverses relations spatiales les uns par rapport aux autres, et l’usine fonctionnera toujours. La conception est donc en partie un art, bien que les considérations théoriques dicteront au génie chimique moderne s’il doit, par exemple, utiliser plusieurs réacteurs chimiques en série ou un seul réacteur plus grand avec recyclage.
La société scientifique Une approche scientifique des problèmes tels que l’approvisionnement alimentaire, l’épuisement des ressources et la pollution est plus nécessaire que jamais. Les projections des tendances dans un avenir lointain sont toujours peu fiables en raison de la grande ingéniosité de l’homme à changer la tendance, grâce à son désir ou à son besoin conscient de le faire, notamment grâce à l’application de nouvelles découvertes. Qui aurait par exemple, en 1930, prédit des ordinateurs à transistors, de l’électricité à partir de centrales nucléaires ou de la pénicilline ? Qui oserait aujourd’hui prédire quels tout nouveaux dispositifs, ressources, produits chimiques, souches à haut rendement de cultures et sources d’énergie seront disponibles en 2030 ? Deviendra-t-il possible, par exemple, de modifier les bactéries dans le sol pour « fixer » l’azote atmosphérique (pour le rendre disponible aux plantes en croissance), évitant ainsi le besoin d’appliquer des engrais chimiques ?
Pendant 400 ans, l’humanité a apprécié l’effort intellectuel et les fruits matériels de l’approche scientifique ; en effet, son application à la vie quotidienne de nouvelles découvertes scientifiques a été de plus en plus rapide. Ainsi, l’homme a clairement voulu la société scientifique et est prêt à payer le prix du changement rapide, de l’incertitude et d’une certaine quantité de pollution industrielle. Dans l’ensemble, pour la plupart des gens (en particulier dans un monde de population en augmentation rapide), les avantages de la société scientifique l’emportent considérablement sur les inconvénients. Mais les inconvénients peuvent être, et doivent être, réduits à un faible niveau en les étudiant scientifiquement (9).
La liberté (par le génie et la science) vis-à-vis de la faim, du froid et des maladies dans les pays développés a donné à l’homme une nouvelle confiance et un choix, le premier choix réel depuis la fin du Moyen Âge. L’homme occidental peut maintenant décider s’il veut travailler dur pour atteindre un niveau de vie plus élevé ou profiter davantage des loisirs au niveau de vie existant. Mais même pour maintenir ce niveau de vie existant face à une population mondiale croissante, à l’épuisement des ressources et à la menace d’une pollution croissante, cela nécessitera toujours un effort soutenu de recherche en génie chimique (9, 39).
Remerciements L’auteur est reconnaissant à J. R. Harris pour son aide amicale sur l’histoire du procédé Le Blanc, et à l’Associated Octel Company pour leur intérêt et leur assistance.
Literature Cited
- Talor, Sherwood F. Cem. ln. (fA1ndon) 1937, 38-41. «
- Ellis, S. R. M.; Mohtadl, M. F. In Modern Petroleum Technology, 3rd ed.;
Inst. of Petroleum: London 1962; p. 272. - Haldon, J.; Byrne, M. Byzantinische Zeit. 1977, 70, 91-99.
- Forbes, R. J. « Short History of the Art of Distillation »; E. J. Brill: Leiden,
1948. - da Vinci, Leonardo Drawing 12660 Verso, 1509, from the Royal Library,
Windsor Castle, EnJdand. - Paracelsus « Von NaturIich Dingen »; 1527.
- Serpent cooler, according to 16th century sources, copied, for example, by
Forbes (4). - van der Straet « Nova Reperta »; distillation and sugar processing in the 16th
century.
- Davies, J. T. ‘the Scientinc Approach, » 2nd ed.; Academic: London and
New York, 1973. - Bacon, F. « Distributio Operis, » prenxed to the « Instauratio Maa »; see « The
Philosophical Works of Francis Bacon »; Robertson, J. M., Ed.; Routledge and Sons: London, 1905. - Hardie, D. W. F. « A History of the Chemical Industry in Widnes »; I. C. I.
Ltd.: Liverpool, England, 1950. - Hardie, D. W. F.; Pratt, J. D. « A History of the Modern British Chemical
Industry »; Persamon: Oxford, 1966. - Gillispie, C. C. ‘The Discovery of the Leblanc Process, » Isis 1957, 48, 152.
- Gillispie, C. C. « The Natural History of Industry, » Isis 1957, 48, 398.
- LeBlanc, N. French Patent 1791, (9) 170.
- Smith, J. G. « The Origins and Early Development of the Heavy Chemical
Industry in France »; Clarendon Press: Oxford, 1979; pp. 63-66. - Barker, T. C.; Dickinson, R.; Hardie, D. W. F. « The Origins of the Synthetic Alkali Industry in Britain, » Economica 1956, 158.
- Photographs 64/1127P and 70/756/1.
- Barker, T. C.; Harris, J. R. « A Merseyside Town in the Industrial Revolution.
St. Helens, 1750-1900″; Frank Cass & Co.: London, 1959. - Muspratt’s chemical works, Vauxhall Road, Liverpool, England, about 1830.
- Reader, W. J. « Imperial Chemical Industries, a History »; Oxford University
Press: London, 1970; Vol. I. - Firth, G. « The Northbrook Chemical Works, Bradford, 1750-1920, » Ind.
Arch. Rev. 1977, 2, 52. - Davis, G. E. « A Handbook of Chemical Engineering »; Davis Bros.: Man-
chester, 1904; Vol. II, pp. 204-207, 271-3. - Maw, W. H.; Dredge, J. Engineering (London) 1876, 21, 145-150.
- Campbell, W. A. « The Chemical Industry »; Longman: London, 1971.
- Davis, G. E. « A Handbook of Chemical Engineering »; Davis Bros.: Man-
chester, 1904; Vol. I. preface, pp. 3, 12-13. - Fleck, A. « The British Sulphuric Acid Industry, » Chern. Ind. (London) 1952,
9, 1184. - Todd, Lord « Chemistry and Agriculture, » Chem. Ind. (London) 1978, 357.
- Gray, K. R.; Biddlestone, A. J.; Clark, R. « Review of Composting, Part 3:
Processes and Products, » Process Biochem. 1973, 8 (10), 11. - M. T.D. Magazine (Midland Tar Distillers Ltd., Oldbury, Binningham) 1965,
48, 19-42. - Rothery, E. J. « Aeneas Coffey, 1780-1852, » Chern. Ind. (London) 1969,
1824. - Modern still for renning crude oil, Fawley Rennery, England, an Esso
photograph. 33. Swindin, N. « Engineering Without Wheels »; Weidenfeld and Nicholson:
London, 1962. - Swindin, N. « The George E. Davis Memorial Lecture, » Trans. Inst. Chern.
Eng. 1953, 31, 187. - Lewis, W. K. Chem. Eng. Prog. 1958, 54(5), 51.
- Peck, W. C. « Early Chemical Engineering, » Chem. Ind. (LondofJ,) 1973, 511.
- Tailby, S. R. « Chemical Engineering Education Today, » C hem. Ind.
(London) 1973, 77. - Davies, J. T. « Turbulence Phenomena »; Academic: New York, 1972.
- Davies, J. T. « Energy and the Environment: Educational Needs, » in « Energy
and the Environment »; Walker, J., Ed.; University of Binningham:
England, 1976.
RECEIVED May 7, 1979.
Concept et Obstacles Institutionnels à l’Émergence des Opérations Unitaires en Europe JEAN-CLAUDE GUÉDON
L’établissement d’une discipline telle que le génie chimique dépend d’un processus complexe de négociations entre les universités, les associations d’ingénieurs et les industries. Aux États-Unis, les universités ont profondément réorganisé leurs programmes autour des opérations unitaires, et les ingénieurs chimistes se sont facilement intégrés à l’industrie. En Allemagne, au contraire, les industries ont réorganisé leur division du travail et formé des équipes de chimistes avec des ingénieurs. En Grande-Bretagne et en France, les industries chimiques n’ont jamais réussi à formuler clairement leurs besoins. Les établissements d’enseignement cherchaient à se servir eux-mêmes et non l’industrie. Ainsi, les caractéristiques institutionnelles ont orienté chacun de ces pays dans des directions différentes de celle des États-Unis. De plus, en Allemagne, un schéma conceptuel alternatif a occupé une place fonctionnellement similaire à celle des opérations unitaires aux États-Unis.
La notion d’opération unitaire est une réalisation entièrement américaine. Elle représente également une solution entièrement originale à de nombreux problèmes auxquels sont confrontées les industries chimiques. Dans une autre œuvre (1), nous avons tenté de montrer que cette notion d’opération unitaire n’est pas le résultat du génie créatif d’A. D. Little, mais le produit d’un processus compliqué impliquant les industries chimiques, les établissements éducatifs et les organisations professionnelles. En effet, on peut soutenir, et c’est ce que nous avons essayé de faire, que les industries, les universités et les associations d’ingénieurs ont négocié tacitement, et ce, quelle que soit la source de force sur laquelle ils pouvaient compter. La notion d’opérations unitaires – et nous supposons que cette notion est familière aux lecteurs de ce chapitre – peut alors être abordée comme un principe organisateur incorporant les compromis inhérents au processus de négociation mentionné précédemment. En particulier, les opérations unitaires, au moment de leur création, n’avaient pas de rival en tant que stratégie de gestion réussie. Comme l’a déclaré David Noble, A. D. Little avait fait pour la chimie industrielle ce que Taylor avait fait pour les ingénieurs mécaniciens (2). En fait, les principes de la gestion scientifique, en particulier ceux liés à une redistribution de la division du travail le long de lignes modulaires, semblent avoir profondément influencé la conception d’A. D. Little lorsqu’en 1915, il a défini les opérations unitaires.
Pendant ce temps, en Europe, les événements se déroulaient très différemment. Si l’on examine la période allant approximativement de 1800 à 1925, on constate que chaque grande nation européenne – à savoir la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne – a connu un processus de négociations affectant le développement de ses industries chimiques, tout comme les États-Unis. Cependant, les partenaires, pour ainsi dire, impliqués dans ces négociations, bien que similaires dans leur nom, étaient assez différents dans leur nature. Les industries chimiques britanniques différaient sensiblement de leurs homologues allemandes et significativement de leurs concurrents français. De même, les systèmes éducatifs et les organisations professionnelles étaient très différents d’un pays à l’autre.
La thèse de ce chapitre est simple à énoncer, même si elle est difficile à démontrer : les principes organisateurs guidant les industries chimiques européennes ont évolué de manière très spécifique en fonction des frontières nationales. En conséquence, chaque pays est parvenu à une sorte de modus vivendi qui s’est maintenu tant que la concurrence internationale est restée sur un plan commercial. Lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté, cependant, seule l’Allemagne pouvait se satisfaire des principes fondamentaux qui formaient la base de ses industries chimiques, tandis que la Grande-Bretagne et la France devaient faire face au fait que leurs industries chimiques cachaient des faiblesses organisationnelles profondes.
Dans le reste de ce chapitre, nous tenterons d’identifier les partenaires significatifs dans ce processus de négociation que nous considérons comme central pour comprendre l’évolution des industries chimiques en Grande-Bretagne, en France et en Allemagne. Pour des raisons de clarté, nous limiterons l’utilisation du terme « génie chimique » au processus unique de négociation menant à la notion d’opérations unitaires aux États-Unis. Dans le cas de l’Europe, où des processus de négociation différents ont eu lieu, nous utiliserons l’expression « chimie industrielle » jusqu’à ce que le modèle américain soit adopté. Nous le ferons même si des titres tels que « ingénieurs chimistes » ou son équivalent allemand ont été utilisés dans les trois pays concernés. En soutenant que les industries chimiques européennes ont évolué chacune selon des lignes spécifiques, nous espérons montrer que la solution fournie par la notion d’opérations unitaires aux industries chimiques américaines ne pouvait pas émerger en Europe.
Le Cas de la Grande-Bretagne
Aussi récemment qu’en 1962, D. W. F. Hardie écrivait des lignes qui révélaient beaucoup sur l’une des tendances durables des industries chimiques britanniques : (Il est à noter que dans le texte original, certaines parties du texte sont manquantes ou présentent des caractères étranges. J’ai conservé le texte tel quel, en fournissant la meilleure traduction possible.)
« Il a été largement et facilement supposé que l’augmentation de l’échelle et de la complexité de ses opérations, ainsi que l’application considérablement accrue et croissante de données et de méthodes scientifiques, ont transformé la technologie chimique en quelque chose de différent de ce qu’elle a été jusqu’à présent. … Les aspects opérationnels et procéduraux de la technologie chimique sont toujours menés dans la tradition empirique que j’ai cherché à définir et à exemplifier » (3).
Curieusement, l’accent mis par Hardie sur le côté empirique de la technologie chimique et sa minimisation des éléments scientifiques qui composent le génie chimique moderne rappellent des échos lointains des débats houleux qui ont eu lieu en Grande-Bretagne à la fin du XIXe siècle et au cours des premières décennies du XXe siècle.
Pendant de nombreuses années, la Grande-Bretagne avait été en tête dans le domaine des industries chimiques, comme elle l’avait été dans pratiquement tous les autres aspects de la vie industrielle. Les Tennants et les Muspratts, pour ne citer que quelques noms, avaient conçu la production industrielle à grande échelle de la poudre de blanchiment et de la soude (4, 5, 6, 7). Assez rapidement et, en tout cas, d’ici les années 1850, la Grande-Bretagne avait monopolisé le marché de ce qui allait être appelé les produits chimiques lourds, c’est-à-dire l’acide sulfurique, la soude, la poudre de blanchiment, et autres. Par le biais de manœuvres qui n’ont jamais été racontées en détail, la Grande-Bretagne a réussi à déplacer les industries chimiques françaises de leur position dominante et a commencé à conquérir de nouveaux marchés, tels que le marché en expansion rapide des États-Unis (8).
Dans l’ensemble, cette croissance de l’industrie chimique lourde s’est produite sans faire référence à des découvertes scientifiques ou même à une formation. Le personnel, dans l’ensemble, apprenait ce dont il avait besoin sur place, et l’évolution de l’industrie, bien que rapide, était assez progressive pour permettre aux contremaîtres et aux techniciens internes non seulement de s’adapter mais même de contribuer à son progrès. Ces améliorations n’impliquaient rarement des changements chimiques ; le progrès prenait plus souvent la forme de nouveaux récipients et machines, de lots plus importants, et ainsi de suite. Pourtant, ils étaient essentiels tant que la concurrence entre les entreprises prenait la forme simple de vendre des quantités toujours plus importantes de produits à des prix toujours plus bas. Par exemple, la transition du soufre de Sicile à la pyrite qui a eu lieu vers 1830-40 était importante pour la fabrication de l’acide sulfurique. Cependant, elle s’est produite de manière désordonnée (9) et l’amélioration cruciale a pris la forme d’un bon dispositif de torréfaction nécessaire pour extraire le soufre, et non d’un nouveau processus chimique. En d’autres termes, le progrès avait beaucoup plus à voir avec la conception de nouveaux équipements qu’avec l’invention de nouveaux processus chimiques.
À un niveau plus fondamental, il est facile de voir que les industries chimiques posaient problème aux Anglais dans la mesure où elles ne pouvaient pas être facilement intégrées dans leur compréhension récemment acquise des « fabrications mécaniques ». Les industries chimiques ne respectaient pas les principes régissant l’organisation ou la mécanisation des fabrications mécaniques. En 1835, Andrew Ure, lui-même chimiste, déclara clairement pourquoi cela était le cas : « Une fabrication mécanique étant complètement occupée par une substance, qu’elle conduit à travers des métamorphoses en succession régulière, peut être rendue presque automatique ; alors qu’une fabrication chimique dépend du jeu d’affinités délicates entre deux ou plusieurs substances, qu’elle doit soumettre à la chaleur et au mélange dans des circonstances quelque peu incertaines, et doit donc rester, dans une certaine mesure, une opération manuelle » (10).
Ure n’était pas seul à faire une exception des industries chimiques. Babbage maintenait également cette distinction. Cependant, Babbage s’intéressait au fait que les industries en général pouvaient bénéficier de l’apport de la science et, de manière quelque peu curieuse, utilisait la chimie pour étayer son argument, qu’il entendait être valable pour toutes les fabrications.
« La méthode actuellement pratiquée, bien que non mécanique, est un exemple remarquable de l’application de la science aux fins pratiques de la fabrication, à tel point qu’en mentionnant les avantages découlant de la réduction des opérations naturelles, il aurait été à peine pardonnable d’omettre toute allusion à la belle application du chlore, en combinaison avec la chaux, à l’art du blanchiment » (11).
À la fois Ure et Babbage peuvent être considérés comme de justes représentants des préoccupations théoriques britanniques concernant l’organisation et la gestion des industries. En tant que tels, ils exposent les difficultés inhérentes aux industries chimiques. En particulier, comment pouvaient-ils bénéficier de l’intervention de l’homme de l’art, bientôt devenu ingénieur (12) ? Quant à la science, son rôle au sein des industries chimiques devait rester minime en Grande-Bretagne pendant la plus grande partie du XIXe siècle, et, comme l’avait souligné Babbage, la poursuite de la science devait être l’apanage des hommes riches, probablement fils de fabricants, cherchant un statut intellectuel à travers cette facette nouvellement respectée de la haute culture (13). C’est en fait exactement ce qui est arrivé à James Sheridan et Edmund Knowles Muspratt (14). Et la science pouvait être perçue comme une source de richesse par Perkin, le créateur de l’industrie des colorants synthétiques, mais il ne faut pas oublier que Perkin a vendu son entreprise dès qu’il a gagné assez d’argent pour poursuivre ses propres recherches en chimie « pure » (15).
Compte tenu de cette situation, le processus britannique de négociations affectant le développement des industries chimiques n’impliquait qu’un seul participant réel vers 1880, ou plus exactement un acheteur : l’industriel. Les scientifiques et les ingénieurs n’avaient pas l’air très attractifs pour ce seul acheteur, et par conséquent, ils ne pouvaient pas demander grand-chose même s’ils avaient été en mesure d’imaginer ce qu’ils devraient demander en premier lieu. Mais cela était à peine le cas, car les organisations professionnelles britanniques commençaient tout juste à émerger à cette époque et étaient largement sous le contrôle des fabricants, et non des praticiens. (G. E. Davis, l’un des promoteurs de la Society of Chemical Industry, aurait aimé voir le terme « Ingénieur chimiste » utilisé dans le titre, mais il a finalement cédé au titre du fabricant.) Les fabricants étaient aux commandes et entendaient le rester.
D. S. L. Cardwell a habilement esquissé cette situation dans une sorte d’expérience de pensée qui vaut la peine d’être reproduite ici : « Pour résumer la situation atteinte, imaginons (dans l’imagination) un fabricant de (disons) 1880. Supposons qu’il soit un homme progressiste, un partisan du mouvement d’éducation technique et du nouveau collège universitaire. … Il favorisera une éducation étendue pour toutes les classes et peut même avoir de bonnes idées sur l’éducation secondaire. Mais si on lui demande pourquoi il n’utilise pas la science – la recherche – et les scientifiques dans son entreprise, il pourrait bien répondre dans les lignes suivantes : ‘l’idée d’employer des scientifiques dans l’industrie est absurde, tout comme Mme Schumann pour enseigner le piano à mes filles. Un homme de science ne peut être contraint à suivre un chemin prescrit ; il ne peut pas produire une découverte sur commande, et il n’est pas souhaitable qu’il soit censé le faire. … De plus, nous savons que même si de grands avantages découlent de la science, il peut s’écouler de nombreuses années avant que de telles découvertes ne soient utiles, et même ainsi, nous ne pouvons pas prédire exactement à quoi elles serviront » (17).
Le fabricant industriel hypothétique de Cardwell a probablement besoin de quelques nuances, mais en tant que capsule d’une tendance générale, il semble assez convaincant. L’émergence, vers 1880, du soi-disant « Mouvement d’endowment of Research » apporte des preuves à l’appui de l’effort imaginatif de Cardwell. Le soutien à la recherche, à cette époque, ne signifiait pas le soutien à la recherche appliquée ; au contraire, il favorisait la science « pure », avec pour résultat que les bourses d’État contribuaient effectivement à biaiser la poursuite de la science en insérant « un coin entre les érudits (qui choisissaient généralement la recherche académique) et le reste qui se contentait souvent de postes dans l’industrie » (18, 19).
Il semble que l’industriel imaginaire de Cardwell doit voir son image quelque peu modifiée, comme l’indique Cardwell lui-même. « Blâmer l’industriel », écrit-il, « pour ne pas apprécier la science et la recherche à une époque où les institutions d’enseignement supérieur du pays faisaient peu pour encourager le travail original, était à la fois injuste et stupide » (20). Il est soutenu en cela par les historiens de l’éducation technique anglaise, Michael D. Stephens et Gordon W. Roderick (21). En fait, il ressort clairement des archives que les industriels en général, et les fabricants de produits chimiques en particulier, cherchaient à faire quelque usage du personnel techniquement formé. Cependant, cela impliquait plusieurs difficultés majeures. À titre d’exemple, examinons ce qu’Edmund K. Muspratt écrivait dès 1870 :
» Ayant tant de nouveaux procédés en cours, j’ai pensé qu’il était conseillé d’engager un chimiste bien éduqué comme chef du laboratoire à Widness. Il était difficile de trouver à cette époque un homme convenable en Angleterre, et en Allemagne, en raison de la guerre, qui avait emmené tant de jeunes hommes au service de l’armée, il était difficile de trouver un jeune chimiste disposé à venir dans ce pays. Après quelques correspondances avec le professeur Knapp du Brunswick Polytechnic, j’ai engagé un Dr. Jursich, qui avait été éduqué à Berlin » (22).
Dans le même ordre d’idées, il faut se rappeler que l’organisation de la Society of Chemical Industry avait été poussée en 1881 par les industriels de Merseyside et que le motif derrière cette démarche était d’examiner « quelles mesures pourraient être prises pour rapprocher les chimistes scientifiques professionnels de ceux engagés dans l’industrie » (23).
Une décennie plus tard, lorsque les succès industriels allemands ne pouvaient plus échapper à l’attention de quiconque et que 45 entreprises de soude, sous pression, se réorganisèrent collectivement pour former l’United Alkali Company, l’une des premières conséquences de cette énorme fusion fut la création d’un laboratoire central (24). En bref, on ne peut pas condamner grossièrement les industriels britanniques pour leur indifférence à la science. Comme le déclare Cardwell, « la raison d’une telle condamnation semblait résider dans la croyance qu’une ‘demande’ de science devrait d’une manière ou d’une autre émaner de la masse hétérogène de l’industrie » (25, 26). Il y a de la profondeur dans sa remarque, car, en effet, ni la forme ni le contenu de cette demande ou de cette science ne peuvent être censés préexister au contexte historique spécifique d’où elle est sur le point d’émerger. En effet, tant la demande que la science devaient être inventées et les inventeurs devaient être les personnes même qui pouvaient d’une manière ou d’une autre penser à une manière d’intégrer les demandes multifacettes et souvent conflictuelles de nombreuses industries en une seule voix. De plus, il était nécessaire de réinterpréter cette demande synthétique en termes de programmes d’études afin de les rendre compréhensibles aux établissements d’enseignement. Enfin, pour compliquer encore les choses, ces établissements d’enseignement étaient presque aussi variés que les industries elles-mêmes et n’étaient pas nécessairement intéressés à regarder favorablement l’appel à l’aide de l’industrie. Pas étonnant, donc, que tant de personnes et tant de commissions royales se soient concentrées sur les problèmes de l’éducation technique (par exemple, 1868, 1872-1875, 1882-1884, 1889, 1891, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898 et 1902) (27, 28). Pas étonnant non plus que les industriels eux-mêmes aient pris des initiatives pour tenter de répondre à leurs besoins, et les Muspratt, une fois de plus, fournissent un exemple prêt de l’une des voies possibles que les fabricants pouvaient suivre : ils ont créé leur propre établissement d’enseignement qui est finalement devenu le Royal College of Chemistry (29).
Intégrer du personnel scientifiquement formé au sein d’une industrie qui ne les avait jamais utilisés nécessitait rien de moins que la refonte de la division du travail impliquée dans son processus productif. Non seulement une telle refonte devait laisser place à la connaissance scientifique, mais, plus important encore, elle devait incorporer une certaine notion de la relation prévalant entre la théorie et la pratique. En bref, beaucoup de choses devaient être inventées. Maintenant, la Grande-Bretagne se trouvait dans la position particulière de posséder une industrie chimique qui, tout en étant encore la plus grande du monde jusqu’à la fin du XIXe siècle, présentait également de nombreux signes de vieillesse et d’obsolescence. La croissance des industries chimiques britanniques n’était pas le résultat d’une impulsion technique, pour ainsi dire ; au contraire, elle n’était que la conséquence du fait que la Grande-Bretagne avait connu sa révolution industrielle plus tôt et à une plus grande échelle que quiconque. Grâce au puissant développement des manufactures mécaniques, les œuvres chimiques devaient répondre à une demande largement basée. Les industries textiles étaient des consommateurs avides de matériaux de teinture et de blanchiment ; la fabrication du verre nécessitait de grandes quantités de soude qui, à son tour, générait une énorme demande d’acide sulfurique. On peut donc dire que le développement de l’industrie chimique britannique est en grande partie dû au mouvement général vers l’industrialisation et qu’il est apparu comme une sorte d’annexe à cela. Peu étonnant, donc, que des hommes comme Ure et Babbage ne puissent pas incorporer les industries chimiques dans leurs discussions théoriques sur la fabrication.
Avec l’avènement des colorants synthétiques, l’industrie chimique britannique, comme toute autre, a dû assimiler le fait que désormais, la chimie en tant que connaissance doit d’une manière ou d’une autre être incorporée dans les industries chimiques. La concurrence avait changé. Elle impliquait désormais l’innovation comme un facteur majeur. Une nouvelle forme de processus de production devait être inventée. À cet égard, les avantages traditionnels des industries chimiques britanniques n’étaient plus suffisants. Elle disposait de matières premières bon marché sous forme d’approvisionnements abondants en goudron de houille. Elle avait du capital et contrôlait le marché le plus riche du monde. Mais elle n’avait pas beaucoup de la nouvelle ressource, à savoir les cerveaux chimiquement formés d’hommes capables. Ce n’était pas non plus le seul inconvénient des industries chimiques britanniques. Leur taille même s’est avérée néfaste au changement de trois manières au moins. Premièrement, se référer aux succès passés et aux exemples antérieurs de compétition étrangère repoussée ne pouvait aider la cause conservatrice prônant davantage de la même chose. Il s’est avéré insuffisant pour faire face à la concurrence des nouveaux procédés de production qui émergeaient en même temps en Allemagne. La deuxième cause est peut-être un peu plus insaisissable, mais peut être formulée comme suit : les expositions industrielles internationales, à commencer par l’initiative londonienne de 1851, ont rapidement conduit à des comparaisons statistiques directes de toutes sortes entre les pays. En conséquence, la nation britannique pouvait périodiquement observer qu’elle perdait du terrain face aux industries de colorants allemandes, mais le déclin relatif de l’ensemble de l’industrie chimique britannique était beaucoup moins dramatique, de sorte que la fierté nationale, même si elle était blessée dans un secteur particulier, pouvait trouver du réconfort dans le fait que les chiffres globaux témoignaient toujours de la supériorité de l’Angleterre. Peu est nécessaire pour restaurer un sentiment de complaisance chez un peuple, n’importe lequel. Enfin, et surtout, la taille des industries chimiques britanniques et leur structure signifiaient qu’il fallait un certain temps avant que les investissements puissent être récupérés. Cependant, la Grande-Bretagne n’a jamais souffert d’un manque de Cassandres qui, assez sensiblement, ont utilisé l’exemple allemand pour essayer de secouer l’apathie britannique. C’est dans ce contexte qu’un deuxième coupable est souvent identifié, à savoir l’éducation (30). Mais accuser l’éducation britannique n’est pas mieux qu’accuser les industries britanniques. Ce n’est pas faux, mais cela ne peut pas expliquer à lui seul le malheur des industries chimiques britanniques. Un bon exemple de cette thèse est fourni par le livre d’Edwin Williams, Made in Germany, qui est apparu pour la première fois en 1896. La réaction à ce livre a été très violente et il a même été discuté dans la presse française (31). Plaçant la faute carrément sur l’éducation britannique, Williams est allé jusqu’à dire que, comparé à ce qui existait en Allemagne, c’était comme une bougie à une ampoule électrique (32). D’autres statistiques frappantes sont arrivées lors de la réunion de 1902 de la British Association for the Advancement of Science. Une enquête auprès des chimistes industriels avait été répondue par 502 personnes, parmi lesquelles seuls 107 étaient diplômés, et parmi ceux-ci, seuls 59 avaient étudié en Grande-Bretagne (33). Même si l’on multipliait les chiffres par trois, comme l’a fait Dewar dans un accès d’optimisme non étayé, on n’obtenait que 1 500 chimistes dans les industries britanniques alors que l’Allemagne, à la même époque, en employait au moins 4 000 dans ses industries. De plus, 84 % des chimistes allemands étaient diplômés, tandis que le chiffre correspondant pour la Grande-Bretagne s’élevait seulement à 34 % (34, 35).
Cependant, tout cela n’est pas suffisant pour inculper l’éducation seule. Dans les années précédant la Première Guerre mondiale, l’enseignement supérieur a connu une croissance très rapide et le nombre de diplômés en sciences a augmenté considérablement (36). Cependant, l’augmentation du nombre de scientifiques appliqués n’a pas suivi le même rythme (37) ; au contraire, la grande majorité des diplômés en sciences se percevaient comme des futurs enseignants, soit au niveau primaire, soit au niveau secondaire (38). En fait, Cardwell estime qu’en 1913-1914, « le nombre total d’étudiants de troisième cycle dans les collèges bénéficiant d’une aide gouvernementale qui étudiaient pour des examens supérieurs ou effectuaient des recherches en sciences était de 172 en Angleterre et 17 au pays de Galles » (39).
L’idée générale de toutes ces données est claire : vers 1910 environ, l’éducation britannique formait de nombreux diplômés en sciences, bien que cela ne semble pas suffisant pour satisfaire les besoins des écoles secondaires en expansion rapide. De toute évidence, ces diplômés en sciences auraient pu envisager de faire carrière dans l’industrie, mais apparemment très peu l’ont fait ; ils n’ont pas non plus beaucoup cherché à obtenir des diplômes de recherche supérieurs. Pour des raisons qui ne seront pas élucidées ici, ils se sont tournés vers l’enseignement.
En résumé, il n’est pas faux de dire que l’industrie n’a pas fait de très grandes demandes de diplômés en sciences. Malgré quelques exceptions notables – et E. K. Muspratt a été cité plus tôt dans ce contexte – les industries semblent être restées satisfaites d’une faible contribution technique du personnel formé. Inversement, il n’est pas faux non plus de mettre la faute sur l’éducation britannique ou sur son absence. Cependant, lorsque les diplômés en sciences sont enfin apparus en grand nombre, c’était en réponse non pas aux demandes de l’industrie, mais plutôt aux besoins d’un système éducatif en expansion rapide. Par conséquent, chaque accusation constitue au mieux une demi-vérité. Chacune, en soi, ne résout pas le problème en question.
La solution, à notre avis, dépend de cette question de la division du travail qui a déjà été soulevée précédemment. De toute évidence, les industriels ne sont pas a priori opposés à l’intégration de personnel formé dans leur fabrication, surtout s’il peut être démontré que cela augmentera leurs profits. Comme cela était le cas au XIXe siècle, ils n’étaient pas convaincus qu’ils devaient le faire. Et s’ils n’étaient pas convaincus, c’est parce qu’ils ne savaient pas exactement ce qu’ils voulaient ou ce dont ils avaient besoin. Caractéristiquement, c’est peut-être dans la fabrication chimique que l’introduction de personnel scientifiquement formé est allée le plus loin. Mais ce qui est remarquable dans cette tendance – une tendance, soit dit en passant, qui est loin d’être clairement marquée – c’est qu’elle copie un modèle, celui de l’Allemagne. Non seulement les fabricants de produits chimiques britanniques copient l’organisation des industries allemandes (lorsqu’ils décident de changer du tout), mais, comme nous l’avons vu, ils achètent même leur personnel en Allemagne, sous la forme d’Allemands (ou Suisses) qui déménagent en Grande-Bretagne, ou sous la forme de diplômes obtenus par des Britanniques allant étudier en Allemagne. En bref, les industries britanniques avaient tendance à se modeler sur l’Allemagne (que nous examinerons plus tard) chaque fois que leur structure productive était analogue à celle des industries allemandes dominantes. Mais elles le faisaient avec des retards et des hésitations et parfois seulement à moitié. Il faut se rappeler que la Grande-Bretagne a eu beaucoup de mal à passer du procédé Le Blanc au procédé Solvay et que l’United Alkali Company formée en 1891 s’est avérée être un véritable dinosaure lorsqu’elle a tenté de sauver le procédé Le Blanc à un moment où la plupart du continent était passé à la méthode Solvay supérieure pour produire de la soude. La création d’un laboratoire central n’était pas suffisante pour conjurer le désastre (40).
Il ne faut pas beaucoup de réflexion pour comprendre pourquoi les industries britanniques devraient rencontrer de telles difficultés : la situation n’est pas spécifique à la Grande-Bretagne. Comme la plupart des organisations humaines, les industries chimiques ont du mal à surmonter leur propre inertie organisationnelle et lorsqu’elles doivent le faire, elles trouvent plus facile de copier quelqu’un d’autre que d’inventer quelque chose de nouveau. Cependant, copier comporte toujours des risques, ne serait-ce que parce que l’emprunteur doit évaluer si la situation locale est suffisamment analogue à celle prise comme modèle pour assurer un transfert réussi.
C’est à ce niveau que la nature des industries chimiques britanniques devient cruciale. Comme nous l’avons noté précédemment, c’était une industrie de produits chimiques lourds dont la croissance avait été stimulée par la première révolution industrielle. Dans l’ensemble, elle nécessitait très peu d’apports scientifiques et tout apport technique nécessaire provenait principalement d’ingénieurs mécaniciens. Les industries britanniques de colorants, lorsqu’elles ont commencé, ont tenté d’étendre le modèle bien connu des produits chimiques lourds. Perkin, par exemple, semble avoir été la seule source d’idées pour sa propre entreprise, démontrant ainsi à quel point il comprenait alors peu le rôle de la connaissance scientifique dans ce qui serait plus tard appelé les industries basées sur la science. Mais cela n’est pas surprenant. Ce qui est surprenant, c’est qu’une conception des industries basées sur la science a émergé ailleurs – à savoir en Allemagne – et est rapidement venue menacer les nouvelles industries britanniques de colorants. Au moment où la leçon avait été assimilée, les fabricants de colorants allemands avaient pris une avance si importante que les industries britanniques, dans l’ensemble, étaient évincées du marché ou parvenaient tout juste à survivre. En tout cas, elles n’étaient guère en position d’expérimenter de nouvelles divisions du travail.
Assez a été dit maintenant pour fournir un cadre approprié à la question qui se pose, à savoir quels facteurs ont façonné le génie chimique britannique de manière à empêcher son évolution comme son homologue américain ? Nous pouvons maintenant passer à l’épilogue de cette histoire, qui nous conduit juste après la Première Guerre mondiale, à une époque où les chimistes industriels britanniques avaient pris toute la mesure de leurs lacunes.
L’Institution of Chemical Engineers est apparue en Grande-Bretagne seulement en 1922, soit quatorze ans après sa grande sœur américaine. C’était bien une association sœur, car des liens étroits ont été établis entre les deux sociétés dès le début :
… un membre de l’une des institutions devrait avoir la qualité de membre privilégié de l’autre lorsqu’il se trouvait dans le pays de cette dernière, et aussi … un membre de l’une des institutions devrait recevoir les publications des deux » (41).
Certaines des discussions qui ont suivi la création de cette nouvelle société professionnelle méritent d’être racontées car elles révèlent l’état d’incertitude qui régnait encore en Grande-Bretagne en 1922 concernant la définition et le statut d’un ingénieur chimiste. Tout comme l’AIChE, l’Institution of Chemical Engineers s’est immédiatement concentrée sur les questions éducatives (42). Les problèmes de définition liés aux questions éducatives devaient être résolus : cela était évident pour tout le monde.
« Beaucoup de fois, au cours de la brève existence de l’Institution, le Conseil a tenté de décrire un ingénieur chimiste. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu’un ingénieur chimiste en tant que tel n’existe pas vraiment aujourd’hui » (43).
Il convient de noter qu’à la réunion inaugurale du 2 mai 1922, une définition de l’ingénieur chimiste avait été adoptée, qui, rétrospectivement, semble si large qu’elle pourrait inclure presque n’importe qui :
« Un ingénieur chimiste est un professionnel expérimenté dans la conception, la construction et l’exploitation d’installations où les matériaux subissent un changement chimique ou physique » (44).
Il est tout à fait évident que les aspirants ingénieurs chimistes en Grande-Bretagne n’avaient qu’une vague idée de ce qu’ils étaient ou voulaient être. Il n’est donc pas étonnant que les Anglais réagissent si positivement à l’apparition des célèbres Principes du génie chimique de Walker, Lewis et McAdams : « Il semble que les États-Unis soient bien en avance sur ce pays dans l’étude du génie chimique. Le livre examiné en est la preuve » (45).
La guerre, bien sûr, avait propulsé les Américains au premier plan, et déjà en 1916, certains disaient que les États-Unis « . . . développaient la formation et la production d’ingénieurs chimistes à une échelle énorme » (46, 47).
Le fait que la nouvelle Institution se tournait beaucoup vers les États-Unis peut être démontré facilement en soulignant qu’en 1925, une délégation américaine de l’AIChE a été invitée à rendre visite à ses collègues anglais. Charles L. Reese, le chef de la délégation américaine, a même prononcé le discours présidentiel de cette année-là. Au cours de ce discours, il a abordé la question de la définition de l’ingénieur chimiste et a ainsi souligné l’importance des opérations unitaires pour son public britannique.
« Nos amis du Massachusetts Institute of Technology ont peut-être fait plus que quiconque pour établir l’idée de ce qu’est un ingénieur chimiste, et leur idée est qu’un ingénieur chimiste est quelqu’un qui comprend, sait et a appris les principes des processus élémentaires tels que la distillation, la filtration, la précipitation, l’écoulement des gaz et des liquides, la transmission de la chaleur, et ainsi de suite » (48).
Reese a ensuite décrit plusieurs documents bien connus des historiens de l’ingénierie américaine, tels que le rapport d’A. D. Little sur l’éducation préparé en 1922 et l’article de R. T. Haslam sur The School of Chemical Engineering Practice du Massachusetts Institute of Technology. Dans l’ensemble, l’Institution basée à Londres ne pouvait plus prétendre ignorer les développements américains, et en fait, les ingénieurs chimistes britanniques allaient bien au-delà de simplement reconnaître leur familiarité avec le modèle américain. Dans sa réponse, Sir Arthur Duckham a déclaré catégoriquement :
« Nous, dans notre institution, avons pris l’Institut américain comme modèle » (49).
Dans un sens, cette déclaration peut mettre fin à la première partie de notre analyse, car elle montre qu’en 1925, les ingénieurs chimistes britanniques avaient reconnu la supériorité du génie chimique américain et, vraisemblablement, faisaient tout leur possible pour promouvoir les opérations unitaires dans leur propre pays. Dans le même temps, cela montre que la Grande-Bretagne n’avait pas été capable de construire une telle notion elle-même, malgré le choc provoqué par la Première Guerre mondiale et les perspectives claires qu’elle offrait sur l’état arriéré des industries chimiques britanniques. En conséquence, le changement en Grande-Bretagne a pris la forme d’un emprunt : après avoir été tentée par le modèle allemand, la Grande-Bretagne a finalement opté pour son rival américain. Montrer comment ce modèle américain est parvenu à dominer en Grande-Bretagne est une autre histoire qui va bien au-delà des ambitions de ce chapitre particulier.
Le cas de la France L’évolution de la chimie industrielle en France est tout aussi intéressante que celle de la Grande-Bretagne. Les Français ne savaient pas mieux que les Britanniques comment intégrer les connaissances scientifiques dans les industries chimiques, et la solution qui finirait par l’emporter dans ce pays résulterait également de l’interaction complexe de facteurs locaux. Une fois de plus, la nature des industries chimiques françaises et celle des établissements éducatifs allaient jouer un rôle important dans la formation des ingénieurs industriels dans ce pays (50).
De tous les pays européens, la France a indéniablement été la première à initier une éducation technique à grande échelle. Sans remonter au XVIIIe siècle, qui avait tout de même été le témoin de l’émergence d’écoles d’ingénieurs telles que Ponts-et-Chaussées, la création de l’École Polytechnique pendant la période révolutionnaire avait fourni un modèle qui serait envié et imité dans toute l’Europe pendant plusieurs décennies (51, 52, 53). Au cours du XIXe siècle, la France a construit un système remarquable de Grandes Écoles qui sont restées le socle de son enseignement technique jusqu’à ce jour. Outre les deux écoles déjà mentionnées, on peut ajouter l’École des Mines, l’École Centrale des Arts et Manufactures et, à un niveau quelque peu inférieur, le Conservatoire des Arts et Métiers.
À première vue, il semble que la France, contrairement à la Grande-Bretagne, avait résolu le problème de la formation de son personnel technique. Cependant, un examen plus approfondi révèle une situation un peu plus complexe. Un pamphlet appelant à la création d’une école de chimie pratique et industrielle publié par la Société Chimique de Paris est paru en 1891 (54). Bien qu’il vise clairement à convaincre les autorités et soit donc assez partial, ce document fournit néanmoins un portrait intéressant des activités françaises en chimie appliquée dans la dernière décennie du XIXe siècle. Sa caractéristique la plus frappante est l’accusation qu’il porte à l’encontre des Grandes Écoles, en particulier de l’École Polytechnique :
« L’École Polytechnique qui, depuis ses débuts, et en raison des besoins de l’époque, a été détournée de son objectif premier, a toujours été une école pour les sciences théoriques » (55).
L’auteur anonyme de ce pamphlet procède ensuite à un examen des ressources existantes à Paris. Le Conservatoire des Arts et Métiers enseigne la chimie industrielle, mais seulement sous forme de cours et sans possibilité de pratique (56). De même, l’École Centrale, bien que le produit d’une initiative prise par des industriels, est rapidement devenue la rivale de Polytechnique. En conséquence, elle s’est tournée vers les sciences théoriques (57). Le cas de Centrale est assez instructif pour une autre raison. Pendant de nombreuses années, elle a diplômé des ingénieurs avec des titres tels qu’ingénieur chimiste, ingénieur mécanicien, mais la valeur de ces titres distinctifs peut rapidement être évaluée par le fait que tous les étudiants diplômés passaient le même examen final, quel que soit leur prétendu domaine de spécialité.
Quant à l’École Municipale de Physique et Chimie Industrielles, récemment créée et financée par le conseil municipal de Paris, notre auteur soutient qu’elle forme des chimistes pour le laboratoire plutôt que pour l’industrie (58) : il n’avait peut-être pas tout à fait tort quand on constate que Pierre Curie y enseignait et que Langevin y étudiait avant de commencer un doctorat (59). Enfin, et de manière assez ironique, le seul endroit où l’on pouvait obtenir une formation sérieuse en chimie appliquée et théorique à Paris était à l’école de pharmacie. Mais, hélas, l’orientation de cette école avait très peu à voir avec l’industrie, comme on pouvait s’y attendre (60).
Du côté des facultés, qui ont été réorganisées en universités seulement en 1896 (61), peu de choses avaient eu lieu. Entre 1835 et 1839, en moyenne, seuls 49 étudiants obtenaient une Licence ès sciences chaque année ; presque 30 ans plus tard, ce chiffre n’avait pas encore doublé, et ce n’est qu’environ en 1885-1889 que le nombre de diplômés en sciences a considérablement augmenté pour atteindre une moyenne annuelle totale de 351. Cependant, même ce chiffre est faible lorsque l’on considère qu’il représente la capacité de formation d’une grande nation dans toutes les sciences (62).
Malgré des débuts peu prometteurs, ce sont finalement les universités qui ont connu des développements intéressants. Ce revirement inattendu des événements était le résultat d’une interaction complexe de facteurs institutionnels, comme nous le verrons.
En examinant le système éducatif français, il ne faut jamais oublier qu’il obéit à des règles hiérarchiques strictes. En matière technique, il est clair que Polytechnique et Centrale étaient les deux écoles supérieures. L’accès à ces écoles se faisait par des concours ouverts aux étudiants qui, après avoir terminé leur lycée et réussi le baccalauréat, se préparaient à ces concours dans des classes préparatoires. La forme de ces concours d’entrée rigoureux est extrêmement importante car elle mettait l’accent sur certains secteurs de connaissances scientifiques au détriment d’autres. En particulier, les futurs ingénieurs de Polytechnique et de Centrale étaient (et le sont toujours) soumis à des doses de mathématiques abstraites probablement inégalées nulle part ailleurs sur terre pour des scientifiques appliqués. La physique, enseignée de manière très formalisée, bénéficiait également d’un bon degré de prestige. En revanche, la chimie, en raison de son faible degré de formalisation mathématique, était considérée comme une science quelque peu inférieure, et son poids dans les concours d’entrée aux Grandes Écoles était relativement faible. Avec cette situation clairement en vue, il est facile de comprendre pourquoi la chimie industrielle avait du mal à trouver sa place dans des écoles d’ingénieurs de ce type, aussi paradoxal que cela puisse paraître au premier abord. Au fil du temps, le déséquilibre entre les matières scientifiques a influencé plus que simplement les classes préparatoires. Il a biaisé toute la formation scientifique des lycées, car la structure de l’examen du baccalauréat tendait à se rapprocher des tendances qui régissaient les concours d’entrée.
Plusieurs auteurs ont souligné ce défaut (63), mais l’École Polytechnique avait une emprise ferme sur le pouvoir, car de nombreux diplômés, bien que nominativement ingénieurs, voyaient leur carrière culminer dans des postes élevés de fonctionnaires. Et la tendance pour les autres Grandes Écoles était de rivaliser de prestige avec Polytechnique, Centrale et les autres écoles en se dirigeant vers une science de plus en plus abstraite à un niveau de plus en plus élevé. Entre-temps, les facultés des sciences s’étaient développées progressivement dans plusieurs villes françaises, en particulier après que le ministre de l’Éducation, Victor Duruy, leur eut accordé le droit de former des futurs enseignants (64) – un rôle jusqu’alors limité aux écoles normales. Jusque-là, elles avaient agi principalement comme des bureaux d’examen pour les écoles secondaires, tandis que leurs cours et conférences avaient attiré principalement des amateurs et des mondains (65). Le nouveau rôle accordé aux facultés des sciences n’a pas résolu leurs problèmes. Au début, peu d’étudiants étaient attirés, et d’autres mesures devaient être prises, ne serait-ce que pour offrir plus d’opportunités et accélérer les perspectives de carrière des membres du corps professoral (66, 67). En d’autres termes, ce sont plutôt des pressions institutionnelles internes que externes qui semblent avoir été le facteur majeur de l’évolution des facultés des sciences. C’est dans ce contexte quelque peu improbable que ces facultés des sciences ont eu recours à la création de cours de sciences appliquées. Non seulement cela a aidé à créer des opportunités pour les enseignants, mais cela a également donné de grands avantages politiques aux facultés des sciences qui, dès lors, pouvaient fièrement afficher leur utilité aussi bien pour le gouvernement que pour les industries.
Les données indiquent que cette tendance était générale dans toute la France et qu’elle s’est produite à peu près en même temps. Dijon a vu son programme de chimie industrielle se séparer de la chimie proprement dite en 1900 après avoir été créé en 1898 (68). La même année (1898), Besançon a commencé à enseigner la chimie appliquée (69, 70, 71). Des écoles de sciences appliquées ou de chimie ont également vu le jour à Nancy, Lille et Bordeaux, tandis que des cours ou programmes de chimie industrielle apparaissaient à Caen, Montpellier et Rennes. Tous ces cours ou programmes sont apparus soit dans la dernière décennie du XIXe siècle, soit au début du XXe siècle (72, 81). Et ni Paris ni Lyon ne doivent être oubliés (82, 83). Toulouse se distingue également, grâce à Paul Sabatier (84).
De ville en ville, la formation des ingénieurs chimistes prenait une saveur distincte. Dans certains endroits, comme Marseille par exemple, une école d’ingénieurs travaillait à côté, mais en dehors, de la faculté des sciences (85). Dans d’autres endroits, l’école, bien qu’incorporée à la faculté des sciences, fonctionnait comme un tout autonome. Nancy, sous la direction compétente d’Albin Haller, est probablement allée le plus loin dans cette direction et est finalement devenue l’un des principaux centres de formation en chimie industrielle en France. Une autre solution a été offerte par Montpellier, où les ingénieurs chimistes étaient des étudiants déjà titulaires d’une licence et suivant une formation supplémentaire en chimie appliquée. En effet, Montpellier a copié Polytechnique d’une manière grossière en utilisant son programme de licence pour donner la formation générale en sciences qu’ils estimaient que le futur ingénieur devait connaître. Ensuite, le programme spécial en technologie chimique qui suivait jouait le rôle d’une École d’Application. En fait, Montpellier proposait le programme le plus ambitieux à trouver dans une université française à l’époque. Il a eu un succès limité, cependant, probablement parce que sa stratégie d’enseignement nécessitait des efforts similaires à ceux nécessaires pour réussir dans les Grandes Écoles sans accorder rien comme le prestige et le statut que ces Grandes Écoles pouvaient donner à leurs diplômés.
Le développement quelque peu chaotique des programmes de chimie appliquée dans plusieurs facultés des sciences en France est assez surprenant dans un pays connu pour son centralisme inspiré du jacobinisme. Cependant, les variations n’étaient pas limitées aux questions organisationnelles ; avec les disparités géographiques venait également la préoccupation de répondre aux besoins locaux. Par exemple, Bordeaux a créé un laboratoire spécialisé dans les résines en raison des vastes forêts dans les Landes voisines (86), tandis que Grenoble s’est lancée dans la fabrication du papier et l’électrotechnologie, et Nancy a rapidement incorporé une école brassicole spéciale dans ses programmes. La fabrication du vin a également stimulé la recherche chimique dans plusieurs universités du sud de la France, notamment à Bordeaux et à Montpellier.
Cette énorme diversité a conduit à une conséquence majeure : bien que de nombreuses écoles ou programmes décernaient le titre d’ingénieur chimiste, la signification et la valeur à attribuer à ce titre étaient très difficiles à déterminer. Jusqu’en 1925, un observateur bien informé de la chimie industrielle française pouvait écrire :
« Un autre défaut plus essentiel de nos écoles de chimie est que, comme elles ont été généralement créées à l’initiative des universités, ou parfois des villes, elles se lancent trop dans une sorte de compétition régionale qui est aussi préjudiciable à l’intérêt national que ne l’est le centralisme parisien dans d’autres circonstances. Leurs activités ne sont pas coordonnées. » (87).
L’auteur de ces lignes, Matagrin, ne fait que refléter une préoccupation professionnelle alors exprimée en France. En mai 1919, un Syndicat Professionnel des Ingénieurs Chimistes (88) avait enfin été formé en France, et l’année suivante, l’Union Nationale des Associations d’Anciens Élèves des Écoles de Chimie tenait une réunion lors de laquelle plusieurs résolutions étaient adoptées. Il est significatif qu’ils aient demandé l’uniformisation des programmes dans les différentes écoles de chimie ainsi que celle du diplôme d’ingénieur chimiste, qui, de plus, devrait être décerné par l’État (89).
Les demandes formulées par les chimistes industriels et appliqués en 1920 étaient directement causées par l’expérience de la guerre, bien sûr, et inspirées par des associations allemandes analogues qui étaient apparues plus tôt. Mais au-delà de ces causes directes, il faut également rechercher des facteurs qui étaient à l’œuvre depuis une période beaucoup plus longue. Ils ont trait au statut relatif des ingénieurs chimistes et des ingénieurs des Grandes Écoles au sein des industries. Une fois de plus, Matagrin peut nous servir de guide ici. Parlant des grandes entreprises où une division du travail est indispensable, Matagrin note que le directeur général est rarement un chimiste : « on choisit plutôt un technicien doué de qualités de gestion… un diplômé de l’École Centrale, de l’École des Mines, et parfois même un Polytechnicien ; … » (90). Quant au directeur technique, le plus souvent, il n’est pas non plus chimiste, mais un ingénieur versé dans les questions d’outils, d’utilisation de l’énergie, et ainsi de suite (91). Et Matagrin conclut qu’il est regrettable de voir des chimistes placés hiérarchiquement en dessous de techniciens qui ont peu ou pas de connaissance de leur domaine (92).
Un dernier problème concerne la concurrence venue de l’étranger. Malgré des progrès remarquables, les institutions éducatives françaises ne pouvaient pas répondre aux besoins industriels du pays (93, 94), si bien que du personnel étranger était appelé en France comme en Grande-Bretagne (95). De toute évidence, ces deux pays offraient des opportunités considérables pour les jeunes diplômés des universités ou des Technischen Hochschulen allemandes. En fait, Graebe, professeur de chimie à Genève, se plaignait de manière symptomatique à un visiteur français que si la France se mettait à former ses propres ingénieurs chimistes, de nombreux postes seraient perdus pour les étrangers (96). De plus, ces docteurs étrangers (car beaucoup avaient obtenu ce titre) étaient apparemment prêts à travailler pour des salaires assez modérés selon les normes françaises, contribuant ainsi à maintenir les salaires des chimistes à des niveaux relativement bas au sein des industries françaises (97). Enfin, l’introduction de chimistes formés en Allemagne ou en Suisse a contribué à introduire en France un modèle d’intégration du personnel formé qui avait évolué dans le contexte allemand – que nous examinerons bientôt – et qui, par conséquent, ne correspondait pas nécessairement au contexte français. Il a ainsi renforcé une tendance générale en France, à savoir la tendance à regarder l’Allemagne pour des leçons techniques, et non vers d’autres pays comme les États-Unis, par exemple. En fait, il y avait très peu de raisons pour les Français de regarder vers les États-Unis avant la Première Guerre mondiale : s’ils admiraient la croissance économique rapide et le potentiel de la jeune République, ils étaient beaucoup moins impressionnés par l’état général de sa science et de sa technologie (98). Il faut se rappeler, par exemple, que les Principes du Génie Chimique de Walker, Lewis et McAdam n’ont été publiés en français qu’en 1933, sous le titre trompeur de Principes de Chimie Industrielle. Il semble, en outre, que sa réception en France ait été le résultat d’un malentendu. Ce que les Français semblent avoir retenu de ce volume n’est pas la nature modulaire des opérations unitaires, mais plutôt leur contenu théorique (99). Le degré de formalisation mathématique inhérent aux opérations unitaires pouvait être utilisé pour faire ressembler la chimie industrielle à la physique. En conséquence, elle pouvait mieux s’inscrire dans le style scientifique général caractéristique de l’éducation des Grandes Écoles.
En conclusion et en résumé, on peut dire que la situation française ne pouvait pas conduire à l’émergence d’une formule telle que les opérations unitaires pour résoudre ses problèmes en chimie industrielle. Comme nous l’avons vu, la chimie industrielle française et même les ingénieurs chimistes étaient condamnés à rester en dessous des soi-disant ingénieurs des Grandes Écoles. Par conséquent, ce sont les diplômés des Grandes Écoles qui avaient voix au chapitre dans l’organisation managériale des industries chimiques, et non pas les chimistes ou les ingénieurs chimistes. Par conséquent, leur rôle était taillé d’en haut et non négocié comme entre des partenaires de statut à peu près égal. La division du travail prévalant dans la plupart des industries chimiques françaises a été établie avec très peu de contributions des ingénieurs chimistes industriels.
Traumatisés par la défaite de 1870 et préoccupés par la croissance industrielle rapide de l’Allemagne, les ingénieurs français étaient beaucoup plus attentifs aux développements allemands qu’aux progrès américains. L’afflux de chimistes allemands dans les industries françaises, même s’il était apparemment modéré – et aucune donnée à notre connaissance ne confirme cela – était suffisamment significatif pour être noté par plusieurs observateurs. La présence de ces spécialistes étrangers au sein de plusieurs industries françaises ne pouvait que renforcer le prestige du modèle allemand. Cependant, le modèle allemand n’allait pas être importé facilement en France pour des raisons similaires au cas britannique. Comme ce dernier, les industries chimiques françaises étaient assez anciennes et leur principale force résidait dans les produits chimiques lourds. Et elles étaient tout aussi incapables de formuler une demande bien définie aux universités ou aux écoles techniques que leur homologue britannique.
Quant aux chimistes français, ils ne formaient pas un groupe unique et bien organisé. Ayant été formés de manière très variée, ce qui est difficile à imaginer dans le système éducatif français, ils ont trouvé impossible de se constituer en un groupe de pression efficace, comme leurs collègues allemands ou américains ont pu le faire. Par conséquent, ils n’ont jamais été en mesure de se faire entendre de manière forte, simple et cohérente.
Enfin, nous avons vu que les universités ont pris des initiatives en faveur de la chimie appliquée, mais celles-ci ont émergé beaucoup plus pour résoudre les problèmes de carrière internes des membres du corps professoral que pour répondre aux préoccupations fondamentales de la nation. Chaque université a réagi comme si elle était seule et, par conséquent, chacune a évolué vers sa propre solution particulière, souvent dictée par les besoins et les opportunités locaux. Comme aucun groupe professionnel n’existait, personne ne pouvait contribuer à harmoniser les programmes universitaires avec les besoins de l’industrie. En bref, la situation française était tellement désordonnée qu’elle excluait la production d’une solution spécifique et cohérente par les chimistes industriels eux-mêmes. En pratique, les décisions sont restées largement entre les mains des dirigeants et des ingénieurs des Grandes Écoles. Le modèle devrait venir de l’extérieur et être intégré d’une manière ou d’une autre dans des institutions assez rigides et partiellement incompatibles.
Le succès allemand dans l’intégration de la science à l’industrie, en particulier dans le secteur chimique, peut être attribué à plusieurs facteurs clés. Contrairement à la Grande-Bretagne et à la France, l’Allemagne a connu une croissance industrielle impressionnante, la positionnant rapidement comme un concurrent significatif de l’hégémonie britannique.
- Système éducatif technique étendu : L’Allemagne disposait d’un système éducatif technique bien développé aux côtés de ses universités. Le nombre d’étudiants inscrits dans l’enseignement technique allemand dépassait largement celui des autres pays européens. Les Technischen Hochschulen (universités techniques) ont enregistré une augmentation substantielle du nombre d’étudiants, produisant environ 3 000 ingénieurs par an dans la décennie précédant la Première Guerre mondiale.
- Financement public généreux : L’éducation technique allemande bénéficiait d’un soutien financier public généreux. Les écoles techniques disposaient de budgets importants, leur permettant de fournir des installations et un équipement de pointe. Ce soutien financier a permis à l’Allemagne de répondre efficacement aux besoins croissants de ses industries.
- Complexe scientifique-industriel : Les industries allemandes, en particulier dans le secteur chimique, ont intégré avec succès les connaissances scientifiques dans la production. Leverkusen, une usine modèle créée par Carl Duisberg pour la société Bayer, illustre cette intégration. L’usine présentait un niveau élevé d’apport scientifique, avec 203 chimistes opérationnels et une technologie avancée. L’Allemagne a investi massivement dans les installations éducatives, se traduisant par des laboratoires et un équipement impressionnants qui ont impressionné les visiteurs étrangers.
- Transition vers les colorants synthétiques et les produits pharmaceutiques : Contrairement à la Grande-Bretagne et à la France, l’industrie chimique allemande s’est développée autour des colorants synthétiques et a progressivement inclus d’autres branches telles que les produits pharmaceutiques. Ce changement a permis une contribution scientifique significative dans l’industrie.
- Situation de brevet lâche : La situation de brevet lâche en Allemagne jusqu’à l’unification a permis l’imitation, bénéficiant initialement aux industries. La loi sur les brevets de 1876 protégeait le processus de production plutôt que le produit fini. Cela soulignait l’importance d’avoir des chimistes et des avocats spécialisés dans les brevets, favorisant la concurrence et l’innovation.
- Innovations dans le processus de production : Les fabricants chimiques allemands ont cherché à améliorer le processus de production traditionnel, conduisant à l’embauche de personnel formé à l’université entre 1874 et 1884. Les chimistes embauchés étaient initialement intégrés dans les travaux chimiques pour améliorer les processus existants.
- Liens entre les professeurs et les industries : Les premières tentatives d’intégration des connaissances scientifiques dans la production ont consisté à étendre les liens entre les professeurs d’université et les industries. Cette approche visait à créer une bourse postdoctorale, permettant aux jeunes titulaires d’un doctorat de travailler sur des problèmes liés aux intérêts de l’entreprise.
- Passage à des brevets orientés processus : La loi sur les brevets de 1876, qui protégeait le processus de production, a encouragé les entreprises à investir dans des chimistes hautement qualifiés. Ce changement soulignait l’importance de la contribution scientifique pour obtenir des brevets et rester compétitif.
Alors que les premières tentatives d’intégration de la science dans la fabrication étaient difficiles, l’Allemagne a progressivement développé des stratégies efficaces, jetant les bases de son succès dans l’industrie chimique. La transition de l’imitation à l’innovation systématique et l’établissement d’un complexe scientifique-industriel ont joué un rôle clé dans l’ascension industrielle de l’Allemagne.
Le passage de la méthode artisanale à une intégration systématique de la science dans l’industrie chimique allemande s’est fait progressivement. Bien que les fabricants de colorants allemands aient initialement adopté une approche conservatrice, la situation des brevets a joué un rôle crucial. Le Patent Act de 1876 a introduit la protection des processus de production plutôt que des produits finis, incitant les entreprises à investir dans des chimistes qualifiés et des avocats spécialisés en brevets.
L’importance des brevets a été soulignée par la compétition croissante entre les entreprises. Les brevets ont favorisé l’utilisation de chimistes qualifiés et de conseillers en brevets, renforçant ainsi l’intégration de la science dans l’industrie chimique allemande. Les fabricants de colorants ont cherché à obtenir un avantage concurrentiel en développant des processus de production innovants, conduisant à une collaboration accrue entre l’industrie et les universités.
La tentative de Bayer d’intégrer des scientifiques dans le processus de production, en créant une forme de bourse postdoctorale, a illustré les premières approches visant à utiliser les connaissances scientifiques dans l’industrie. Cependant, cette stratégie s’est avérée limitée, car la recherche scientifique, particulièrement dans le domaine de la synthèse organique, nécessitait des laboratoires plus importants et un personnel plus nombreux.
La période entre 1874 et 1884 a marqué le début de l’embauche de personnel formé à l’université par l’industrie chimique allemande. Cela n’était pas tant lié à une vision systématique de l’innovation que à une tentative d’améliorer les processus de production traditionnels. Néanmoins, cela a jeté les bases de l’intégration future des scientifiques dans l’industrie.
La transition vers un complexe scientifique-industriel plus vaste, symbolisé par l’usine modèle de Leverkusen, a eu lieu progressivement. Les chiffres impressionnants, tels que les 203 chimistes opérant dans cette usine, ont démontré le succès de l’intégration de la science à une échelle beaucoup plus importante. Les fabricants de colorants allemands ont ainsi réussi à créer un modèle de production qui impliquait fortement la contribution scientifique, une réalisation enviée par leurs homologues britanniques et français.
En résumé, l’Allemagne a réussi là où d’autres ont échoué en intégrant efficacement la science dans son industrie chimique. Des facteurs tels que l’ampleur du système éducatif technique, le financement public généreux, la transition vers les colorants synthétiques et les produits pharmaceutiques, la situation des brevets, ainsi que des initiatives progressives des fabricants ont joué un rôle clé dans ce succès.
Cependant, cette intégration de la science dans l’industrie chimique allemande n’est pas survenue du jour au lendemain. Elle a été le résultat d’un processus graduel, façonné par des facteurs tels que la concurrence entre entreprises, les évolutions législatives en matière de brevets et les tentatives progressives de collaboration entre l’industrie et les universités.
L’émergence de Leverkusen en tant qu’usine modèle, avec ses 203 chimistes opérant dans un environnement techniquement avancé, a symbolisé la transformation de l’approche artisanale antérieure en une intégration systématique de la science dans la production chimique. Les fabricants de colorants allemands ont su tirer parti de la situation des brevets pour protéger leurs processus innovants, renforçant ainsi l’importance des chimistes qualifiés dans leurs entreprises.
L’intégration réussie de la science dans l’industrie chimique allemande a contrasté avec les expériences de la Grande-Bretagne et de la France, où des défis tels que la division du travail, la concurrence étrangère et l’absence de coordination entre les établissements éducatifs ont entravé la création d’un modèle cohérent. En Allemagne, la croissance rapide des établissements d’enseignement technique, combinée à un financement généreux, a contribué à former un grand nombre de scientifiques et d’ingénieurs, soutenant ainsi l’essor de l’industrie chimique.
En fin de compte, l’histoire de l’industrie chimique allemande souligne l’importance de facteurs interconnectés, tels que l’éducation technique, la législation sur les brevets, la collaboration entre l’industrie et les universités, et les pratiques innovantes des entreprises, dans la création d’un modèle réussi d’intégration de la science dans la production industrielle.
La transition vers un complexe scientifique-industriel, symbolisée par l’usine modèle de Leverkusen, a été progressive et n’a pas été exempte d’obstacles. L’industrie chimique allemande, centrée autour des colorants synthétiques et élargie progressivement à d’autres branches, a d’abord été conservatrice, mais une situation de brevets plus souple avant l’unification allemande a favorisé l’imitation et l’innovation.
L’acte crucial a été l’introduction du Patent Act de 1876, qui protégeait le processus de production plutôt que le produit fini. Cette législation a incité les entreprises chimiques allemandes à recruter des chimistes hautement qualifiés pour améliorer leurs processus de production. La concurrence a renforcé l’importance des brevets, incitant les entreprises à investir dans des scientifiques et des avocats spécialisés.
Une tentative précoce d’intégrer la science dans le processus de production impliquait des liens entre professeurs d’université et industrie, mais cette approche s’est avérée limitée en raison des défis posés par la recherche scientifique imprévisible. Cependant, les entreprises allemandes ont continué à explorer des stratégies pour maximiser l’apport scientifique dans leurs activités, cherchant à surmonter les résistances des responsables de la production habitués à un rôle plus étendu.
Ainsi, l’industrie chimique allemande a réussi à intégrer efficacement la science dans sa production, établissant un modèle enviable au niveau international. Cela contraste avec les expériences britannique et française, soulignant l’importance de la coordination entre l’éducation technique, la législation sur les brevets, la collaboration université-industrie et les pratiques innovantes des entreprises pour créer un modèle cohérent d’intégration réussie de la science dans la production industrielle.
Le cas de l’Allemagne se présente comme une success story par rapport aux deux cas précédents. Nous avons constaté à plusieurs reprises que tant les Britanniques que les Français cherchaient en Allemagne inspiration et modèles à émuler. Alors que les industries de ces deux pays affichaient des taux de croissance très modérés, l’Allemagne, au contraire, présentait des chiffres impressionnants qui la plaçaient rapidement dans une position menaçante pour l’hégémonie britannique : seuls les États-Unis affichaient des taux de croissance comparables.
Ce succès industriel a attiré l’attention internationale, et des observateurs ont inlassablement répété un message très similaire : Georges Blondel (100), Raphael-Georges Levy (101) et Victor Cambon (102) ont tous souligné l’excellence de l’enseignement technique supérieur en Allemagne, mettant en contraste son état florissant avec la semi-pauvreté affectant une grande partie de la recherche académique française. En Grande-Bretagne, des opinions similaires prévalaient, comme en témoigne le livre d’Edwin Williams intitulé « Made in Germany », mais tout aussi éloquent est cette lettre à l’éditeur publiée dans la revue professionnelle « Engineering » :
« Tellement de discours ont été prononcés sur ces deux textes [les industries chimiques allemandes et l’enseignement technique] par des orateurs plus ou moins qualifiés, depuis les juges en chef jusqu’à d’autres, que l’esprit public, peut-être par défaut, a admis la nécessité de fournir une ‘éducation technique’ et aussi que l’essor de l’industrie chimique en Allemagne est l’un des éléments sur lesquels s’appuient principalement ceux qui s’apprêtent à démontrer une telle nécessité » (103).
Mais qu’est-ce qui était si particulier dans l’enseignement supérieur allemand pour impressionner ainsi les étrangers ? Deux variables peuvent être identifiées pour répondre à cette question. Premièrement, un système d’éducation technique très étendu existait à côté des universités bien développées ; deuxièmement, le nombre d’étudiants impliqués dans l’éducation technique en Allemagne dépassait tout ce que les autres pays européens pouvaient montrer.
Pour obtenir des chiffres complets sur l’éducation publique allemande, il faut se tourner vers l’ouvrage de W. Lexis intitulé « Das Unterrichtswesen im Deutschen Reich » ou, en alternative, vers son résumé en anglais (104). Quelques exemples suffiront pour montrer à quel point l’Allemagne était en avance sur ses voisins au tournant du siècle. Un observateur français de la scène allemande note qu’entre 1878 et 1902, le nombre d’étudiants fréquentant les neuf (bientôt onze) Technischen Hochschulen d’Allemagne est passé de 5 474 à 16 826, et si ce nombre a ensuite diminué un peu au cours des années suivantes, c’est parce que les normes d’admission avaient été relevées (105). Ses chiffres reproduisent ceux de Lexis, dont il les a probablement tirés (106). Dans l’ensemble, l’Allemagne produisait environ 3 000 ingénieurs par an dans la décennie précédant la Première Guerre mondiale (107).
Pendant ce temps, les 22 universités de l’Empire allemand abritaient 37 677 étudiants en 1903, dont 15 205 étaient inscrits à la faculté de philosophie où les sciences étaient enseignées (108). Vers 1908, ce nombre avait augmenté pour atteindre 47 000 étudiants (109), et en 1911, il avait atteint 59 000, dont 10 000 provenaient de Berlin (110).
Non seulement l’éducation technique allemande était bien développée en termes d’étudiants, mais elle bénéficiait également d’un soutien généreux de la part des fonds publics. En conséquence, la plupart des écoles techniques bénéficiaient d’installations matérielles inégalées, sauf peut-être aux États-Unis. Un simple coup d’œil sur les budgets annuels des Technischen Hochschulen suffit pour se faire une idée des énormes efforts financiers déployés par l’Allemagne en faveur de son éducation technique. À Berlin, par exemple, l’ensemble des recettes de Charlottenburg s’élevait à 1 744 366 marks pour l’année 1902-1903 (111). C’était de loin la plus grande école technique, mais des budgets annuels avoisinant les 500 000 ou 600 000 marks n’étaient pas du tout rares. Et bien sûr, tout cet argent se traduisait par un équipement de très bonne qualité qui ne manquait jamais d’impressionner les visiteurs étrangers. Dantzig, par exemple, était la dixième école technique à être construite, et elle a ouvert ses portes en 1904. Pour un visiteur français, son équipement et ses laboratoires semblaient vraiment luxueux (112). En bref, l’Allemagne ne souffrait d’aucune pénurie d’installations éducatives ; au contraire, elle investissait massivement pour pouvoir répondre aux besoins et exigences croissants de l’industrie.
D’un autre côté, les industries allemandes avaient appris à utiliser ce personnel à une échelle inconnue ailleurs. Leverkusen, une usine modèle créée de toutes pièces par Carl Duisberg, travaillant alors pour la Bayer Company, est peut-être le meilleur exemple de ce à quoi ressemblaient les industries chimiques allemandes au début de ce siècle. C’était un amalgame d’idées américaines sur la disposition des usines avec quelques idées très originales de Duisberg lui-même (113). Il est intéressant de citer à ce sujet la réaction émerveillée de Victor Cambon lorsqu’il l’a visitée vers 1908 : (« f »)
« La perfection atteinte à cet égard dépasse encore celle rencontrée dans les universités et les écoles polytechniques. Des réactifs, des gaz, de la chaleur, du froid, du vide, de la pression, de l’électricité, une force motrice à n’importe quelle vitesse sont fournis à l’opérateur, sans qu’il ait à faire autre chose que d’appuyer sur des boutons ou d’ouvrir des robinets. Par conséquent, il n’a pas de réactif à préparer : un service central s’en charge ; il n’y a pas de solution à agiter ou de précipités à extraire et à sécher : des machines s’en chargent ; il n’y a pas de verrerie à nettoyer : deux assistants s’occupent de ce travail. Le chimiste, toujours titulaire d’un doctorat, se tient là comme un pape installé dans un sanctuaire fermé aux masses » (114). (j)
Dans cette usine particulière, il y avait 203 chimistes en activité. En comparaison avec de telles chiffres, la Grande-Bretagne et la France ne pouvaient que convenir que l’Allemagne avait effectivement trouvé un moyen d’intégrer les scientifiques dans ses industries, et qui plus est, qu’elle les rémunérait généreusement pour le faire.
Il était évident pour tous qu’une nouvelle division du travail avait été élaborée, et elle constituait l’objectif à atteindre pour les voisins envieux de l’Allemagne. Cependant, il était beaucoup plus facile de décrire cette division du travail que de la mettre en œuvre. Les Français répétaient les paroles sages mais générales du chimiste éminent Caro, par exemple (115), et les Anglais découvraient essentiellement la même réalité par le biais de leurs propres observateurs (116), mais les mots restaient des mots.
Ce qui nous intéresse particulièrement, c’est le processus qui a conduit les fabricants allemands à inventer un mode de production permettant une contribution scientifique significative. En d’autres termes, comment ont-ils réussi à intégrer avec succès la science dans leurs industries chimiques alors que d’autres pays européens ne pouvaient pas le faire ?
Comme dans le cas de la Grande-Bretagne et de la France, l’un des facteurs cruciaux résidait dans la nature de l’industrie chimique. Dans le cas de l’Allemagne, nous sommes confrontés à une situation assez différente de celle de la Grande-Bretagne ou de la France. En Allemagne, les produits chimiques lourds traditionnels n’avaient jamais beaucoup évolué, précisément parce qu’ils n’avaient pas réussi à repousser la concurrence des industries britanniques plus grandes et plus anciennes. Cela signifiait que la pointe des industries chimiques allemandes, contrairement à la Grande-Bretagne ou à la France, était progressivement construite autour de colorants synthétiques auxquels étaient ajoutées progressivement d’autres branches de la chimie industrielle bénéficiant également d’un niveau élevé d’apport scientifique, comme les produits pharmaceutiques.
Les fabricants de colorants allemands n’ont pas inventé leur nouveau mode de production et leur intégration de l’apport scientifique dans l’industrie du jour au lendemain. En fait, tout comme leurs collègues britanniques et français, ils avaient tendance à être plutôt conservateurs. Cependant, une situation de brevet très lâche prévalait jusqu’à ce que l’unification allemande entre en vigueur, et cela leur a permis de récolter les avantages de l’imitation au début.
La transition vers un complexe industriel-scientifique de grande envergure, symbolisé de manière appropriée par l’utopie technique de Duisberg, a évolué très progressivement et non sans surmonter plusieurs obstacles. Nous avons jusqu’à présent souligné la nature conservatrice des industries chimiques. Cependant, il faut se rappeler qu’aucune industrie n’est jamais si conservatrice qu’elle reste absolument immobile. Au contraire, des innovations se produisent toujours, et les contremaîtres jouent un grand rôle à cet égard. Séparer le processus innovant du processus de production signifiait que les contremaîtres, et d’autres également, voyaient leur activité circonscrite plus étroitement et, par conséquent, leur rôle était appauvri par cette division du travail affinée. Il n’est pas étonnant qu’ils aient résisté à cette tendance et continué à le faire jusqu’au milieu des années 1870 en Allemagne (117).
John J. Beer relate que, dans le cas de la société Bayer, le recrutement de personnel formé à l’université a eu lieu dans la décennie entre 1874 et 1884. Cela n’a pas été fait parce que les dirigeants voulaient introduire un schéma d’innovation systématique – cette idée ne leur était pas encore venue – mais plutôt pour essayer d’améliorer le processus de production traditionnel (118). En fait, les chimistes embauchés par Bayer étaient intégrés aux travaux chimiques sur la base de ce qui pouvait être appris de l’introduction du processus de production de soude Solvay, et non en tant que résultat d’un saut imaginatif dans le futur.
Une impulsion cruciale vers le nouveau schéma industriel a apparemment été fournie par la nouvelle loi sur les brevets de 1876. Ayant commencé leurs industries en imitant, et plus tard en améliorant les produits de leurs concurrents, les fabricants de produits chimiques allemands ont demandé une loi sur les brevets leur permettant de tirer le meilleur parti de leur capacité récemment acquise. C’est la raison pour laquelle la loi sur les brevets de 1876 ne protégeait pas le produit fini, mais plutôt le processus de production. Cela signifiait, à son tour, qu’une entreprise ne pouvait jamais être certaine que ses produits rentables ne pouvaient pas être produits un jour d’une manière différente par une entreprise concurrente. En conséquence, la concurrence entre les entreprises a rapidement fait comprendre que la participation de chimistes hautement qualifiés (ainsi que des avocats spécialisés en brevets) améliorait considérablement les chances de réussite.
L’une des premières tentatives d’intégrer les connaissances scientifiques dans le processus de production consistait à étendre les liens qui avaient été établis assez tôt entre les professeurs d’université et les industries (119). Cette méthode a été essayée parce que les premières tentatives d’utiliser des docteurs en chimie au sein de l’industrie n’avaient pas réussi : (« f »)
« … la société n’a pas réussi à souder ces [docteurs en chimie] en une équipe de recherche, préférant attacher chaque homme à une division de production spécifique où son travail devenait largement analytique et routinier… » (120).
Ainsi, il a été envisagé de créer une sorte de bourse postdoctorale permettant à un jeune docteur en philosophie de travailler sous la direction d’un bon chimiste sur des problèmes liés aux intérêts de l’entreprise. De cette manière, plusieurs avantages ont été obtenus : le chimiste parrain était indirectement sollicité en tant que consultant et l’entreprise n’avait pas à investir dans la construction de laboratoires coûteux (121).
Cependant, le schéma élaboré chez Bayer n’a pas fonctionné, ne serait-ce que parce que l’industrie posait des questions qui ne pouvaient pas être facilement résolues (122). En effet, la société Bayer découvrait empiriquement que la recherche scientifique est extrêmement difficile à planifier, surtout lorsque le temps et les ressources sont essentiels. De plus, cette stratégie particulière ne pouvait fonctionner que tant que l’apport scientifique nécessaire restait faible. Il est difficile d’imaginer comment les enquêtes massives et systématiques sur les synthèses organiques qui allaient caractériser l’industrie des colorants dans les années suivantes auraient pu être réalisées dans plusieurs petits laboratoires avec un personnel très limité. De toute évidence, les industries Bayer élaboraient une approche de l’intégration de la science dans la fabrication qui pourrait être qualifiée d’artisanale au mieux.
L’un des cobayes de l’expérience de Bayer se trouvait être Carl Duisberg, et il a trouvé un moyen d’organiser de manière approfondie l’intégration des chimistes au sein des installations de Bayer. En 1896, il expliqua à un public américain quelles étaient ses idées à ce sujet, et elles sont tellement centrales à notre thèse qu’elles méritent d’être discutées en détail. Dans son discours à New York du 18 mai 1896, Duisberg déclara :
« Nous avons trouvé qu’il est très satisfaisant que nous introduisions nous-mêmes le jeune chimiste dans notre domaine spécifique. À cette fin, chaque chimiste doit d’abord passer par notre laboratoire expérimental de teinture et d’impression, afin qu’il apprenne la teinture et l’impression et qu’il prenne conscience des exigences de l’industrie des teinturiers en ce qui concerne les propriétés de teinture et la solidité des couleurs. Lorsque le chimiste a terminé dans ce laboratoire, il est présenté au laboratoire scientifique, dont la fonction est de nous tenir, ainsi que nos chimistes, informés de tout ce qui apparaît de nouveau dans le domaine de nos fabrications, dans la littérature, les brevets, etc., et c’est en même temps principalement le laboratoire des inventions » (123).
La stratégie de Duisberg consistait à faire circuler les chimistes à travers les différentes divisions chimiques de l’usine jusqu’à ce qu’ils soient familiarisés avec tous les aspects des activités chimiques en elle. Ensuite, ils pouvaient rejoindre leur propre créneau personnel, celui qui était le mieux adapté à leurs compétences. C’est à ce moment que Duisberg se prononce fermement en faveur d’une solution qui exclut essentiellement l’émergence d’un ingénieur chimiste à l’américaine.
« Contrairement à beaucoup de mes amis, je me place… du point de vue que le chimiste n’a pas besoin [d’ingénierie] comme une nécessité. Rien, selon moi, n’est pire que de faire d’un chimiste un ingénieur-chimiste, comme c’est le cas en France, ou un ingénieur chimiste, comme c’est très souvent le cas en Angleterre. Le champ de la chimie que le chimiste doit maîtriser est actuellement tellement énorme qu’il est pratiquement impossible pour lui d’étudier en même temps la mécanique, qui est le domaine spécial de l’ingénieur. La division du travail est ici absolument nécessaire. Je laisse à l’ingénieur et au chimiste leurs sciences respectives, mais je veux que les deux travaillent ensemble » (124).
Duisberg n’utilisait pas légèrement l’expression « division du travail » : pour lui, c’était clairement le principe central de sa conception fondamentale des installations chimiques. C’est, en fait, sur la base de la familiarité américaine avec une division étendue du travail qu’il pensait que l’approche allemande était la mieux adaptée aux industries chimiques américaines.
En organisant ses laboratoires de recherche industrielle, Duisberg conserva le banc collectif et la zone de travail conçus plusieurs décennies plus tôt par Liebig. Cependant, il sépara chaque espace de travail des autres par des étagères de hauteur d’épaule. De cette manière, les chimistes voisins pouvaient toujours communiquer facilement les uns avec les autres, mais ils ne pouvaient pas voir exactement ce que faisaient les autres. En d’autres termes, chaque chimiste savait un peu ce que faisaient les autres. Il savait aussi que son propre travail s’insérait quelque part dans cet effort collectif, mais il n’en savait jamais assez pour reconstruire la grille complète. De cette manière, chaque chimiste avait des opportunités limitées de transmettre des secrets de laboratoire à une autre entreprise. Inversement, la vie privée incomplète, tout en favorisant une atmosphère de recherche conviviale, « … rendait difficile à un chimiste de cacher d’importantes découvertes comme l’avait fait Bottiger avec le rouge Congo… dans l’espoir de quitter la société et de les vendre à quelqu’un d’autre » (126).
Les laboratoires chimiques des industries allemandes de teinture ont souvent été décrits comme ennuyeux, méticuleux et sans fin (127). Ces adjectifs sont intéressants car ils évoquent le processus terne du travail à la chaîne. En fait, la puissance connotative de ces mots se révèle assez précisément si l’on pense à cette chaîne non pas comme un endroit où les travailleurs sont répartis, mais comme une chaîne de réactions successives effectuées afin d’explorer le labyrinthe des synthèses organiques de manière collective et systématique. De manière quelque peu elliptique, Victor Cambon écrivait que « Dès le moment où ils ont commencé à s’américaniser, les Allemands… sont devenus des inventeurs fertiles » (128). En réalité, il semble avoir touché le clou assez précisément, car les Américains accordaient une grande importance à la division du travail, et les Allemands ont trouvé un moyen d’appliquer la division du travail de manière à intégrer la recherche scientifique dans un processus de production industrielle.
Rappelez-vous que tout cet effort gigantesque était nécessaire. Vers 1900, Hoechst, par exemple, testait environ 3 500 couleurs par an et environ 18 d’entre elles arrivaient sur le marché. Quelques années plus tard, 8 000 couleurs ont été testées en une seule année et seules 29 pouvaient être utilisées commercialement (129). En fin de compte, les fabricants de colorants sont également devenus des producteurs de connaissances, car les brevets découverts par une entreprise devenaient des marchandises à échanger, à troquer ou à louer (130).
Curieusement, si les industries allemandes de teintures, et plus tard les industries pharmaceutiques, ont bien bénéficié de ce mode de travail qui avait réussi à utiliser efficacement le chimiste formé à l’université, il en va de même dans une moindre mesure pour les autres industries chimiques. En fait, des critiques ont été exprimées même par des enseignants en chimie qui voyaient les industries de teintures biaiser l’ensemble de l’éducation chimique en raison de leur poids relatif dans l’ensemble du domaine de la chimie industrielle : les programmes avaient tendance à mettre l’accent sur l’enseignement de la chimie organique au détriment d’autres domaines (131). On a souligné en 1900 que si l’Allemagne avait complètement dépassé toutes les autres nations dans les colorants dérivés du goudron, ce n’était pas le cas de nombreuses autres branches de la chimie. La Grande-Bretagne et la Belgique, soutenait-on, étaient toujours en tête dans la production de soude. Les explosifs modernes avaient été inventés par Nobel et plusieurs chimistes français. La France était également en tête dans la chimie des graisses, et c’était Pasteur, et non un Allemand, qui avait élucidé les processus de fermentation. Enfin, l’Autriche avait construit les plus grandes usines de sucre du monde, tandis que les États-Unis pouvaient fournir du gaz de l’eau (un mélange d’hydrogène et de monoxyde de carbone) en grandes quantités (132). La solution, affirmait-on en particulier par Ost, était de mettre davantage l’accent sur la pratique et, de manière caractéristique, de paralléliser la spécialisation industrielle avec une éducation spécialisée similaire (133).
L’appel d’Ost à un retour à la pratique, à un nouvel accent mis sur l’enseignement de la chimie inorganique et à une plus grande spécialisation ne menaça cependant pas le concept de Duisberg d’une stricte division du travail entre les chimistes et les ingénieurs. Au contraire, il fournissait les moyens d’étendre les leçons apprises dans les usines de teintures à toutes les industries chimiques, permettant ainsi un transfert simple du « modèle Duisberg » d’une usine à l’autre et d’une branche de l’industrie chimique à une autre.
La fin de notre histoire est maintenant proche. De toute évidence, Duisberg n’a pas créé à lui seul l’approche allemande de la chimie industrielle ; cependant, comme A. D. Little aux États-Unis, il a trouvé des moyens efficaces de communiquer ce qu’il voulait dire. Pour cette raison, nous avons appelé l’approche allemande l’idée de Duisberg, ne serait-ce que pour des raisons de commodité. Mais peu importe le nom, cela constituait une solution entièrement originale au problème d’intégrer les connaissances chimiques dans un contexte industriel. En même temps, l’approche de Duisberg, par sa distinction soigneuse entre chimistes et ingénieurs, excluait la possibilité de voir émerger un technicien de type mixte, tel que l’ingénieur chimiste américain. Elle présentait également un avantage distinct par rapport au concept américain. Les industries allemandes pouvaient prendre ce que les universités et les Technischen Hochschulen leur avaient donné et les intégrer au sein de leurs installations par le biais d’une réorganisation interne totalement séparée des préoccupations académiques. L’ingénieur chimiste américain, en revanche, nécessitait non seulement certaines réorganisations internes des usines chimiques, mais il dépendait de l’apparition de nouveaux programmes d’études. De toute évidence, il était plus facile de déplacer les industries en Allemagne et les universités aux États-Unis.
Avec le temps, la solidité de l’approche de Duisberg n’a jamais été sérieusement remise en question. La création de l’Interessen-Gemeinschaft der Farbenindustrie en 1925 a répondu aux exigences plus élevées de la concurrence internationale caractérisant le monde après la Première Guerre mondiale. Carl Duisberg a été choisi comme son nouveau directeur (134). Sa stratégie était simple. Il a étendu les méthodes qui avaient si bien servi Bayer avant la guerre autant qu’il le pouvait.
De nombreuses années plus tard, on a observé que le processus d’innovation chez I.G. Farben reposait toujours sur une stricte obéissance au principe de division du travail entre les chimistes et les ingénieurs qui avait été élaboré dans les années d’avant-guerre : « Lorsqu’un résultat susceptible d’être exploité à une échelle industrielle était confirmé en laboratoire, l’inventeur lui-même était généralement chargé de tester son invention à une échelle semi-industrielle. Pour ce faire, des ingénieurs mécaniciens ou électriques compétents étaient mis à sa disposition, ainsi que le personnel qualifié nécessaire » (135).
Tout cela signifie que la division du travail qui avait été testée au sein des industries de teintures était devenue la règle pour la plus grande partie des industries chimiques allemandes. Elle a ensuite acquis un statut que certains étaient prêts à appeler une doctrine :
« En termes d’autres doctrines qui pourraient être comparables à celles de I.G. Farben, nous ne voyons que la doctrine américaine du ‘génie chimique’ : celle de I.G. Farben peut alors être caractérisée comme la doctrine de la ‘chimie pure' » (136).
Kahan écrivait cela en 1949, mais des exemples plus récents tendent également à montrer que l’Allemagne, contrairement à la plupart du monde, est restée fidèle au point de vue de Duisberg. Même récemment, en 1955, le chimiste, gestionnaire et historien de la chimie britannique, Harold Hartley, pouvait encore dire que le seul pays au monde qui n’avait pas encore accepté la notion de génie chimique telle qu’elle avait émergé aux États-Unis était l’Allemagne (137). Ce n’est que très récemment que les contributions théoriques américaines ont fait des progrès significatifs en Allemagne, mais elles dépassent largement la notion d’opérations unitaires (138).
En conclusion, nous avons soutenu dès le départ que la notion d’opération unitaire était le résultat de négociations complexes entre les industries, les universités et les organisations professionnelles. Nous avons utilisé cette hypothèse pour explorer trois contextes européens différents. Il est maintenant évident que chaque pays examiné a suivi un chemin distinct pour élaborer une forme de chimie industrielle. Cela devrait être intéressant en soi pour quiconque s’intéresse à l’exploration des styles technologiques nationaux. Cependant, notre préoccupation centrale n’était pas là. Ce qui nous intéressait le plus était de démontrer que chaque pays a développé une forme de chimie industrielle sur la base d’hypothèses directrices impliquant des établissements éducatifs, des types d’industries et les professionnels eux-mêmes.
Dans certains cas, comme en Allemagne, ces hypothèses directrices ont été formulées explicitement une fois reconnues. Dans le cas de la France ou de la Grande-Bretagne, ces hypothèses directrices ne sont jamais devenues explicites car les diverses institutions impliquées n’ont jamais trouvé de moyen de s’écouter mutuellement et ont continué de répondre à leur propre logique interne. Cependant, explicites ou non, ces hypothèses directrices, elles-mêmes résultat de négociations, ont pris la place occupée aux États-Unis par les opérations unitaires. En conséquence, les événements européens dans le domaine de la chimie industrielle n’ont pas tant été des obstacles à la notion d’opération unitaire qu’ils en ont été des substituts.
Un deuxième point à souligner est que toutes les solutions locales ne survivent pas éternellement. Cela va de soi, bien sûr. Ce qui est moins évident, c’est que la valeur de survie d’une solution particulière dépend de facteurs allant bien au-delà des questions purement techniques.
Enfin, il est clair que des modèles réussis peuvent parfois être exportés, mais pas toujours. Il serait intéressant, à cet égard, de se demander si le génie chimique américain était plus facile à exporter que son homologue allemand. Intuitivement, nous sommes tentés de répondre en disant que cela dépendrait du degré de flexibilité relatif des universités et des industries, mais justifier une telle réponse nous emmènerait trop loin. En revanche, les modèles réussis sont intégrés de manière trop étroite dans leurs contextes sociaux, économiques, industriels et éducatifs pour être facilement remplacés par un autre modèle provenant d’une base différente. L’exemple allemand illustre bien ce point.
Reconnaissance Nous tenons à profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement A. King pour ses commentaires aimables et perspicaces.
Literature Cited
«
……-I 1. Guedon, I.-C. « Chemical Engineering by Design: the Emergence of Unit
Operations in the United States, » submitted for publication in Technology
and Culture.
- Noble, D. N. « America by Design »; A. Knopf: New York, 1977; p. 194.
- Hardie, D. W. F. « The Empirical Tradition in Chemical Technology »;
Loughborouh College of Technology: 1962; p. 30. - Haber, L. F. ‘The Chemical Industry During the Nineteenth Century »; The
Clarendon Press: Oxford; 1958. - Haber, L. F. « The Chemical Industry (1900-1930)-International Growth
and Technological Change »; The Clarendon Press: Oxford, 1971. - Hall, Marie Boas. « La croissance de l’industrie chimique en Grande-Bretagne
au XIXe siecle, » Rev. Hist. Sci. Leurs Appl. 1973, 26, 49-68. - Stephens, Michael D.; Roderick, G. W. « The Muspratts of Liverpool, » Ann.
Sci. 1972, 29, 287-311. - Haber, L. F. « The Chemical Industry During the Nineteenth Century »; The
Clarendon Press: Oxford, 1958; chapters 2, 4. - Ibid., pp. 21-22.
- Ure, A. « The Philosophy of Manufactures or an Exposition of the Scientific,
Moral and Commercial Economy of the Factory System of Great Britain »;
Frank Cass and Co: London, 1967; p. 2. - Babbage, C. « On the Economy of Machinery and Manufactures »; Carey and
Lea: Philadelphia, 1832; p. 39. - Ibid., p. 31.
- Ibid., pp. 275-6.
- Stephens, M. D.; Roderick, G. W. ‘lhe Muspratts of Liverpool, » Ann. Sci.
1972, 29, 310. - Cardwell, D. S. L. « The Organisation of Science in England »; Heinemann:
London, 1972; p. 173. - Reference withdrawn.
- Ibid., pp. 248-9.
- Russel, C.; Coley, N. G.; Roberts G. K. « Chemists by Profession-The
Origins and Rise of the Royal Institute of Chemistry »; The Open University:
Walton Hall, Milton Keynes, 1977; p. 190. - MacLeod, R. M. « The Support of Victorian Science: the Endowment of
Research Movement in Great Britain, 1868-1900, » Minerva 1971, 9, 197-
230. - Cardwell, D. S. L. « The Organisation of Science in England »; Heinemann:
London, 1972; p. 157. - Stephens, M. D.; Roderick, G. W. « The Muspratts of Liverpool, » Ann. Sci.
1972, 29, 310-311. - Ibid., 306.
- Ibid.
- Ibid., 307.
- Cardwell, D. S. L. « The Organisation of Science in England »; Heinemann:
London, 1972; p. 173. - Drew, W. N. Trans. Inst. Chern. Eng. 1924, 2, 18.
- Cardwell, D. S. L. ‘lhe Organisation of Science in England »; Heinemann:
London, 1972; Chapters 5, 6. - Ibid., p. Ill.
- Stephens, M. D.; Roderick, G. W. « The Muspratts of Liverpool, » Ann. Sci.
1972, 29, 294. - Ibid., 311.
- Barine, A. « La nn de Carthage, » Revue des deux mondes 1896, 137, 362-377.
- Ibid., 373.
- Russel, C.; Coley, N. G.; Roberts, G. K. « Chemists by Profession-the
Origins and Rise of the Royal Institute of Chemistry »; The Open University:
Walton Hall, Milton Keynes, 1977; p. 191. - Ibid.
- Cardwell, D. S. L. « The Organisation of Science in England »; Heinemann:
London, 1972; pp. 204-207. - Ibid., pp. 209-217.
- Russel, C.; Coley, N. G.; Roberts, G. K. « Chemists by Profession-the
Origins and Rise of the Royal Institute of Chemistry »; The Open University:
Walton Hall, Milton Keynes, 1977; p. 190. - Cardwell, D. S. L. « The Organisation of Science in England »; Heinemann:
London, 1972; p. 217. - Ibid., p. 215.
- Landes, D. S. « The Unbound Prometheus »; The University Press:
Cambridge, 1970; p. 273. - Trans. Inst. Chern. Eng. 1923, 1, viii.
- Trans. Inst. Chern. Eng. 1924, 2, 8.
- Duckham, Sir Arthur. « Presidential Address, » Trans. Inst. Chern. Eng. 19!4,
2, 15. - Trans. Inst. Chern. Eng. 1923, 1, ix.
- Davidson, W. B. « Book Review of ‘Principles of Chemical Engineering,' » J.
Soc. Chern. Ind. 1923, 42, 1117. - Donnan. J. Soc. Chern. Ind. 1916, 35, 1190.
- Elliott, M. A. Trans. Inst. Chern. Eng. 1924, 2, 19.
- Reese, C. L. « Presidential Address, » Trans. lnst. Chern. Eng. 1925, 3, 13.
- Duckham, Sir Arthur. « Presidential Address, » Trans. Inst. Chern. Eng. 1924,
2, 16.
- Thepot, A., submitted for publication in Actes de Colloque Gay-Lussac.
- Leon, A. « Histoire de l’education technique »; Presses universitaires de
France: Paris, 1961. - Leon, A. « La Revolution franaise et l’education technique » Societe des
etudes robespierristes: Paris, 1968. - Monteil, F. « Histoire de l’ enseignement en France »; Sirey: Paris, 1966.
- Anon. « De la necessite de la creation d’une grande ecole de chimie pratique
et industrielle sous Ie patronage de la societe chimique de Paris »; Dupont:
Paris, 1891. - Ibid., p. 9..
- Ibid.
- Ibid.
- Ibid., p. 12.
- Lauth, C. « Ra.prt general sur l’historique et Ie fonctionnement de l’Ecole
municipale de physique et de chimie industrielles »; Imprimerie generale La
Hure: Paris, 1900. - Anon. « De la necessite de la creation d’une grande ecole de chimie pratique
et industrielle sous Ie patronage de la societe chimique de Paris »; Dupont:
Paris, 1891; p. 10. - Ponteil, F. « Histoire de l’ enseignement en France »; Sirey: Paris, 1966; p.
314. - Mouton, M. R. « L’enseignement superieur en France de 1890 a nos jours
(etude statistique) » in « La scolarisation en France depuis un siecle »;
Mouton: Paris, 1974; p. 176. - Leclerc, M. « La formation des ingenieurs a l’Etranger et en France »; A.
Colin: Paris, 1917; p. 102. - Mouton, M. R. « L’enseignement superieur en France de 1890 a nos jours
(etude statistique) » in « La scolarisation en France depuis un siecle »;
Mouton, Paris, 1974; p. 193. - Ibid., p. 177.
- Le Chatelier, H. Rev. Int. I’Enseignement 1909, 58, 45.
- Gosselet, J. « L’ enseignement des sciences appliquees dans les universites »;
Rev. Int. I’Enseignement 1899 37, 97-107. - « Enquete sur l’enseignement technique dans les universites franaises, » Rev.
Int. I’Enseignement 1909, 57, 252. - Ibid., 257.
- Genvresse, P. « La chimie appliquee a l’Universite de Besann, » Rev. Int.
I’Enseignement 1898, 35, 32-34. - Genvresse, P. « La chimie industrielle a l’Universite de Besann, » Rev. Int.
I’Enseignement 1902, 44, 311-312. - « Enquete sur l’enseignement technique dans les universites franses, » Rev.
Int. I’Enseinement 1909, 57, 333-334. - Bichat, E. « L enseignement des science appliquees a la Faculte des sciences
de Nancy, » Rev. Int. I’Enseignement 1898, 35, 299-307. - « Enquete sur l’enseignement technique dans les universites francaises, » Rev.
Int. I’Enseignement 1909, 57, 343. - Buisine. « Les laboratoires de chimie appliquee a la Faculte des sciences de
Lille, » Rev. Int. I’Enseignement 1897, 34, 11-15. - « Enquete sur l’ enseignement technique dans les universites franaises, » Rev.
Int. l’Enseignement 1909, 57, 423. - Vezes, M. « Une foundation regionale-Ie laboratoire des resines a l’Univer-
site de Bordeaux, » Rev. Int. I’Enseignement 1901, 41, 118-26. - Gayon, U. « L’enseignement de la chimie appliquee a la Faculte des sciences
de Bordeaux, » Rev. Int. I’Enseignement 1898, 36, 397-400. - « Enquete sur l’Enseignement technique dans les universites francaises, » Rev.
Int. I’Enseignement 1909, 57, 343. - Ibid., 424-431.
- Cavelier, J. « L’enseignement de la chimie appliquee a rUniversite de Ren-
nes, » Rev. Int. I’Enseignement 1899, 38, 490-493. - Gernez, D. « L’Ecole de chimie industrielle annexee a la Faculte des sciences
de Lyon, » Rev. Int. I’Enseignement 1895, 30, 39-42. - Friedel, Ch. « La chimie appliquee a la Faculte des sciences de Paris, » Rev.
Int. I’Enseignement 1898, 36, 481-487. - Partington, J. R. « A History of Chemistry »; MacMillan: London, 1964; Vol.
IV, p. 858. - Barthelet, E. « L’Ecole d’ingenieurs de Marseille, » Rev. Int. l’Enseignement
1901, 42, 218-223. - Vezes, M. « Une fondation regionale-le laboratoire des resines a rUniversite
de Bordeaux, » Rev. Int. I’Enseignement, 1901, 42, 119. - Matagrin, A. « L’lndustrie des produits chimiques et ses travailleurs »; Doin:
Paris, 1925; p. 328. - Ibid., p. 349.
- Ibid., p. 329.
- Ibid., p. 308.
- Ibid., p. 318.
- Ibid. -l p. 319.
- Frieael, Ch. « La chimie appliquee a la Faculte des sciences de Paris, » Rev.
Int. I’Enseignement 1898, 36, 482. - Levy-Leboyer M. « Le atronat franais a-t-il ete malthusien?, » Le Mouve-
ment social 1974, (88), 3-50. - Friedel, Ch. « La chimie appliquee a la Faculte des sciences de Paris,’ Rev.
Int. I’Enseignement 1898, 36, 482. - Genvresse, P. « Relation resumee d’un voyage dans des universites francaises
et etrangeres, » Rev. Int. I’Enseignement 1898, 36, 298. - Matagrin, A. « L’lndustrie des produits chimiques et ses travailleurs »; Doin:
Paris, 1925; p. 56. - Haller, A. « L’industrie chimique »; J. B. Bailliere et 6.1s: Paris, 1895; p. 44.
- C him. Ind. (Paris) 1934, 31, 812.
lOO. Blondel, G. « L’essor industriel et commercial du peuple allemand »;
Librairie de la Societe du recueil general des lois et des arrets: Paris, 1900. - Levy, R.-G. « L’industrie allemande, » Rev. Deux Mondes 1898, 145, 806-
838. - Cambon, V. L’Allemagne au travail 1909, 13-29.
- E. H. « To the Editor, » Engineering 1901, 72, 263.
- Lexis, W. « A General View of the History and Organisation of Public
Education in the German Empire »; A. Asher: Berlin, 1904. - Schoen, H. « L’enseignement superieur technique en Allemagne, » Rev. Int.
I’Enseignement 1909, 57, 217. - Lexis, W. « A General View of the History and Organisation of Public
Education in the Gennan Empire »; A. Asher: Berlin, 1904; pp. 135-136. - Cambon, V. L’Allemagne au travail 1901, 72, 263.
- Lexis, W. « A General View of the History and Organisation of Public
Education in the German Empire »; A. Asher: Berlin, 1904; 217. - Schoen, H. « L’enseignement superieur technique en Allemagne, » Rev. Int.
I’Enseignement 1909, 57, 217. - Pyenson, L.; Skoyp, D. « Educating Physicists in Gennany circa 1900, »
Social Studies oJ Science 1977, 7, 332.
Ill. Lexis, W. « A General View of the History and Organisation of Public
Education in the German Empire »; A. Asher: Berlin, 1904; 137. - Cambon, V. L’Aliemagne au travail 1901, 72, 16-29.
- Beer, J. J. « The Emergence of the Gennan Dye Industry »; University of
Illinois Press: Urbana, Illinois, 1959; p. 146n. - Cambon, V. L’Aliemagne au travail 1901, 72, 184-185.
- Lery, R.-G. « L’industrie allemande, » Rev. Deux Mondes 1898, 14.5, 811.
- Beilby, G. T. « Chemical Engineering, » J. Soc. Chern. Ind. 1915, 34, 771.
- Beer, J. J. ‘the Emergence of the Gennan Dye Industry »; University of
Illinois Press: Urbana, Illinois, 1959; p. 76. - Ibid., p. 77.
- Ibid., p. 65.
- Ibid., p. 76.
- Ibid., p. 79.
- Ibid.
- Duisberg, C. « The Education of Chemists, » J. Soc. Chem. Ind. July 1931,
173-174. - Ibid., 174.
- Beer, J. J. « The Emergence of the Gennan Dye Industry »; University of
Illinois Press: Urbana, Illinois, 1959; p. 146 n. - Ibid.
- Ibid.
- Cambon, V. L’Aliemagne au travail 1901, 72, 50.
- Beer, J. J. « The Emergence of the Gennan Dye Industry »; University of
Illinois Press: Urbana, Illinois, 1959; p. 89. - Ibid., p. 108.
- Ost, H. « Die chemische Technologie an den Technischen Hochschulen, »
Zeitschrift fur angewandte Chemie 1900, 27, 660. - Ibid.
- Ibid.
- Flechtner, H.-J. « Carl Duisberg-vom Chemiker zum Wirtschafts-fiihrer »;
Econ-Verlag GMBH: Dusseldorf, 1960; passim. - Mahan, J. « L’essor de 1’1. G. Farben et Ie recrutement de ses cadres
superieurs, » Chim. Ind. (Paris) 1949, 61, 503. - Ibid.,. 504.
- Fletchtner, H.-J. « Carl Duisberg-vom Chemiker zum Wirtschaftsfiihrer »;
Econ-Verlas GMBH: Dusseldorf, 1960; passim. - Bucholz, K. ‘Verfahrenstechnik (Chemical Engineering)-Its Development,
Present State and Structures, » Social Studies of Science 1979, 9, 33-62.
RECEIVED May 7, 1979.
L’Exploit Improbable : Le Génie Chimique au MIT H.C. WEBER Département de Génie Chimique, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA 02139
Parfois, dans presque n’importe quel domaine, se développe, à partir d’un début modeste, un exploit qui croît rapidement et atteint un état d’excellence à peine prévu. L’éducation en génie chimique, qui a commencé au MIT il y a près de 90 ans, est un exemple exceptionnel d’un tel exploit. Il devait y avoir certaines conditions exceptionnellement favorables et un choix heureux du personnel, non seulement pour rendre un tel résultat possible, mais aussi pour permettre à ce département de génie chimique de maintenir sa position de prestige mondial au fil des ans. Les raisons possibles du succès du département, ainsi que les personnalités et les réalisations de nombreux de ses membres, seront retracées dans les pages qui suivent.
Les Débuts
En 1888, le professeur Lewis Mills Norton fonda le cours de génie chimique dans le département de chimie du MIT. Ce cours serait probablement appelé aujourd’hui Chimie Industrielle. Il était principalement descriptif et se composait d’une série de conférences décrivant la fabrication commerciale de produits chimiques utilisés dans l’industrie. Le matériel était en grande partie tiré de la pratique allemande. Le développement précoce de l’intérêt des étudiants pour le génie chimique est attesté par l’octroi en 1891 de sept diplômes de premier cycle dans ce nouveau domaine, contre 11 dans le domaine plus traditionnel de la chimie. Norton décéda en 1893, mais le génie chimique continua de se développer sous la direction du professeur Frank Hall Thorpe, ’89, dont Outlines of Industrial Chemistry fut publié pour la première fois en 1898.
1 Adresse actuelle : La Hacienda, 10333 W. Olive #F179, Peoria, AZ 85345.
Arthur A. Noyes a indirectement mais très significativement influencé le développement ultérieur du génie chimique au M.I.T. Noyes a obtenu son diplôme de maîtrise en chimie à l’Institut en 1887. Après des études supérieures en Allemagne, il est retourné au M.I.T. et a entamé une brillante carrière en chimie physique. Plus tard, il a servi comme président par intérim de l’Institut jusqu’à ce qu’un chef permanent soit trouvé. Le Dr Noyes avait fermement en tête la création d’un laboratoire de recherche en chimie physique, allant même jusqu’à offrir de financer un laboratoire de ce type pendant trois ans avec ses propres fonds. Le 20 septembre 1903, un tel laboratoire a été ouvert et, sous la direction de Noyes, a acquis une reconnaissance mondiale. Il faut se rappeler qu’à cette époque, peu de recherches chimiques étaient effectuées aux États-Unis.
William H. Walker était un associé de Noyes au département de chimie. Walker, peut-être en raison d’un contact étroit avec le laboratoire de recherche en chimie physique, a vu la nécessité d’un laboratoire de recherche en chimie appliquée et a fondé un laboratoire de ce type en 1908. Walker a assumé la responsabilité du génie chimique en 1912 et a occupé ce poste jusqu’en 1920.
Un autre nom étroitement associé au génie chimique au cours de ses premières années de développement était celui d’Arthur D. Little, M.I.T. ’85. Little n’était pas membre du corps professoral, mais il était profondément intéressé par l’éducation en génie chimique. Pendant plusieurs années, lui et Walker ont dirigé le cabinet Little and Walker à Boston, l’un des premiers cabinets de conseil industriel. Plus tard, le cabinet Little and Walker est devenu Arthur D. Little, Inc. Walker et Little avaient une vision extraordinaire et une capacité d’expression claire et percutante. Ils ont énoncé quatre concepts fondamentaux qui ont formé la base sur laquelle le génie chimique au M.I.T. a été construit.
Ceux-ci sont :
- Le regroupement de certaines étapes communes à la plupart des processus industriels, c’est-à-dire le transfert de chaleur, la distillation, l’écoulement des fluides, la filtration, le concassage et le broyage, et la cristallisation, pour n’en citer que quelques-unes. Ils ont appelé cela des opérations unitaires, à étudier en tant que telles, indépendamment de l’industrie particulière à laquelle elles appartenaient. Cette idée a unifié et considérablement simplifié l’étude des processus chimiques industriels.
- La création d’un laboratoire de recherche en chimie appliquée où l’industrie pouvait faire travailler une équipe d’experts, de membres du corps professoral et d’associés ou assistants de recherche sur des problèmes spécifiques, moyennant des frais. Cette idée a été élargie plus tard à tous les départements du M.I.T. par la création de la Division de la coopération industrielle. Le nom de cette dernière a été changé plus tard en Division de la recherche parrainée. L’un des résultats ultérieurs de cette organisation précoce pour servir l’industrie a été le Bureau de liaison industrielle, qui rapporterait à terme 2 000 000 $ par an de fonds non restreints.
- Une école de pratique en génie chimique où les étudiants, dans une usine industrielle, mais sous la direction d’un professeur, effectuaient des essais et des études en génie chimique significatifs pour le fonctionnement de l’usine.
- Un concept important, développé par Noyes et fortement préconisé par Walker et Little, était l’utilisation de la méthode du cas et du problème dans l’enseignement en classe au lieu du système de conférences alors plus courant.
En 1901, Warren K. Lewis est entré au M.I.T. en tant qu’étudiant en génie mécanique, mais un an plus tard, il est passé au cours de génie chimique offert par le département de chimie. Après l’obtention de son diplôme, Lewis a étudié à l’Université de Breslau en Allemagne, revenant aux États-Unis avec un doctorat en 1908. En 1910, après une courte période dans l’industrie, il a été attiré de nouveau au M.I.T. en tant que professeur adjoint en génie chimique, en grande partie grâce à l’incitation de Walker. (En 1909, le nombre de diplômes décernés dans l’option de génie chimique avait dépassé celui de la chimie). En 1920, le génie chimique est devenu un département distinct. Warren K. Lewis en est devenu le premier chef, poste qu’il a occupé jusqu’en 1929, date à laquelle il a démissionné pour consacrer tout son temps à l’enseignement.
Même avec un tel noyau exceptionnel, il est douteux que le génie chimique au M.I.T. aurait pu atteindre sa position de prestige sans l’aide d’une administration, sous la présidence de MacLaurin, qui était très favorable aux objectifs de l’éducation et de la recherche. Le président MacLaurin soutenait pleinement Walker et Lewis et, avec l’aide d’Arthur D. Little, a réussi à obtenir de George Eastman un don de 300 000 $ pour établir la première école de pratique en génie chimique.
Walker et Noyes étaient des personnalités complètement différentes. Walker était un penseur qualitatif et imaginatif. Il était concis et allait droit au but, presque abrupt dans sa manière d’être. Il était loyal à l’excès envers ses collègues tant qu’ils étaient sincères et honnêtes. À un moment donné, Walker avait une question sur la loi de Raoult. Il savait que Noyes aurait la réponse, mais il hésitait à la lui demander. Au lieu de cela, il envoya Lewis, alors jeune professeur, au bureau de Noyes. Lorsque Lewis revint, Walker lui demanda si Noyes avait mis du temps à répondre. Lorsque Lewis dit que Noyes n’avait pas répondu immédiatement, Walker dit : « C’est bien, je ne suis pas si stupide que ça » (1). Walker n’aimait pas perdre de temps. Il disait souvent : « Un ingénieur qui joue modérément bien au billard a fait preuve de jugement ; s’il joue excellemment, il a gaspillé son temps » (1). Walker accusait à plusieurs reprises les personnes bavardes d’avoir une diarrhée de mots et une constipation d’idées. Il pouvait s’exprimer clairement et avec une beauté dans le choix des mots remarquable. En raison de son talent, il était très demandé comme expert dans les litiges de brevets. Naturellement, Walker était un conférencier exceptionnel. Après son départ du M.I.T., chaque révision du texte de Walker, Lewis et McAdams perdait quelque chose dans les parties réécrites sans l’aide de Walker.
Noyes, en revanche, était un expérimentateur exceptionnel et méthodique, doté d’une grande compétence technique et d’imagination. Il était gentil, discret et un véritable gentleman. Il était très patient avec les étudiants. Son livre « Principles of Physical Chemistry », écrit avec Miles Sherrill, était exceptionnel par sa concision et sa couverture. Ce livre, ainsi que les notes sur le génie chimique développées par Lewis et Walker, rendaient la vie tout sauf facile pour les étudiants du cours X dans cette période de 1914 à 1923. Les étudiants de cette époque se souviennent vivement de ces notes, difficiles à lire, dupliquées sur une vieille machine à mimeographie, avec des pochoirs tapés à la machine à écrire qui rendaient tous les petits « e » et « o » identiques, juste un point noir rond solide. Les notes contenaient de nombreuses erreurs, et souvent, Lewis passait beaucoup de temps en classe à interpréter ce que les notes étaient censées dire. Ces notes ont été révisées et utilisées en classe pendant plusieurs années. Vers 1920, Walker, Lewis et McAdams, avec quelques étudiants diplômés, ont passé l’été dans la résidence d’été de Walker dans le Maine. Ils sont revenus à l’automne avec un manuscrit essentiellement complet. Cela a abouti au soi-disant « Bible », « Principles of Chemical Engineering », qui a sans aucun doute jeté les bases mondiales du génie chimique quantitatif. Au fil des années, il est devenu de plus en plus évident que Walker et Noyes, deux hommes forts aux personnalités si contrastées, ne pouvaient pas continuer à travailler harmonieusement dans le même département. Le Dr MacLaurin rencontra un jour Walker dans un couloir de l’Institut et lui dit : « Docteur Walker, j’ai entendu dire qu’il y avait des frictions dans votre département ». Walker répondit : « Docteur MacLaurin, vous êtes physicien ; vous savez que vous ne pouvez pas avoir de mouvement sans friction » (1). Un proche collaborateur du Dr MacLaurin lui dit qu’il pensait qu’il perdrait l’un de ces hommes précieux. MacLaurin répondit : « J’ai bien peur de les perdre tous les deux » (1). Depuis 1913, Noyes aidait à la transformation du collège Throop à Pasadena en Institut de technologie de Californie. En 1920, il démissionna de son poste de professeur au M.I.T. Jusqu’à sa mort en 1936, il contribua à faire de Cal Tech l’école exceptionnelle qu’elle est aujourd’hui.
Walker était brièvement revenu au M.I.T. après la Première Guerre mondiale, mais il partit au début des années 1920 pour se consacrer à temps plein à la consultation. On peut se demander si le départ de l’un de ces deux hommes forts a influencé l’autre à quitter également l’Institut. Comme MacLaurin l’avait supposé, deux hommes exceptionnels ont été perdus pour le M.I.T. Walker est décédé dans un accident de voiture précédé d’une crise cardiaque en 1934. En termes de personnalité, Lewis différait considérablement de Walker. Il réduisait généralement sa pensée à une base quantitative, tandis que la pensée de Walker était essentiellement qualitative. Lewis avait une remarquable capacité à tirer des informations à partir de quelques faits et d’un modèle relativement simple. À plusieurs reprises, en n’utilisant que des bilans matière et énergie, il était capable de développer des relations inattendues. Il était bombastique par nature et presque explosif en classe. En entrant dans un amphithéâtre, il enlevait souvent sa veste, la roulait en un paquet, la plaçait à l’extrémité de la table de conférence, retroussait ses manches, gonflait ses joues, lançait un regard furieux à sa classe, puis posait souvent littéralement une question à un étudiant inconscient. Dans son domaine, il était brillant, et pour la plupart de ses étudiants, il était un excellent et aimé enseignant. Il aimait une discussion animée et prenait un réel plaisir à battre ses adversaires. Il avait un faible pour poser une question à laquelle la réponse évidente était la mauvaise. Il détestait perdre une argumentation et avait toutes sortes de stratagèmes pour déstabiliser son adversaire, changeant souvent la base de l’argumentation s’il sentait qu’il était en train de perdre. Il a fallu beaucoup de temps à d’autres pour réaliser qu’il lisait souvent un fait obscur dans une encyclopédie, puis posait une question à laquelle ses auditeurs ne pouvaient pas répondre.
Bien que Lewis s’habillât soigneusement, il ne se souciait pas particulièrement des vêtements, et il ne fumait ni ne buvait jamais. Cependant, pour une raison inexpliquée, il y a de nombreuses années, il est apparu avec une montre de poche, une chaîne drapée sur son gilet, et au bout de la chaîne, un coupe-cigare qui servait à couper les extrémités des cigares. Il portait également un briquet de poche. Ces ornements ont duré environ une semaine, puis ont disparu pour toujours. Lewis était profondément religieux et était actif dans son église. Un jour, en discutant d’un problème mondial avec un collaborateur, son collaborateur lui demanda : « Docteur, vous ne faites pas confiance au Seigneur ? » « Si », dit-il, « mais parfois je suis bien fichu si je peux comprendre Ses méthodes » (1). Il était extrêmement économe et ne gaspillait jamais rien. Horace Ford, qui a si bien servi le M.I.T. en tant que trésorier pendant de nombreuses années, a un jour remarqué qu’il était étonné de voir tout ce que Willy Walker et Warren Lewis pouvaient faire en génie chimique avec du matériel qui était principalement fait de casseroles, de poêles et de morceaux de tuyaux.
Lewis réalisait que la musique et le théâtre avaient leur place, mais n’a jamais mentionné à ses collègues avoir assisté à un concert. Il a mentionné être allé à une représentation d' »Abraham Lincoln » et en a parlé à plusieurs reprises, mais ne semblait pas avoir un intérêt actif pour le théâtre. Un jour, en déjeunant avec un jeune professeur, il a vanté les avantages culturels de Boston, soulignant spécifiquement le musée d’art. Un de ses collègues plus âgés lui demanda : « Mais docteur, avez-vous déjà visité le musée d’art ? » Il répondit : « Non, mais ce n’est pas une raison pour que ce jeune freluquet ne le fasse pas ! » (1).
Le docteur aimait particulièrement raconter des histoires avec une morale. Il les appelait des « yams ». Beaucoup des histoires qu’il racontait ont été rassemblées et reliées dans un petit volume intitulé « A Dollar to a Doughnut ». Il se sentait redevable envers Walker et le mentionnait fréquemment au fil des ans. Voici donc l’homme qui a développé le programme de génie chimique si audacieusement esquissé par Little et Walker. Il s’est entouré dès le début d’hommes prometteurs dans leurs domaines respectifs. Cela comprenait William McAdams, Clark Robinson, Robert Haslam, Walter Whitman, Harold Weber et William Ryan, qui est malheureusement décédé en 1933. Robinson est décédé à la fin des années 1940, Haslam au début des années 1960 et Whitman, Lewis et McAdams au début des années 1970. Pendant la période du milieu des années 1920 à la Seconde Guerre mondiale, Ernst Hauser, Hoyt Hottel, Thomas Sherwood, Edwin Gilliland, Herman Meissner, Glenn Williams et Edward Vivian ont été ajoutés. Ces hommes ont constitué le cadre sur lequel le personnel actuel a été construit.
La Première Guerre mondiale a beaucoup perturbé les opérations à l’Institut et interrompu temporairement le progrès éducatif, en particulier dans les domaines de la chimie et du génie chimique. L’utilisation allemande de la guerre chimique a pris les États-Unis au dépourvu. Il y avait un besoin immédiat de recherche chimique et de chimistes et ingénieurs chimistes pour élaborer une position offensive et défensive pour les États-Unis. Le personnel de chimie et de génie chimique a répondu en nombre. Noyes est allé à Washington en tant que président du Conseil national de la recherche. Walker a accepté un poste de colonel dans le nouveau Chemical Warfare Service, et Lewis, en tant que civil, a dirigé l’une des divisions de recherche et développement du nouveau service. Il y avait d’innombrables endroits où des ingénieurs chimistes étaient nécessaires, et relativement peu étaient disponibles. Walker et Lewis se sont tournés en grande partie vers les étudiants diplômés en génie chimique, puis vers les étudiants en dernière année au M.I.T., et enfin vers les membres de la classe junior. McAdams, alors étudiant diplômé en génie chimique transféré de l’Université du Kentucky, a accepté un poste de capitaine et a été envoyé presque immédiatement à Cleveland dans une unité ultra-secrète créée pour développer un processus industriel de production de gaz moutarde. On l’appelait la « Mousetrap » car tous les travailleurs qui y étaient affectés étaient, pour des raisons de sécurité, complètement isolés du monde extérieur. Robert E. Wilson, M.I.T. ’16, plus tard directeur du laboratoire de recherche en chimie appliquée, puis directeur de la recherche chez Standard Oil of Indiana et membre de la Commission de l’énergie atomique, est devenu major et a travaillé sur les charbons adsorbants pour les masques à gaz. Weber et Ryan, juniors en génie chimique et futurs membres du corps professoral, ont servi en tant que lieutenants sous Walker et Lewis, effectuant des travaux dans la construction et le fonctionnement d’usines de guerre chimique. Walker a construit et exploité Edgewood Arsenal, le premier établissement de guerre chimique de l’armée. Avec la fin de la guerre, le M.I.T. s’est à nouveau tourné vers son objectif principal : l’éducation.
Une première entreprise après la fin de la Première Guerre mondiale a été la reconstitution du personnel de génie chimique, qui avait été si fortement réduit par les demandes de guerre chimique, et de l’école pratique qui, bien qu’elle ait commencé en 1916, avait été fermée en raison de la guerre. Bientôt, McAdams est revenu en tant que membre du corps professoral. Il a presque immédiatement commencé des recherches sur la transmission de chaleur, un sujet qui allait être son travail de toute une vie. Robinson et Whitman, bien qu’actifs dans le travail de guerre, avaient maintenu une sorte d’enseignement et n’avaient pas quitté Cambridge. En 1920, le génie chimique est devenu le cours X, un département entièrement séparé de la chimie, et W. K. Lewis en a été nommé le premier responsable.
Bien que le concept général des opérations unitaires ait été développé par Walker et Little plus tôt, une incarnation quantitative n’a pas vraiment vu le jour avant environ 1920. Les expressions quantitatives réelles permettant d’effectuer des calculs étaient à cette époque presque exclusivement le travail de Lewis, Walker et McAdams. L’édition originale de Principles of Chemical Engineering a été suivie d’une deuxième édition, puis d’une troisième dans laquelle Gilliland était un quatrième auteur. Un des forts intérêts de Lewis était la combustion, les fours et la production de gaz. Au début des années 1920, Robert T. Haslam, qui avait rejoint le corps professoral après la Première Guerre mondiale, a choisi cette partie de l’intérêt de Lewis comme son domaine de spécialisation et a commencé avec Robert P. Russell du Research Laboratory of Applied Chemistry à rassembler du matériel pour un livre, Fuels and their Combustion, un volume de référence. Ce domaine était si important que Haslam envisageait la possibilité d’une division de génie chimique séparée dans ce domaine ou peut-être un cours séparé. Le génie des carburants et du gaz a en effet maintenu une identité séparée pendant plusieurs années, mais est revenu au génie chimique en 1932.
En 1924, le département a décerné ses premiers doctorats en sciences à John Keats et Charles Herty ; en 1925 à Per Frolich, Wayne Rembert et Ernest Thiele. C’était unique parmi les départements d’ingénierie du M.I.T. ; les autres n’étaient pas encore convaincus que les ingénieurs méritaient une éducation au niveau doctoral.
Dans les années 1920, la demande d’essence a augmenté à un point tel que l’essence naturelle ne pouvait pas être produite en quantités suffisantes pour satisfaire les besoins en carburant liés à l’augmentation explosive du nombre d’automobiles. Le craquage thermique était la solution, et les relations quantitatives pour le transfert de chaleur, l’écoulement des fluides et la distillation, toutes des opérations unitaires, offraient à l’industrie pétrolière la possibilité de concevoir des unités de craquage sur une base quantitative plutôt que strictement empirique. Les principales compagnies pétrolières ont rapidement embauché un grand nombre d’ingénieurs chimistes du M.I.T., et pendant plusieurs années, ces hommes ont pratiquement dominé l’industrie. Le corps professoral senior du génie chimique a été presque entièrement engagé en tant que consultants ou employés permanents par l’industrie pétrolière. De plus, les assistants et les associés de recherche des années 1920 et du début des années 1930 du département et de son laboratoire de recherche en chimie appliquée ont fourni une impressionnante liste d’hommes qui ont atteint des postes élevés dans l’industrie pétrolière.
Bien que les opérations unitaires aient été la base des premières conceptions d’usines, il n’existait aucune méthode adéquate pour déterminer les relations pression-volume-température (PVT) pour les mélanges de gaz aux températures et pressions élevées rencontrées dans de nombreuses industries, par exemple le raffinage du pétrole. Au début des années 1930, Weber et Meissner ont développé une approximation basée sur les propriétés critiques réduites des gaz qui a résolu ce problème, non pas quantitativement d’un point de vue de la chimie physique, mais assez bien pour des fins d’ingénierie. Peu de temps après, Lewis, Cope et Weber ont publié sous forme graphique les fameux graphiques « MU » basés sur le travail de Weber et Meissner. Pendant plusieurs décennies, ils ont constitué la base pour les calculs impliquant des mélanges gazeux à des pressions et des températures élevées.
Le fourneau de craquage était un autre maillon faible dans le craquage thermique pour produire de l’essence, et les diagrammes de rayonnement gazeux issus des recherches de Hottel sont devenus du matériel de base standard pour la conception industrielle des fours, en particulier dans l’industrie pétrolière. Il était peut-être fortuit que la croissance explosive de cette industrie, qui avait tellement besoin des concepts évoluant dans le cours X au M.I.T., se produise juste au moment où ces concepts maturaient. Ou était-ce la prévoyance et le bon jugement de personnes telles que Little, Walker et Lewis ?
C’est à cette époque qu’une tentative sérieuse a été faite pour reproduire dans le domaine des industries amorphes – plastiques, caoutchouc, etc. – les progrès éducatifs similaires à ceux réalisés dans les industries des produits chimiques lourds. Ernst Hauser a été ajouté au corps professoral pour aider au développement de méthodes éducatives en chimie industrielle des colloïdes, et des livres de Hauser et de Lewis, Squires et Broughton ont été publiés.
Dans les années 1930, la méthode du lit fluidisé pour manipuler des mélanges réactifs de solides et de gaz, développée à l’origine en Allemagne, a été portée à un état de pratique industrielle par Lewis et Gilliland avec le soutien financier de l’industrie. Ce processus est largement utilisé par l’industrie pétrolière pour produire de l’essence par craquage catalytique.
Lorsque Lewis a démissionné de son poste de chef de département en 1929, il a été remplacé par William P. Ryan. Ryan est décédé subitement en 1933, et après une brève période de gestion sous la direction de Lewis, Walter Whitman a été rappelé de l’industrie pour diriger le département. Sa direction a été la plus longue de l’histoire du département.
En plus du classique « Principles of Chemical Engineering » et de « Fuels and their Combustion », les textes et ouvrages de référence rédigés par le personnel du département étaient significatifs et nombreux. Un texte sur la distillation par Robinson, qui a ensuite été publié dans une deuxième, troisième et quatrième édition par Robinson et Gilliland, a été largement salué non seulement par la profession d’ingénieur mais aussi par les contrebandiers pendant la période de la prohibition. Robinson a également publié, avec Hitchcock du département de mathématiques du M.I.T., un livre intitulé « Differential Equations », avec des applications dans le domaine du génie chimique. Lewis et Radasch ont publié leur livre largement utilisé, « Industrial Stoichiometry ». McAdams a publié son traité de référence, « Heat Transmission », suivi de deuxième et troisième éditions, traduites en cinq langues. Sherwood a publié son texte « Absorption and Extraction ». Sherwood et Charles E. Reed ont publié un livre largement utilisé, « Applied Mathematics in Chemical Engineering ». Weber, et plus tard dans une deuxième édition avec Meissner, ont publié « Thermodynamics for Chemical Engineers », un seul texte couvrant, pour la première fois peut-être, les trois domaines de la thermodynamique physique, chimique et du génie. Ernst Hauser a publié « Colloidal Phenomena », et Hottel a développé des diagrammes Mollier pour les calculs de combustion et, avec Williams et Satterfield, a publié « Thermodynamic Charts for Combustion Processes ». Pour compléter l’enregistrement – même s’il couvre une période plus longue que le reste de ce chapitre – une liste complète des 50 ouvrages environ (sans compter les deuxième et troisième éditions) publiés par le corps professoral de génie chimique du M.I.T. jusqu’en 1977 figure dans l’annexe. Malgré cette liste significative de publications, le département continue de s’appuyer, dans une large mesure, sur des notes dactylographiées modifiées d’année en année.
La Practice School
Un jeune ingénieur chimiste déjà mentionné, Robert T. Haslam, avait obtenu son diplôme du M.I.T. en 1911 et avait rejoint la National Carbon Company. Il avait impressionné Lewis pendant ses activités de guerre. Avec la fin de la guerre, Lewis ramena Haslam à Cambridge en tant que directeur général de la School of Chemical Engineering Practice, bientôt rétablie. Lewis fit également venir d’abord William P. Ryan, puis Harold C. Weber en tant que directeurs de la Practice School. Ryan était responsable de la station de Bangor, située à la Eastern Manufacturing Company et à la Penobscot Chemical Fiber Company, toutes deux des fabricants de papier et de pâte à papier. Whitman fut nommé directeur de la station de Boston, située à la Merrimac Chemical Company à Woburn, dans le Massachusetts, et à la Revere Sugar Refinery à Charlestown. D. W. Wilson était directeur de la Lackawanna Plant de la Bethlehem Steel Company à Buffalo, New York. Les directions ont rapidement changé, Ralph Price, puis Frederick Adams, M.I.T., ’21, étant placés à Bangor, Weber à Boston et Ryan à Buffalo. Whitman, Ryan et Weber, après quelques années en tant que directeurs de la Practice School, sont retournés à l’équipe à Cambridge.
Les étudiants de la Practice School restaient huit semaines à chaque station, puis passaient aux autres stations. L’inscription était limitée à trois groupes de 12 étudiants chacun. Le cours était appelé X-A. Étant donné que la fréquentation des trois stations ne couvrait qu’un total de 24 semaines, huit à chaque station (pour lesquelles un étudiant recevait un crédit complet du M.I.T.), les étudiants revenaient pour le reste de l’année afin de suivre des cours spéciaux donnés par le personnel de la Practice School et réservés uniquement aux étudiants de la Practice School. Il est intéressant de noter que pendant cette période du début des années 1920, Thomas K. Sherwood et Hoyt Hottel étaient tous deux étudiants de la Practice School et que l’année suivante, ils sont tous deux devenus assistants du département, Sherwood auprès de McAdams à Cambridge et Hottel auprès de Ryan à la Practice School.
Le succès de la Practice School a été tel et la demande pour ses diplômés si importante que, bien que la Practice School ait jusqu’à présent été exclusivement une école de troisième cycle, conduisant au diplôme de maîtrise, il a été décidé d’ouvrir le cours aux étudiants de premier cycle. À partir de 1921, un cours de Practice School de premier cycle a été établi, désigné comme X-B. La Practice School, une innovation dans l’enseignement de l’ingénierie, perdure jusqu’à aujourd’hui et ses diplômés sont toujours très demandés par l’industrie. La Practice School est très différente des cours coopératifs proposés par de nombreuses universités, où les étudiants travaillent pour les entreprises concernées. Par la méthode de stage en génie chimique du M.I.T., les étudiants étudient et effectuent des tests sur l’équipement de l’usine de manière continue sous la direction d’un professeur et de ses assistants. Peu, voire aucune, autre institution n’a adopté cette méthode, peut-être en raison de son coût. La Practice School est dirigée ces dernières années par le professeur J. Edward Vivian.
La Research Laboratory of Applied Chemistry
Simultanément avec la réactivation de la Practice School, le Research Laboratory of Applied Chemistry, établi en 1908 par Walker, a été réactivé sous la direction de R. E. Wilson. Les contrats qu’il avait avec l’industrie ont rapidement augmenté, rendant nécessaire un personnel continuellement croissant. Tout au long de son existence au sein du département de génie chimique, ce laboratoire a dirigé un pourcentage de tout profit vers des travaux dits pro bono publico. (Dans la période 1925-1935, le contrat standard avec l’industrie était de 300 $ par homme par mois si la recherche était de nature publiable, 600 $ sinon ; le chiffre plus élevé permettait de soutenir un deuxième homme dans la recherche pro bono publico.) Lorsque Wilson partit en 1921 pour devenir directeur de la recherche à la Standard Oil Company of Indiana, Haslam devint directeur du Research Laboratory of Applied Chemistry en plus de sa responsabilité envers la Practice School. Un ou deux ans plus tard, Whitman devint directeur adjoint, mais il quitta ses fonctions en 1925 pour suivre Wilson dans les activités de recherche à la Standard Oil Company of Indiana. Haslam, lui aussi, partit vers 1926 pour devenir directeur de la Standard Oil Development Company. De nombreux membres du Research Laboratory of Applied Chemistry devaient plus tard devenir célèbres dans les cercles du génie chimique. Ils étaient avidement recherchés par l’industrie et d’autres universités en raison de leur formation inhabituelle.
Le succès du Research Laboratory of Applied Chemistry a incité le M.I.T. à étendre le concept pour couvrir une organisation à l’échelle de l’Institut, connue à l’origine sous le nom de Division of Industrial Cooperation, qui jouait le même rôle pour l’industrie en général que le Research Laboratory of Applied Chemistry pour l’industrie chimique. Walker, qui a fondé ce laboratoire, ne pouvait pas prévoir l’importance que le Research Laboratory for Applied Chemistry aurait dans la structure du M.I.T.
La Seconde Guerre mondiale
L’entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale a une fois de plus provoqué une perturbation dans le cursus X. Depuis la Première Guerre, l’armée avait adopté la pratique d’envoyer de nombreux officiers chimistes au M.I.T. pour des études supérieures en génie chimique. Au début de la guerre, les travaux de recherche en guerre chimique étaient centralisés à Edgewood Arsenal. Bradley Dewey, qui avait travaillé sous les ordres de Walker lors de la Première Guerre mondiale et qui avait été un ami proche du cours X au fil des ans, a convaincu le Département de la Défense que cela était dangereux pour la sécurité nationale et que l’effort de recherche d’Edgewood pouvait être renforcé en s’associant à une organisation comme le M.I.T. Il a suggéré que l’Institut construise un nouveau bâtiment pour le génie chimique – dont le département avait besoin – et que le Chemical Corps utilise ce bâtiment comme un deuxième laboratoire, à louer par le M.I.T. à l’Armée pour la durée de la guerre. À la fin de la guerre, le cursus X occuperait le bâtiment. Cela a été fait et un laboratoire hautement restreint employant plus de 150 employés – moitié militaires, moitié civils – a rapidement occupé le bâtiment terminé. Ainsi est né le bâtiment 12. Le colonel J. H. Rothschild, qui venait de terminer son travail pour un diplôme de maîtrise en génie chimique au M.I.T., a été nommé officier en charge. Weber a été désigné conseiller technique auprès du laboratoire à la demande de l’Armée. Il a immédiatement eu deux membres juniors du personnel du cours X, Roy Whitney et Scott Walker, désignés comme assistants techniques. Les trois ont servi à plein temps dans ces fonctions jusqu’à la fin de la guerre.
Pendant ce temps, le reste du personnel supérieur était employé dans des missions de guerre. Lewis était membre du Comité de recherche de la défense nationale (NDRC) et également membre du Comité consultatif principal pour le projet Manhattan. McAdams a mené des recherches liées à la guerre sur les radeaux de sauvetage et sur la génération de pression d’hydrogène. Sherwood a été l’un des premiers organisateurs des ressources en main-d’œuvre du génie chimique à l’échelle nationale, destinées à renforcer le NDRC. Il est ensuite devenu chef de section pour les problèmes divers du génie chimique, dans la Division 11. Hottel et Williams ont dirigé des recherches sur les chambres de combustion de turbines à gaz pour la Marine. De plus, Hottel est devenu chef de section pour la guerre du feu dans la Division 11 du NDRC, et membre du Comité des turbines à gaz de la NACA ; Williams a dirigé un projet de recherche sur les torpilles navales auquel Mickley et Satterfield ont participé en tant qu’assistants de recherche tout en travaillant sur leurs thèses de doctorat. Gilliland, en tant qu’assistant de Bradley Dewey au Rubber Reserve Board à Washington, avait la responsabilité principale de permettre aux États-Unis de produire suffisamment de caoutchouc synthétique. Il est devenu plus tard chef adjoint de la Division 11 du NDRC. Whitman était avec le War Production Board à Washington, responsable de la production de divers produits chimiques. Whitman a ensuite dirigé un comité chargé d’évaluer la situation de la propulsion à réaction, avec Sherwood et Hottel en tant que membres. L’année suivante, une évaluation plus complète de la propulsion à réaction a été réalisée sous la direction de Gilliland ; Williams a fait partie de ce groupe d’étude. En 1943-1944, Hottel est allé en Angleterre pour des travaux de liaison dans les domaines de la guerre du feu et de l’approvisionnement en oxygène, et au printemps 1945, Sherwood s’est rendu sur le continent pour rapporter des résultats techniques derrière les armées alliées en avance.
À la fin de la guerre, le cursus X a emménagé dans son nouveau bâtiment 12 et a bientôt repris son fonctionnement normal en tant que groupe éducatif.
Après la Seconde Guerre mondiale
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la bombe atomique avait été développée et il a rapidement été réalisé qu’il y aurait des utilisations pacifiques pour l’énergie nucléaire. Dans cette optique, le département a créé une division de génie nucléaire. Manson Benedict, un diplômé du cours V du M.I.T. travaillant alors chez Kellogg Company, a été nommé professeur de génie nucléaire en 1951. L’année suivante, Thomas Pigford, qui avait terminé son ScD dans le cours X, a rejoint Benedict et les premiers cours de génie nucléaire ont été proposés à l’automne 1952 dans le département de génie chimique. Plus tard, Benedict et Pigford ont été rejoints par Edward Mason, un autre étudiant du cours X, ScD 1950, et Theos J. Thompson (tous deux devenus plus tard commissaires de l’énergie atomique).
À la suggestion de Whitman, un réacteur nucléaire conçu par Thompson et destiné aux utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire a été construit sur le campus du M.I.T. Il s’agissait d’une entreprise unique et représentait le premier réacteur de recherche à grande échelle consacré exclusivement à des études pacifiques et exploité sur un campus universitaire. Cette installation a été utilisée en coopération avec des hôpitaux de Boston pour la recherche médicale et a également servi un but très utile dans la formation d’ingénieurs en génie nucléaire. Le personnel a acquis une réputation internationale et a été appelé à plusieurs reprises pour aider à résoudre des problèmes gouvernementaux. Le génie nucléaire a été séparé du cours X et est devenu un département indépendant de l’Institut en 1958.
La carrière de Whitman dans la période d’après-guerre a été très significative. Au M.I.T., il a dirigé la première étude, en 1948, sur l’utilisation de l’énergie nucléaire pour les avions. En congé du M.I.T., il a été membre du Comité consultatif général de la Commission de l’énergie atomique et, successivement, président du Research and Development Board des chefs d’état-major interarmées du Département de la Défense, organisé sous les auspices des Nations Unies de la Première Conférence internationale sur les utilisations pacifiques de l’énergie atomique, et conseiller scientifique auprès du Département d’État.
Bien que ce chapitre porte principalement sur les premiers jours du département, la proximité avec la première génération de ceux qui avaient rejoint le département d’ici 1950 justifie quelques brèves remarques sur les premiers travaux de ces derniers. Sherwood est devenu mondialement connu pour son travail pionnier et continu sur le transfert de masse. Le travail de Hottel et Williams sur la recherche de combustion à haut rendement a attiré une attention généralisée. La conviction de Mickley sur la nécessité de renforcer la science du génie chimique a eu un effet profond sur la politique éducative du département et de l’institut. Mickley est ensuite devenu responsable du Center for Advanced Engineering Study du M.I.T. Satterfield, après un intérêt précoce d’après-guerre pour le peroxyde d’hydrogène, s’est tourné vers la catalyse industrielle et, en particulier, l’effet du transfert de masse sur celle-ci. Meissner, dont le travail sur la thermodynamique et les équations d’état a été mentionné, s’est attaqué au problème d’apporter de l’ordre dans l’approche de la chimie industrielle. Vivian a mené des recherches significatives sur le transfert de masse avec réactions chimiques et a consacré un effort majeur à maintenir la qualité de la Practice School. Le travail de Merrill sur le débit sanguin et la dialyse en collaboration avec les hôpitaux de Boston a préfiguré la croissance énorme ultérieure du département dans le domaine du génie chimique appliqué aux problèmes médicaux.
Dans la fin des années 1950, McAdams et Whitman prirent leur retraite. Weber prit un congé pour devenir le conseiller scientifique en chef de l’armée. Une décennie plus tard, Hottel, Sherwood et Meissner prirent leur retraite, chacun avant ou peu de temps après la publication de livres dans leur domaine principal d’intérêt ; Hottel (avec Sarofim) sur le transfert radiatif, Meissner sur les processus et systèmes en chimie industrielle, et Sherwood (avec Pigford et Wilke) sur le transfert de masse. En l’espace d’environ deux ans, Gilliland, Whitman, Lewis, McAdams et Sherwood sont décédés.
Il est approprié de mentionner ici les noms des membres distingués du corps professoral de la « troisième génération ». À cette fin, le Tableau I indique les membres du corps professoral depuis la fondation du département jusqu’à aujourd’hui (mais en incluant seulement ceux dont le séjour a été d’une durée significative).
Quelques notes sur la scène récente
À la fin des années 1960, Gilliland démissionna de son poste de chef de département pour se concentrer davantage sur l’enseignement. Raymond Baddour était arrivé au département en provenance de Notre Dame et avait obtenu son doctorat en génie chimique du MIT en 1951. Ses recherches et publications sur l’échange d’ions, la catalyse hétérogène, la séparation chromatographique et les réactions à haute température ont apporté d’importantes contributions à la théorie et à la pratique dans ces domaines. En tant que chef de département, il a lancé plusieurs programmes interdépartementaux en technologie enzymatique, catalyse, échange d’ions et réactions à haute température, et a organisé le Laboratoire de l’environnement du MIT. Baddour avait le courage, la jeunesse et l’endurance pour se concentrer sur le développement des ressources industrielles et financières solides qui avaient commencé des années auparavant dans le département et pour les réunir dans le magnifique bâtiment Landau.
En 1976, après le déménagement du département dans le nouveau bâtiment Landau, Baddour abandonna ses responsabilités administratives. Kenneth A. Smith, ScD, MIT, ’62, a été nommé chef par intérim. Smith avait été étudiant de Mickley, avait passé une année postdoctorale à Cambridge, en Angleterre, sous la direction de G. I. Taylor et Alan Townsend au laboratoire Cavendish, et avait entamé une carrière de recherche et d’enseignement dans le domaine général des processus de transport. Ses près de 70 publications dans les domaines de la mécanique des fluides non newtoniens, du transfert de chaleur et de masse, de l’ingénierie biomédicale, de la désalinisation et de la caractérisation des polymères comprennent de nombreuses contributions exceptionnelles à la science du génie chimique. Pendant son court mandat de chef intérimaire du département, il a apporté des contributions efficaces à sa force d’enseignement et de recherche et s’est forgé une réputation d’examen équitable et réfléchi des problèmes du département, et d’actions décisives à leur égard.
En juillet 1977, le MIT a annoncé la nomination du Dr James Wei, ScD, ’55, au poste de professeur Warren K. Lewis de génie chimique et chef du département. Le Dr Wei avait mené des recherches industrielles distinguées sur la catalyse et le génie réactionnel à la Mobil Oil Corp., suivi de sa nomination comme professeur Allan P. Colburn à l’Université du Delaware. Il avait également obtenu des postes de professeur invité à Princeton et au California Institute of Technology. Pendant les six premiers mois de son mandat, le Dr Wei était en congé et le professeur Clark K. Colton a efficacement occupé le poste de chef adjoint. Sous la direction du Dr Wei, le département est confiant dans une croissance supplémentaire de sa réputation pour la formation efficace d’ingénieurs chimistes.
Le futur
Le progrès du département au cours des deux dernières décennies a été impressionnant. Il est vrai que le MIT ne se trouve pas seul dans le génie chimique comme il l’était dans les années 1920. Aujourd’hui, il a une forte concurrence de nombreuses universités, mais il a des avantages que d’autres n’ont pas. Il est pratiquement à l’abri des ingérences politiques ; il continue à avoir une administration entièrement en phase avec la recherche et le développement à long terme. Il dispose d’un noyau solide de professeurs jeunes et d’âge moyen bien formés dans la recherche de type industriel. Il bénéficie, comme toujours, du grand respect de l’industrie et d’un contact étroit avec celle-ci, à la fois par l’intermédiaire de son école pratique et de la pratique étendue de consultation de son corps professoral. Il offre des opportunités d’enseignement et de recherche dans de nombreux domaines d’excellence. Il possède une grande force dans les sujets fondamentaux du génie chimique : la mécanique des fluides, les processus de transport et la thermodynamique. Son laboratoire de carburants dispose d’un personnel exceptionnel, son travail en génie biomédical est bien connu, et son champ d’intérêt dans le domaine chimique industriel – catalyse, chimie de surface, génie des procédés et matériaux amorphes – est plus large que celui de nombreux centres de génie chimique.
Les restrictions environnementales associées à la diminution des réserves de ressources naturelles rendent maintenant nécessaire la refonte de la plupart de nos processus chimiques et énergétiques. Cela ouvre au chimiste ingénieur tout un nouveau spectre d’opportunités de recherche et de développement, et aucun groupe n’est mieux adapté pour résoudre ces problèmes que le chimiste ingénieur avec sa formation multidisciplinaire. Certainement, le cours X du MIT continuera le leadership brillant qu’il a toujours montré.
Literature C itea
- Personal communications.
Appendix. Books Published by M.I.T. Chemical Engineering Faculty
(During M.I. T. Service)
1922 Elements of Fractional Distillation, C. S. Robinson (McGraw-Hill)
1922 The Recovery of Volatile Solvents, C. S. Robinson (Chern. Cata-
logue Co., N.Y.) (French Translation, 1937)
1923 Principles of Chemical Engineering, W. H. Walker, W. K. Lewis
and W. H. McAdams (McGraw-Hill)
1923 Differential Equations in Applied Chemistry, F. L. Hitchcock and
C. S. Robinson (Wiley)
1926 Industrial Stoichiometry, W. K. Lewis and A. H. Radasch
(McGraw-Hill)
1926 Evaporation, C. S. Robinson (Chern. Cat. Co., N.Y.)
1927 Fuels and their Combustion, R. T. Haslam and R. P. Russell
(McGraw-Hill)
1927 Principles of Chemical Engineering, 2nd Ed., W. H. Walker, W. K.
Lewis and W. H. McAdams (McGraw-Hill)
1930 Elements of Fractional Distillation, 2nd Ed., C. S. Robinson
(McGraw-Hill)
1933 Heat Transmission, W. H. McAdams {McGraw-Hill)
1936 Differential Equations in Applied Chemistry, 2nd Ed., F. L.
Hitchcock and C. S. Robinson (Wiley)
1937 Absorption and Extraction, T. K. Sherwood (McGraw-Hill)
1937 Principles of Chemical Engineering, 3rd Ed., W. H. Walker, W. K.
Lewis, W. H. McAdams and E. R. Gilliland (McGraw-Hill)
1938 The Elements of Fractional Distillation, 3rd Ed., C. S. Robinson
and E. R. Gilliland (McGraw-Hill)
1939 Colloidal Phenomena, E. A. Hauser (McGraw-Hill)
1939 Thermodynamics for Chemical Engineers, H. C. Weber (Wiley)
1939 Applied Mathematics in Chemical Engineering, T. K. Sherwood
and C. E. Reed (McGraw-Hill)
1940 Experiments in Colloid Chemistry, 1st Ed., E.A. Hauser and J. E.
Lynn (McGraw-Hill)
1942 Heat Transmission, 2nd Ed., W. H. McAdams (assisted by G. C.
Williams) (McGraw-Hill)
1942 Industrial Chemistry of Colloidal and Amorphous Material, W. K.
Lewis, L. Squires and G. Broughton (Macmillan)
1942 The Recovery of Vapors, with special Reference to Volatile Sol-
vents (1st pub!. in 1922 as Recovery of Volatile Solvents), C. S.
Robinson (Reinhold)
1943 The Thermodynamics of Firearms, C. S. Robinson (McGraw-Hill)
1944 Explosives, their Anatomy and Destructiveness, C. S. Robinson
(McGraw-Hill).
1949 Thermodynamic Charts for Combustion Processes, H. D. Hottel,
G. C. Williams and C. N. Satterfield (Wiley)
1950 Elements of Fractional Distillation, 4th Ed., C. S. Robinson and
E. R. Gilliland (McGraw-Hill)
1952 Absorption and Extraction, 2nd Ed., T. K. Sherwook and R. L.
Pigford (McGraw-Hill)
1954 Industrial Stoichiometry, 2nd Ed., W. K. Lewis, A. H. Radash
and H. C. Lewis (McGraw-Hill)
1954
1955
1957
1958
1959
1961
« ‘1′ »
0
0
,..q
1963
0
0\
……-I
0 I
1963 0
00
0\
1964 ……-I
I
ro
……-I
(« ‘-.l
1966 0
……-I
0
……-I
…….
1967 0
‘ »d
bI) ;….,
1967 rfl
0
ro
1968 rfl
;:j
P-.
1970
q
0
0 1971 00
0\
……-I
«
……-I
1971 (j)
q
;:j …….
q
1972 0
‘ »d
(j)
,..q rfl
…….
……….
1972 .g
1973
1973
1973
1974 95
Heat Transmission, 3rd Ed., W. H. McAdams (McGraw-Hill) (also
translations into French, Russian, Yugoslavian, Japanese)
Hydrogen Peroxide, W. C. Schumb, C. N. Satterfield and R. L.
Wentworth (Reinhold) (Russian translation, 1957)
Applied Mathematics in Chemical Engineering, 2nd Ed., H. S.
Mickley, T. K. Sherwood, and C. E. Reed (McGraw-Hill)
The Properties of Gases and Liquids, R. C. Reid and T. K.
Sherwood (McGraw-Hill)
Thermodynamics for Chemical Engineers, 2nd Ed., H. C. Weber
and H. P. Meissner (Wiley) (also a Polish translation)
Thermal Regimes of Combustion, translated from Russian edition,
L. A. Vulis, Author; G. C. Williams, Editor (cGraw-Hill)
The Role of Diffusion in Catalysis, C. N. Satterfield and T. K.
Sherwoood (Addison-Wesley)
A Course in Process Design, T. K. Sherwood (M.I.T. Press)
Probability Theory, J. R. McCord and R. M. Moroney, Jr.
(Macmillan)
The Properties of Gases and Liquids, 2nd Ed., R. C. Reid and T.
K. Sherwood (McGraw-Hill)
The Application of Plasmas to Chemical Processing, Ed. by R. F.
Baddour and R. S. Timmins (M.I.T. Press)
Radiative Transfer, H. C. Hottel and A. F. Sarofi (McGraw-Hill)
Industrial Practice of Chemical Processes, S. W. Bodman (M.I.T.
Press)
Colloid and Surface Chemistry, Part 1; Surface Chemistry, S. T.
Mayr and R. G. Donnelly (M.I.T. Press)
Processes and Systems in Industrial Chemistry, H. P. Meissner
(Prentice-Hall)
New Energy Technology, Some Facts and Assessments, H. C.
Hottel and J. B. Howard (M.I.T. Press)
Staged Cascades in Chemical Processing, P.L.T. Brian (Prentice-
Hall)
Colloid and Surface Chemistry, Part 2; Lyophobic Colloids, A. Virj
and R. G. Donnelly (M.I.T. Press)
Process Synthesis, D. F. Rudd, G. J. Powers and J. J. Siirola
(Prentice- Hall)
Colloid and Surface Chemistry, Part 3; Electrokinecs, J. T. G.
Overbeek and R. G. Donnelly (M.I.T. Press)
Model Crystal Growth Rates from Solution, M. Ohara and R. C.
Reid (Prentice-Hall)
Thermodynamics and its Application, M. Modell and R. C. Reid
(Prentice- Hall)
1974 Colloid and Surface Chemistry, Part 4; Lyophilic Colloids, J. T. G.
Overbeek and R. G. Donnelly (M.I.’T. Press)
1975 Mass Transfer (Major revision of Absorption and Extraction), T. K.
Sherwood, R. L. Pigford and C. R. Wilke (McGraw-Hill)
1976 Properties of Gases and Liquids, 3rd Ed., R. C. Reid, J. Prausnitz
and T. K. Sherwood (McGraw-Hill)
1977 Dynamics of Polymeric Liquids, Vol. 1, Fluid Mechanics, R. B.
Bird, R. C. Armstrong and o. Hassager (Wiley)
1977 Dynamics of Polymeric Liquids, Vol. 2, Kinetic Theory, R. B.
Bird, O. Hassager, R. C. Armstrong, and C. F. Curtiss (Wiley)
« ‘1′ »
o
o
,..q
6 RECEIVED May 7, 1979
George E. Davis, Norman Swindin, et la tradition empirique en génie chimique D. C. FRESHWATER If)
Département de génie chimique, Université de Loughborough, Loughborough, Leicestershire, Royaume-Uni
George E. Davis a inventé le concept essentiel d’opération unitaire et a écrit le premier manuel de génie chimique en
- Norman Swindin était son seul élève et a apporté de nombreuses idées nouvelles à la pratique. Tous deux étaient empiristes plutôt que théoriciens et croyaient absolument en la nécessité de développer des installations et des processus par l’expérience et l’expérimentation. Davis a tenté de fonder la première société de génie chimique, mais il est décédé avant que ses idées ne se concrétisent. Swindin a largement réécrit la deuxième édition du livre de Davis en 1904 et a ensuite écrit des textes pionniers tels que l’Écoulement des produits chimiques liquides dans les tuyaux en 1922. Au cours d’une longue et vie réussie, Swindin s’est montré proche de l’idéal de Davis du « génie chimique ».
- Le génie chimique est devenu la quatrième grande technologie grâce à « »g les efforts de nombreux travailleurs qui sont à la fois des ingénieurs pratiquants et ,..q . enseignants. Il est considéré, peut-être un peu arrogamment par ses praticiens, comme :g étant plus basé sur la science et orienté que ses professions sœurs de génie civil, mécanique et électrique. En effet, ces dernières années, il y a eu une vogue pour la prétendue science de l’ingénierie, une vogue dans laquelle certains éminents ingénieurs chimistes peuvent être considérés comme ayant été des leaders de la mode. Cependant, il y a toujours eu un fort courant d’empirisme dans la technologie des procédés tout au long de son histoire, d’Agricola à nos jours. Il y a ceux qui tentent de minimiser voire de nier le rôle de l’empirisme et qui soutiendraient que le génie chimique est fondamen- talement différent (et d’une certaine manière supérieur) à la technologie des procédés. Mais c’est ignorer les faits et élargir encore davantage le fossé malheureux qui existe entre les théoriciens (principalement des universitaires) et les praticiens (principalement des ingénieurs en industrie). Peut-être que cette dichotomie préjudiciable peut être partiellement inversée en observant que l’homme qui a fondé le sujet en tant qu’étude ordonnée était un empiriste clair. George E. Davis (représenté dans la figure 1) est né à Eton en 1850 et a étudié la chimie d’abord à l’Institut de mécanique de Slough, puis à la École royale des mines (aujourd’hui partie du Imperial College). Ses études formelles se sont terminées en 1870 lorsqu’il a rejoint les usines de blanchiment Bealey à Man- chester en tant que chimiste des usines. Il a beaucoup bougé au cours des 10 prochaines années, acquérant de l’expérience dans l’industrie chimique, principalement dans le Nord-Ouest de l’Angleterre. Puis, en 1880, il est devenu consultant avec un bureau à Man- chester. Un peu plus d’un an plus tard, il a été invité par le Dr Angus Smith à rejoindre l’inspection des alcalis créée pour administrer la nouvelle loi sur les alcalis. C’était la première législation visant à contrôler la pollution environnementale. Le Dr Smith est décédé en 1883, moment où Davis a démissionné et est retourné à sa pratique privée, immensément enrichi par son expérience et ses connaissances acquises dans son travail en tant qu’inspecteur des alcalis. Ensuite, à l’exception d’une courte pause en tant que directeur de l’usine de gaz de Barnsley, il a continué à pratiquer en tant que consultant en construisant un très important jusqu’à son décès prématuré en 1906. Tout au long de sa vie professionnelle, Davis a manifesté deux caractéristiques remarquables dans le contexte actuel. La première était une persistance infatigable à collecter des faits qu’il considérait comme pertinents pour son passé, son présent, ou ses futures activités professionnelles. Le moindre détail était noté avec assiduité en vue d’une référence future possible. La deuxième était une passion pour l’ordre et la classification de ces informations. Son expérience, bien plus large que celle des chimistes (industriels ou autres) à cette époque, associée aux deux caractéristiques que nous venons de décrire, a sans aucun doute contribué à la création de son concept profond de l’opération unitaire. C’est cette idée qui a codifié une immense quantité de connaissances précédemment non systématisées et a posé les bases du génie chimique en tant que sujet majeur à part entière. En observant comment Davis collectait ses faits pendant de nombreuses années et les ordonnait d’une manière nouvelle et extrêmement significative, on pense à la similitude entre cela et le processus par lequel Darwin est parvenu à sa théorie de l’évolution. La collecte minutieuse de données était une condition nécessaire mais insuffisante au prélude de l’ordonnancement des faits d’une nouvelle manière, une manière qui montrait un principe unificateur qui devait avoir un effet profond sur le développement de la technologie. Avant Davis et même longtemps après lui dans certains pays, les technologues des procédés sont devenus des spécialistes de produits chimiques particuliers ou de groupes de produits chimiques. Une entreprise n’envisagerait pas d’employer un homme spécialisé dans la fabrication d’alcalis pour la conception ou la gestion, par exemple, d’une usine d’acide nitrique. Nous pouvons encore voir les vestiges de cette spécialisation orientée vers l’industrie dans les instituts d’Europe de l’Est plus anciens, la plupart d’entre eux étant modélisés sur le modèle allemand qui lui-même a tellement changé ces cinq dernières années. Nous ne savons pas exactement quand Davis a eu l’éclair d’inspiration qui l’a amené à codifier ses informations factuelles et son expérience, non en termes de procédé ou de fabrication, mais sous les larges rubriques de ce qui allait devenir les opérations unitaires. Il semble certain que c’était avant 1888, année où il a donné une série de conférences à l’école technique de Manchester qui allait servir de base à son manuel célèbre. (1) Il semble étrange que l’on sache si peu de choses sur une découverte aussi importante. Cela est sans doute dû au fait que Davis ne semblait pas chercher à être reconnu pour l’originalité et l’importance de sa découverte, en partie à cause de son décès prématuré. L’importance relative des industries de transformation en général et de l’industrie chimique en particulier en Grande-Bretagne à son époque a également joué un rôle dans cette négligence. Davis semblait être un homme modeste en public tout en étant arrogant en privé. Il était certainement convaincu de l’importance du génie chimique en tant que concept et était doué pour persuader d’autres personnes de l’importance de diffuser la connaissance du sujet. Mais comme beaucoup de tels persuaders, il était prêt à renoncer à faire pression pour ses propres idées ou à prendre un crédit particulier pour elles afin de poursuivre ce qu’il voyait comme le plus grand bien de la diffusion de la connaissance. Cela se voit clairement dans le rôle qu’il a joué dans la formation de la Society of Chemical Industry. Le Faraday Club formé par Davis pour les chimistes industriels dans et autour de St. Helens en 1875, a finalement conduit à la Society of Chemical Industry dont Davis a été le premier secrétaire (2). Il a failli devenir, lorsqu’il a été formé en 1880, la Society of Chemical Engineering. Cependant, ce titre s’est révélé trop difficile à avaler pour tous les membres fondateurs et c’est Davis lui-même qui a proposé le nom actuel qui a été accepté généralement. Mais Davis, tout en ne revendiquant pas ses propres points de vue lorsqu’il concevait un bien plus grand, était néanmoins un actif et continu publiciste de ces points de vue. Ainsi, avec son frère, il a fondé en 1887 le Chemical Trade Journal, où il se présentait comme éditeur, ingénieur chimiste et chimiste consultant. Dans l’éditorial du premier numéro, il écrivait, « Le génie chimique, une science si négligée en Angleterre par le passé, aura sa juste part d’attention. » C’était en la même année où il a donné son célèbre cours de conférences à Man- chester Technical School. Ce qui a rendu ces conférences significatives et la cause d’un intérêt considérable, c’est le fait que le contenu était présenté d’une manière nouvelle que Davis avait conçue. Tous les pro- cessus de la technologie chimique contemporaine ont été analysés en termes d’une série d’opérations de base. Il ne semble pas que Davis lui-même ait utilisé le terme « opérations unitaires » et il n’explicite pas explicitement son ordonnancement conscient de l’information de la manière dont elle apparaît. Cependant, personne ne peut voir la structure de ces conférences telle que réimprimée ultérieurement dans le Chemical Trade Journal sans apprécier que Davis a effectivement inventé le concept d’opération unitaire et a fourni une base unifiante pour une éducation systématique en technologie des procédés. Les limitations d’espace ont empêché une présentation appropriée des conférences dans le Chemical Trade Journal, comme le comprendra toute personne qui a vu son Handbook of Chemical Engineering. Pas doute à cause de la pression du travail, ce n’est qu’en 1901 que cela est apparu. C’était un travail massif, vraiment encyclopédique par nature ainsi que par sa taille, s’étendant sur environ 900 pages (3). Il a été suivi en 1904 par une deuxième édition, élargie, en deux volumes totalisant plus de 1000 pages. La liste des contenus indiquée dans le tableau I donne une idée de l’immense couverture. Les nombreuses illustrations d’installations dans le Handbook sont souvent une trace de l’appareillage qui appartient maintenant à l’histoire, mais parfois l’équipement qu’il décrit semble relativement moderne (voir les figures 2 et 3).
Le chapitre d’introduction expose clairement la philosophie de Davis. Pour citer : « Le génie chimique ne doit pas être confondu avec la chimie appliquée ou avec la technologie chimique. Le génie chimique englobe toute la gamme de la chimie manufacturière, tandis que la chimie appliquée touche simplement à la périphérie et ne traite pas des difficultés d’ingénierie, même de manière minime, alors que la technologie chimique résulte de la fusion des études de chimie appliquée et de génie chimique et devient spécialisée dans l’histoire et les détails de certains produits manufacturés. » Davis explique ensuite qu’un livre sur la technologie chimique décrirait nécessairement en détail la chimie et la construction d’une installation pour chaque industrie. Un tel ouvrage ne serait pas seulement excessivement volumineux, mais dépasserait les compétences d’un homme seul. D’un autre côté, le génie chimique traite de la construction d’installations nécessaires à l’utilisation des réactions chimiques à grande échelle sans spécifier de quelle industrie une telle installation doit être utilisée. Davis a ici clairement compris l’idée de généralisation, de l’approche qui marque l’émergence du génie chimique en tant que discipline nouvelle et significative. Il développe cette idée dans son introduction : « Les solides, les liquides et les gaz doivent être déplacés et mesurés, ils doivent être mélangés et traités avec de la chaleur ou du froid souvent sous pression, et le processus de lixiviation, d’extraction, d’évaporation et de distillation exerce souvent au maximum les talents de l’ingénieur chimique. » Il y a à peine une déclaration plus claire de l’approche par opérations unitaires. Quelques phrases plus loin, il préconise l’utilisation d’opérations à l’échelle pilote pour le développement d’un nouveau processus. Après avoir vanté les avantages de l’expérimentation à l’échelle du kilogramme (avec plusieurs exemples), Davis poursuit : « Pourtant, il existe une manière de procéder à son travail en génie chimique, plus certaine et moins coûteuse que le processus vénérable d’essais et d’erreurs, et il est à espérer que ceux qui entreprennent de devenir ingénieurs chimistes découvriront le fait que la science et la pratique travailleront ensemble dans toutes les occasions où les conditions auront été correctement étudiées. » Il ne fait guère de doute, en examinant le manuel, que George E. Davis a apporté une contribution majeure à l’établissement du génie chimique. Cependant, il est important de reconnaître qu’il était avant tout un empiriste. Le manuel, malgré sa taille, est un volume extrêmement pratique, se référant toujours non seulement à l’expérience technique connue, mais aussi aux coûts. La théorie n’intervient presque pas, et pour discuter des principes théoriques, l’étudiant est souvent renvoyé à un manuel élémentaire. À maintes reprises, Davis souligne la nécessité d’allier la théorie à des informations pratiques et économiques pour développer des installations de traitement réussies. De plus, le concept même d’opération unitaire est empirique, étant une classification pratique et révélatrice de la matière plutôt que d’avoir une base en physique ou en chimie. Bien qu’il ait été dans une certaine mesure supplanté ces dernières années par des concepts tels que les phénomènes de transport, il reste néanmoins le moyen le plus courant d’introduire l’étudiant au génie chimique et le modèle de base pour une grande partie de notre enseignement. La deuxième édition (1904) du manuel de Davis était non seulement illustrée, mais aussi largement étendue par Norman Swindin, à qui nous sommes redevables pour la plupart de nos informations sur Davis, en dehors des faits bruts de sa vie (3). Davis déclarait dans la préface de son livre : « Si les références d’un étudiant comprenaient le fait qu’il connaissait par cœur l’intégralité du manuel de génie chimique et qu’il avait la capacité de l’appliquer, il n’aurait pas beaucoup de difficulté à trouver un poste. » Si c’était l’ingénieur chimiste idéal de Davis, Norman Swindin devait s’en approcher. Norman Swindin (représenté dans la figure 4) est né en 1880 et, après la mort prématurée de son père, il a commencé à travailler comme commis à l’âge de 14 ans. Il s’est intéressé à l’ingénierie et aux moteurs dans les ateliers où il était employé et, grâce à ses propres efforts à l’école du soir et à des cours particuliers, il a acquis une bonne formation en génie mécanique et en chimie. En 1901, il entra au service de Davis et se considéra dès lors comme ingénieur chimiste. Il était peut-être le seul homme à avoir été formé dans sa profession par le maître et, en six ans avec George Davis, il acquit plus d’expérience que ne le font la plupart des jeunes hommes en deux fois cette période aujourd’hui. Et cela ne se limitait pas simplement à l’expérience technique. Pendant la maladie prolongée de George Davis, Swindin prit la relève en tant qu’éditeur du Chemical Trade Journal. La pratique qu’il acquit ainsi dans l’écriture devait être mise à profit dans les années suivantes. À la mort de George Davis, Swindin quitta l’entreprise et entama une période de travail en tant qu’ingénieur chimiste dans plusieurs entreprises plutôt étranges. Il y avait d’abord Ashcroft avec son obsession pour la chimie non oxygène, non eau ; puis il y avait Elmore, dont le processus exigeait la manipulation de solutions salines concentrées contenant 10 % de HCl. C’est là que l’expérience de Swindin avec Davis, alliée à sa propre capacité naturelle, a vraiment commencé à porter ses fruits. Ses premiers travaux sur la corrosion étaient approfondis, en grande partie en raison de l’importance que Davis accordait aux matériaux de construction. Swindin comprit que le processus Elmore représentait l’un des tests les plus sévères des matériaux qui puissent être. Non seulement il y avait un problème de manipulation, ces liqueurs hautement corrosives devaient être évaporées et les cristaux et la liqueur mère transportés. Swindin résolut ces problèmes par une combinaison d’expérience, de perspicacité et d’inventivité. Bien qu’il n’ait pas été l’inventeur du revêtement en caoutchouc, de la combustion immergée ou du « airlift », il a été le premier à les faire fonctionner à l’échelle industrielle et dans des situations où aucune autre solution n’était envisageable (4).
Les carnets de Swindin de cette période sont disponibles et sont méticuleusement organisés. Ils contiennent des rapports, généralement écrits à la main, sur son travail quotidien (5). En lisant ces carnets, on ne peut s’empêcher d’être frappé par l’ingéniosité de l’homme ainsi que par son appétit immense pour le travail. Les entrées vont d’une description concise de ce qui pourrait être l’expérience de levage de gaz la plus ésotérique (reproduite dans la Figure 5) à des comptes rendus détaillés d’expériences minutieuses sur le revêtement en caoutchouc de divers récipients. Swindin ne connaissait pas le coefficient de dilatation du caoutchouc ni même s’il était positif ou négatif. Une expérience qu’il a rapportée pour tester cela était typique. Il a rempli un petit ballon en caoutchouc mou d’eau froide, l’a percé avec une aiguille et a observé la hauteur à laquelle la fontaine s’élevait. Il l’a ensuite rempli avec une quantité égale d’eau chaude et a observé que la fontaine était plus haute. Il a conclu que « le caoutchouc se contracte lorsqu’il est chaud—la quantité exacte doit être déterminée afin de prendre dûment en compte cela. » Cependant, c’est son travail précoce sur la combustion immergée dans ces carnets qui nous donne l’une des images les plus intéressantes de la manière dont il a développé l’idée.
La première expérience, réalisée le 4 mai 1902, utilisait un manteau de gaz domestique ordinaire entouré d’un gobelet en verre, lui-même plongé à la plupart de sa profondeur dans une casserole contenant de l’eau (voir la Figure 6). D’autres expériences ont rapidement suivi les 16 et 22 mai—la première avec une mise à l’échelle et la seconde en se passant du manteau. Cela a ensuite conduit à une véritable combustion immergée (voir la Figure 7). Cette étape a pris un peu plus d’un an en raison d’autres pressions. Finalement, confronté à un employeur incrédule, Swindin a plongé une torche à gaz allumée dans un grand gobelet d’eau et l’y a maintenue jusqu’à ce que le liquide bout. (Le premier modèle de travail correct est enregistré dans son carnet pour juin 1923.)
Alors que la résolution de problèmes techniques nouveaux et inhabituels pourrait être considérée comme la marque d’un ingénieur chimiste, Swindin n’était pas un homme ordinaire. Depuis 1916, il avait, de manière intermittente, suivi des cours du soir en génie chimique dispensés au Battersea Polytechnic par Hugh Griffiths. Griffiths a invité Swindin à combiner ses connaissances pratiques avec la théorie qu’on lui avait enseignée et à rédiger un livre sur le pompage dans le cadre d’une série dont Griffiths était l’éditeur. En 1922, « The Flow of Liquid Chemicals in Pipes » (réédité un an plus tard sous le titre « The Modern Theory and Practice of Pumping ») a été publié (6). Swindin avait depuis longtemps été impressionné par la réputation d’Osborne Reynolds, d’autant plus qu’il avait réellement entendu le grand homme donner une conférence. Cependant, comme il le dit, il n’a vraiment pas compris les implications du travail de Reynolds sur l’écoulement des fluides jusqu’à ce que Griffiths le lui explique dans ses conférences à Battersea. Une fois qu’il a réalisé la puissance du critère d’écoulement, en particulier pour caractériser les divers fluides avec lesquels il devait traiter, il a été rapide à l’exploiter. Son livre pourrait bien être la première application pratique publiée du critère du nombre de Reynolds aux problèmes de traitement. Certainement, aucune mention du nombre de Reynolds ou de son application à l’écoulement des fluides n’apparaît dans le manuel de Liddell, publié la même année (7).
Le fait que le procédé Elmore n’ait jamais fonctionné commercialement était dû à une gestion inepte et à des lacunes financières plutôt qu’à Swindin, qui a résolu essentiellement tous les problèmes techniques. Ce faisant, il a acquis le savoir-faire pour créer une entreprise concevant et fabriquant des équipements pour des procédés utilisant des matériaux hautement corrosifs. Une grande partie de son temps dans les années suivantes a été consacrée aux détails de la création d’une nouvelle entreprise et à sa mise sur pied.
C’est un hommage à sa persévérance qu’à l’âge de 43 ans, il ait commencé une entreprise et l’ait développée avec succès pendant la pire période de dépression que le Royaume-Uni ait connue. La société qu’il a fondée a finalement prospéré et est devenue mondialement connue pour son expertise dans le traitement de matériaux corrosifs. Elle reposait solidement sur les trois contributions matérielles de Swindin au génie chimique : le revêtement en caoutchouc, la combustion immergée et la pompe à gaz. Les trois sont illustrés dans l’appareil montré dans la Figure 8. Mais Swindin a apporté bien plus au développement du génie chimique que ces trois techniques. Il a été membre fondateur de l’Institution of Chemical Engineers et a joué pendant de nombreuses années un rôle important dans sa croissance. Il était un propagandiste infatigable pour la profession à travers son écriture et son travail tout au long de sa vie.
Tout comme son maître avant lui, Swindin était avant tout un expérimentateur, prêt à être guidé dans la bonne direction par la théorie mais reconnaissant toujours la nécessité essentielle de découvrir par l’expérience les conditions opérationnelles. Le pouvoir prédictif de la théorie peut séduire les ingénieurs professionnels à négliger, voire à abhorrer, l’approche empirique. Cependant, le faire revient à ignorer la véritable différence entre l’ingénierie, qui concerne la solution de problèmes concrets, et la science, qui concerne la résolution d’abstractions de problèmes. Davis et Swindin ont clairement vu cette différence et ont ainsi pu chacun apporter une contribution singulière au développement de la profession.
Il ne serait pas approprié de conclure sans mentionner quelque chose de Norman Swindin en tant qu’homme. Je n’ai connu Davis qu’indirectement, à travers son livre et par le biais de Swindin, mais j’ai eu la chance de connaître Swindin lui-même et de devenir son ami au cours des 20 dernières années de sa vie, de 76 à 96 ans. Jusqu’à sa mort, il avait une mémoire vive et détaillée et était un conteur né qui parlait des grands hommes du début des années 1900 comme s’ils venaient de quitter la pièce pour un moment.
Ses souvenirs s’étendaient bien au-delà des horizons professionnels et englobaient son amour de toute une vie pour la musique, l’art et la littérature. Peut-être une partie du secret de sa longévité était qu’il était perpétuellement jeune dans son esprit. L’étincelle dans son œil démentait son âge, et il n’était jamais aussi heureux que lorsqu’il venait à Loughborough chaque année pour donner sa conférence annuelle aux étudiants, un événement toujours très attendu et toujours bondé. Il était vraiment un ingénieur extraordinaire. L’avoir connu donne l’impression d’avoir un lien réel avec le passé remontant au fondateur de notre profession.
Literature C itea
- Davis, George E. « A Handbook of Chemical Engineering »; Davis Bros.:
Manchester, 1901. - Hardie, D.W.F. ‘7he Empirical Tradition in Chemical Technology, » The nrst
Davis-Swindin Memorial Lecture, Loughborough University, 1962. - Swindin, N. Trans lnst. Chern. Eng. 1953, 31, 187.
- Swindin, N. « Engineering Without Wheels »; Wiedenfeld & Nicholson:
- London, 1964.
- Swindin, N. Laboratory Notebooks 1922 and 1923, Loughborough University
Library, Leicestershire, U. K. - Swindin, N. ‘the Pumping of Chemical Liquids in Pipes »; Benn Bros.:
London, 1922. - « Handbook of Chemical Engineering »; Liddell, D.M., Ed.; McGraw-Hill:
New York, 1922.
RECEIVED May 7, 1979.
Les pionniers du génie chimique au M.I.T. GLENN C. WILLIAMS et J. EDWARD VIVIAN Dans les près de neuf décennies depuis que le premier diplôme de bachelier en génie chimique a été décerné à William P. Bryant en 1891, le M.I.T. a attribué plus de 4000 diplômes de bachelier et un nombre presque équivalent de diplômes avancés à des étudiants en génie chimique. Pendant plus de quatre de ces décennies, il a été le privilège des auteurs d’avoir été successivement étudiants et enseignants au M.I.T. et d’avoir été collègues de tous sauf des trois premiers pionniers dont les biographies suivent. Il y avait, bien sûr, de nombreux autres membres du corps professoral qui ont apporté des contributions, grandes et petites, au développement du génie chimique à l’institut, mais nous avons choisi, sauf pour les trois premiers, de présenter brièvement les carrières de ceux qui étaient membres à temps plein avant 1934 et qui ont terminé leur carrière au M.I.T. pendant notre mandat. …….
Lewis Mills Norton, 1852-1893 Le professeur Norton est né à Athol, MA, fils d’un pasteur protestant. Il a étudié la chimie au M.I.T. en tant qu’étudiant spécial pendant trois ans, y a travaillé comme assistant pendant deux ans, et a obtenu son doctorat en chimie à l’Université de Göttingen en 1879. Il a ensuite passé deux ans en tant que chimiste pour la Amoskeag Manufacturing Company à Manchester, NH, avant de retourner au M.I.T. en 1881 en tant que membre du corps enseignant en chimie organique et industrielle. Ses recherches étaient principalement orientées vers des applications pratiques, et en 1888, le corps professoral a approuvé sa proposition d’initier le premier cours de génie chimique aux États-Unis. Ce programme combinait un programme assez complet en génie mécanique avec une solide base en chimie générale, théorique et appliquée. Il a heureusement vu le nouveau programme établi sur des bases solides avant sa mort prématurée à l’âge de 38 ans.
Prank Hall Thorp, 1864-1932 Originaire de Bloomington, IL, le docteur Thorp a obtenu son diplôme en chimie au M.I.T. en 1889. Après avoir travaillé comme assistant en chimie au M.I.T., il a étudié la chimie à l’Université de Heidelberg, où il a obtenu son doctorat en 1893. Il est ensuite retourné au M.I.T., remplaçant le professeur Norton récemment décédé en tant qu’instructeur en chimie industrielle, et a occupé ce poste pendant 22 ans. En 1898, le manuel du Dr Thorp, « Outlines of Industrial Chemistry », a été la première publication américaine de son domaine et a été largement utilisé pendant plus de 15 ans. Le Dr Thorp, s’appuyant sur les fondements posés par le professeur Norton, a été le premier à développer un cours rigoureux d’enseignement en chimie industrielle dans les écoles techniques américaines. Le Dr Thorp a enseigné jusqu’à sa retraite pour raisons de santé en 1916 et a été président de la section nord-est de la Société américaine de chimie.
William Hurtz Walker, 1869-1934 Le professeur Walker, un fermier originaire des collines près de Pittsburgh, a obtenu son diplôme de bachelier de l’Université d’État de Pennsylvanie en 1890 et son doctorat sous la direction d’Otto Wallach à Göttingen en 1892. Après deux ans en tant qu’instructeur au Penn State College, il est venu au M.I.T. en tant qu’instructeur en chimie analytique. En 1900, il démissionne pour rejoindre Arthur D. Little chez Little and Walker, consultants en chimie. Deux ans plus tard, il est rappelé par le président Pritchett du M.I.T. pour initier un changement radical dans l’enseignement pratique en génie chimique. En 1905, il décrit son ingénieur chimiste idéal comme « tout d’abord, un chimiste parfaitement formé, capable d’appliquer les connaissances des forces chimiques pour exploiter des installations industrielles basées sur des réactions chimiques ». Cette année-là, il est également nommé chargé de cours en chimie industrielle à l’Université Harvard, libre de développer un cours qui, plus tard (en 1923), a été à la base de « Principles of Chemical Engineering ».
En 1907, le Dr Walker a complètement révisé le programme d’études en génie chimique, passant d’un programme largement axé sur le génie mécanique à un programme qui mettait l’accent sur la formation chimique et incorporait les fondements de l’ingénierie. Reconnaissant la nécessité d’une relation plus étroite entre le milieu universitaire et l’industrie, ainsi que la nécessité de former des personnes pour la recherche industrielle, il fonde le « Research Laboratory of Applied Chemistry » en 1908. Cette dernière organisation a évolué pour devenir la « Division of Industrial Cooperation » du M.I.T., qui a contribué de manière notable à la recherche gouvernementale pendant la Seconde Guerre mondiale.
En 1916, Arthur D. Little a proposé une nouvelle méthode de formation qui impliquait du travail et des études dans des usines industrielles sous la supervision et l’instruction constantes du personnel de l’institut, après que les étudiants eurent terminé leur formation fondamentale. George Eastman a été convaincu des mérites de ce programme et a contribué généreusement à son soutien. Des stations d’écoles pratiques ont été créées dans des entreprises largement représentatives de l’industrie chimique, et le succès de cette méthode unique de formation est attesté par le fait que le programme, désormais au niveau des études supérieures, a continué jusqu’à aujourd’hui, n’étant interrompu que par les deux guerres mondiales.
Avec l’avènement de la Première Guerre mondiale, Walker a été appelé pour former la section des services chimiques de l’armée, construisant l’Arsenal d’Edgewood à partir de zéro. Il a reçu la médaille du service distingué pour ses efforts. De retour à l’Institut, il a dirigé la Division de la coopération industrielle jusqu’à sa démission en 1921 pour retourner à la consultation privée. Il est décédé dans un accident de voiture en 1934.
Warren Kendall Lewis, 1882-197′ « Pour avoir établi le concept moderne du génie chimique, formé des générations de leaders en ingénierie et en service, et abordé des problèmes industriels pionniers qui ont contribué de manière incommensurable au progrès de l’humanité » – ainsi, la citation en 1966 lors de la remise de la médaille John Fritz à cet homme originaire d’une ferme ancestrale à Laurel, DE, qui est venu à Newton, MA, pour compléter ses trois années de lycée local en préparation pour le M.I.T. Après avoir obtenu son baccalauréat en génie chimique en 1905, il a aidé le Dr Walker, qui lançait le Laboratoire de recherche en chimie appliquée, puis est allé à l’Université de Breslau pour son doctorat en chimie en 1908. Il est ensuite retourné au M.I.T. en tant que chercheur associé, a pris une année sabbatique pour travailler dans une tannerie au New Hampshire, puis est revenu en tant que membre du corps professoral. Pendant la Première Guerre mondiale, il a travaillé avec le Bureau des mines et le Service de guerre chimique sur la défense contre les gaz. Après la guerre, il a travaillé avec le Dr Walker et le Professeur McAdams sur les principes du génie chimique, qui ont été utilisés sous forme de polycopiés au M.I.T. avant leur publication en 1923. À la création du département de génie chimique en 1920, il en a été le premier responsable jusqu’en 1929, date à laquelle il est retourné à l’enseignement et à la recherche. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, le Dr Lewis et le Dr Gilliland ont inventé la méthode de craquage en lit fluidisé pour le pétrole, ce qui a rendu possible la production énorme d’essence d’aviation si vitale pendant ce conflit. Le Dr Lewis était vice-président de la division de chimie du National Defense Research Committee, a travaillé aux bureaux de recherche scientifique et de production et sur des problèmes de génie chimique dans le développement de la bombe atomique. Associant ses larges intérêts, ici partiellement illustrés, à son amour de l’enseignement et à sa méthode unique de confrontation, « Doc » était un professeur fantastique, redouté par certains jusqu’à ce qu’ils découvrent son cœur tendre, et rappelé avec affection par tous. De jeunes instructeurs téméraires ont tenté en vain d’imiter son style. En plus d’une centaine d’articles couvrant des domaines très divers du génie chimique, il a coécrit Stoichiométrie Industrielle en 1926 et Chimie Industrielle des Matériaux Colloïdaux et Amorphes en 1942. Le Dr Lewis a pris sa retraite en 1948, mais est resté régulièrement dans son bureau jusqu’à ses quatre-vingt-cinq ans. Il est décédé à l’âge de 92 ans en 1975.
Clark ShD’IJe Robinson, 1888-1947 Professeur Robinson, originaire du Massachusetts, a obtenu son diplôme en génie chimique du M.I.T. en 1909 et, après cinq ans dans l’industrie, est revenu pour obtenir une maîtrise, rejoignant le personnel en tant qu’instructeur en chimie industrielle en 1915. Son ouvrage Elements of Fractional Distillation, publié en 1922, l’un des premiers textes américains dans ce domaine, a été révisé jusqu’en 1950 par le Professeur Gilliland. Un autre texte de 1922 était The Recovery of Volatile Solvents. En 1923, il a collaboré avec le Professeur Lauren Hitchcock du département de mathématiques pour produire Differential Equations in Applied Chemistry. Cela a été suivi en 1926 par Evaporation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, tout en servant en tant que colonel d’artillerie et en étant en grande partie responsable du remarquable bilan de sécurité de la production de munitions, il a publié Thermodynamics of Firearms, Explosives Chemistry for Safety Engineers et Explosives-Their Anatomy and Destructiveness. La joie du Professeur Robinson était d’enseigner aux étudiants de premier cycle en génie chimique, et il est bien rappelé par ses étudiants pour ses anecdotes historiques parfois osées concernant certains pionniers célèbres en chimie et thermodynamique, ainsi que pour son insistance sur la précision numérique dans les problèmes à domicile et les quiz. Il était un grimpeur passionné de montagne et un chanteur soliste et choral accompli.
William Hen » McAdams, 1892-197′ Originaire du Kentucky, le Professeur McAdams a étudié au Transylvania College, puis à l’Université du Kentucky, où il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en chimie en 1913 et 1914, et en 1917 une maîtrise en génie chimique au M.I.T. Après un an chez Goodyear Tire and Rubber Company, il a servi dans le Chemical Warfare Service en tant que capitaine, chef adjoint de la division du développement. Il est revenu à la faculté du M.I.T. en 1919 où il a développé et enseigné des sujets de troisième cycle en transfert de chaleur, absorption, distillation et équilibre économique. De 1925 à 1953, il a été chargé de cours en génie chimique à l’Université Harvard. Avec W. H. Walker et W. K. Lewis, il a développé les Principes du génie chimique, et en 1933, il a produit sa célèbre Heat Transmission, qui, dans sa troisième édition, a été traduite en français, russe, yougoslave et japonais, et reste une référence précieuse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le Professeur McAdams a été actif dans des projets de recherche pour le National Advisory Committee for Aeronautics, le National Defense Research Committee et l’Office of Naval Research, pour lesquels il a reçu le Certificat de mérite présidentiel en 1957, la première Conférence nationale sur le transfert de chaleur lui a été dédiée pour « services distingués à la profession d’ingénieur, et particulièrement à l’art et aux sciences du transfert de chaleur. » Sa manière en classe, apparemment très sérieuse, était souvent ponctuée de fantaisie, comme par exemple : « Je n’aime pas le sifflement que je fais quand je dis d’1f. Désormais, c’est d (fourche)! » Beaucoup de ces moments étaient collectés par des assistants enseignants amusés dans une collection privée appelée Monologues de McAdams. Profondément sérieux dans son travail technique et étonnant souvent ses collègues par sa capacité à repérer si facilement les erreurs de logique ou les défauts des techniques expérimentales, il pouvait être l’âme de la fête en se détendant ; son répertoire de ballades du Sud, de spirituals fantaisistes et de vieux favoris, tout en s’accompagnant au piano, à la guitare ou à la mandoline, semblait ne jamais s’épuiser. En raison de problèmes de santé, le Professeur McAdams est devenu émérite en 1957. Il est décédé en 1975 à l’âge de 83 ans.
Walter Gordon Whitman, 188)-1974 Le Professeur Whitman a obtenu son baccalauréat et sa maîtrise en génie chimique au M.I.T. en 1917 et 1920. Il a rejoint le personnel de l’Institut en tant qu’instructeur en chimie industrielle en 1918 et a été professeur adjoint de génie chimique aux stations de Bangor et de Boston de la School of Chemical Engineering Practice du M.I.T., ainsi que directeur adjoint du Laboratoire de recherche en chimie appliquée jusqu’en 1925. Après neuf ans avec la Standard Oil Company of Indiana, il a quitté son poste de directeur associé de la recherche pour prendre la tête du département de génie chimique du M.I.T., poste qu’il a occupé jusqu’en 1961. Le Professeur Whitman est probablement mieux connu dans les cercles techniques pour son développement de la théorie à deux films pour l’absorption de gaz et pour ses contributions dans le domaine de la corrosion. Ses dernières années ont été largement consacrées à l’administration du département et à des services publics tels que le War Production Board, le National Advisory Committee for Aeronautics, conseiller scientifique du Département d’État, et secrétaire général de la Conférence des Nations unies sur les utilisations pacifiques de l’atome. Sa citation lors de son élection à l’Académie nationale de l’ingénierie indiquait en partie « … ses contributions au génie chimique et son leadership dans la fourniture de conseils techniques au gouvernement américain et aux
Nations unies. » Sa direction du département se caractérisait par une insistance paternelle sur la qualité et une ouverture d’esprit à l’innovation. Il avait tendance à rappeler à son personnel s’il pensait qu’ils avaient besoin d’une coupe de cheveux, et il portait toujours des nœuds papillon. Habile à la guitare, il appréciait beaucoup diriger un groupe convivial lors d’une séance de chant.
Harold Christian Weber, 189)- Professeur Weber, né à Roxbury, MA, a obtenu son diplôme en génie chimique du M.I.T. en 1918 et son doctorat de l’Eidgennosiche Technische Hochschule à Zurich en 1935. Il a servi dans le Chemical Warfare Service pendant la Première Guerre mondiale et en 1919 a rejoint Walker, Lewis, McAdams et Knowland en tant qu’ingénieur consultant. Il a été nommé au corps professoral en 1922 et a dirigé la station de Boston de la School of Chemical Engineering Practice de 1923 à 1928. En 1939, il a publié le premier ouvrage de ce genre, Thermodynamics for Chemical Engineers, révisé avec le Professeur H. P. Meissner en 1957. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été conseiller technique auprès du commandant du Chemical Warfare Service Development Laboratory au M.I.T. Ce laboratoire, conçu pour être utilisé par le département de génie chimique, a servi de quartier général de 1946 à 1976. Il a été nommé conseiller scientifique en chef du chef de la recherche et du développement en 1958 et vit à la retraite en Arizona depuis 1960. Ses services en tant que consultant dans les domaines du pétrole, des textiles, du papier et de l’équipement mécanique et électronique ont été d’une grande valeur pour introduire les réalités de la profession de génie chimique dans la salle de classe, rendant ainsi ses conférences vivantes pour les étudiants.
Thomas Kilgore Sherwood, 1903-1976 Le professeur Sherwood est né à Columbus, OH, a obtenu son diplôme de premier cycle de l’Université McGill en 1923 et ses diplômes de maîtrise et de doctorat du M.I.T. en 1924 et 1929. En 1928, il a été nommé professeur adjoint de génie chimique à l’Institut polytechnique de Worcester, revenant au M.I.T. en 1930 en tant que professeur adjoint de génie chimique. À partir de 1940, il a progressivement occupé les postes d’assistant technique, de chef de section et de membre de la division au sein du National Defense Research Committee. Son ouvrage, Absorption and Extraction, publié en 1937, a été révisé avec le Professeur R. L. Pigford de l’Université du Delaware, puis également en tant que Mass Transfer avec Pigford et le Professeur C. R. Wilke de l’Université de Californie. En 1939, avec le Professeur C. E. Reed, il a publié le premier Applied Mathematics in Chemical Engineering, révisé en 1957 par le Professeur H. S. Mickley. Il a coécrit Properties of Gases and Liquids avec le Professeur R. C. Reid, le révisant en 1966 et à nouveau en 1976 (ce dernier avec le Professeur J. Prausnitz de l’Université de Californie). The Role of Diffusion in Catalysis avec le Professeur C. N. Satterfield et A Course in Process Design ont été publiés en 1963. Ses recherches et son enseignement ont englobé les domaines du séchage, du transfert de chaleur, de l’absorption et de l’extraction, ainsi que de la diffusion turbulente. Ses collègues ont nommé le nombre sans dimension utilisé dans les corrélations de transfert de masse comme le « nombre de Sherwood » en son honneur. À sa retraite en 1969, il est devenu professeur invité à l’Université de Californie, où il a continué jusqu’à son décès.
Le Professeur Sherwood était actif dans les affaires sociétales : entre autres choses, il était membre fondateur de l’Académie nationale de l’ingénierie. Il a également été doyen de la faculté de génie du M.I.T. de 1946 à 1952. Il était un grimpeur passionné de montagne et un skieur, amateur de blagues et de problèmes techniques difficiles. Ses étudiants appréciaient son enseignement ainsi que son attention solliciteuse envers leurs problèmes personnels lorsqu’ils lui demandaient de l’aide. Ses nombreuses distinctions, dont un doctorat de l’Université du Danemark et une adhésion à vie honoraire à l’Institut canadien de chimie, sont éclipsées par l’estime dans laquelle le tenaient ses anciens étudiants.
Hoyt Clarke Hottel, 1903- Le Professeur Hottel est né à Salem, IN, et a obtenu son diplôme en chimie à l’Université de l’Indiana en 1922. Il est venu au M.I.T. avec l’intention de poursuivre des études supérieures et des recherches en chimie du caoutchouc, mais est devenu l’une des principales autorités dans les domaines de la combustion et du transfert radiatif. Ses recherches pionnières ont permis de fonder scientifiquement la conception de grands fours, en particulier les serpentins de craquage. Après avoir obtenu son diplôme de maîtrise en génie chimique en 1924, il a été nommé boursier en génie du combustible et du gaz, puis au corps professoral du département. Il a été directeur du Laboratoire de recherche sur les combustibles de 1934 jusqu’à sa retraite en 1968, et président du comité de recherche sur l’énergie solaire du M.I.T., où il était également responsable de la construction de trois maisons expérimentales chauffées par l’énergie solaire. Il a reçu la Médaille du mérite des États-Unis et la Médaille du roi de Grande-Bretagne pour son service pendant la Seconde Guerre mondiale en tant que chef de la section de guerre du feu du National Defense Research Committee et sur le Comité de la turbine à gaz du National Advisory Committee for Aeronautics. Après la guerre, il a été président du comité de recherche sur le feu de l’Académie nationale des sciences pendant 10 ans. Il a contribué à l’initiation et a été pendant de nombreuses années le président du Comité américain sur le rayonnement des flammes, soutien des activités de recherche de l’International Flame Foundation. Il a coécrit avec les professeurs G. C. Williams et C. N. Satterfield les Thermodynamic Charts for Combustion Processes en 1949, et avec le professeur A. F. Sarofim le Radiative Transfer en 1967, deux textes largement utilisés au fil des ans. Il est connu de ses étudiants et de ses collègues pour ses analyses méticuleuses et solides de problèmes complexes, ainsi que pour ses efforts inlassables dans tous les projets qu’il entreprend. Le Professeur Hottel a continué à enseigner ses cours sur la combustion et le transfert radiatif pendant quelques années après être devenu émérite, et il continue aujourd’hui en tant que consultant très estimé pour ses pairs, ses étudiants et le gouvernement.
Edwin Richard Gilliland, 1909-1973 Le Professeur Gilliland, originaire d’El Reno, OK, a obtenu un diplôme de premier cycle de l’Université de l’Illinois en 1930, une maîtrise de la Pennsylvania State University en 1931, et en 1933 le doctorat du M.I.T. Il a été instructeur et professeur en génie chimique, doyen adjoint, directeur associé du Laboratoire de science nucléaire et d’ingénierie, président du corps professoral, et de 1961 à 1969, chef du département de génie chimique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a dirigé un projet du NDRC sur la production d’oxygène, a été directeur adjoint de la recherche à la Rubber Administration, chef du Navy Jet Propulsion Panel, vice-président du comité des missiles guidés des chefs d’état-major, et chef du Bureau du service sur le terrain. Plus tard, il a été membre du Comité consultatif scientifique du président et du Comité de l’eau salée du Département de l’Intérieur. Avec le Professeur W. K. Lewis, il a travaillé sur le craquage catalytique en lit fluidisé du pétrole et avec le Professeur W. H. McAdams, il a révisé Principles of Chemical Engineering, et a coécrit la révision d’Elements of Fractional Distillation avec le Professeur C. S. Robinson. Il était une autorité de premier plan en distillation, en production de caoutchouc synthétique et en déminéralisation de l’eau de mer. Le Dr. Gilliland s’intéressait autant à l’éducation des étudiants de premier cycle qu’à celle des étudiants diplômés et à ses propres recherches ainsi qu’à celles de ses collègues. Il semblait avoir une énergie inépuisable (toujours à son bureau avant la plupart des gens le matin) et avait un appétit insatiable pour explorer des problèmes techniques. Il était connu pour ses processus de pensée rapides et pour son interjection de la phrase « d’un côté… » alors qu’il triait apparemment les nombreuses idées qui traversaient son esprit pour trouver la plus appropriée pour le cas en cours. Malgré sa pensée rapide, qui intimidait parfois les nouveaux étudiants, il était très attentionné et minutieux pour élucider les phénomènes à ses étudiants, et la grande délégation de ceux qui ont assisté à ses obsèques témoigne clairement de l’estime élevée en laquelle il était tenu par ses nombreux anciens élèves très réussis.
Dans l’éducation d’une personne pour devenir un enseignant inspirant au niveau universitaire, les tactiques doivent varier en fonction du temps, des circonstances et de la personnalité. D’un autre côté, il peut y avoir des principes permanents. L’éducation de W. K. Lewis, un enseignant notablement influent en génie chimique, suggère les principes suivants : (1) développer un intérêt profondément enraciné pour chaque étudiant en tant qu’individu ; (2) cultiver une habitude de toute une vie de chercher des rencontres avec la grandeur dans des domaines d’intérêt humain en plus du sujet d’enseignement ; (3) inclure des réalisations significatives dans un domaine tout à fait différent de l’enseignement académique et de la recherche ; et (4) impliquer les étudiants et les collègues dans le processus de formation des enseignants de manière plus qu’obligatoire.
À de nombreux lecteurs, la personne dont je parle doit sembler être une figure lointaine. Cependant, il y a quelque chose que seule la distance peut donner – la perspective. En esquissant les origines de la compétence de W. K. Lewis en tant qu’enseignant, j’espère pouvoir suggérer quelques perspectives d’intérêt et de valeur permanente.
La Figure 1 est une photo de W. K. Lewis à l’âge de 90 ans. Les autres personnes dans la scène sont tous d’anciens étudiants à lui. De gauche à droite, il y a Cherry L. Emerson, Jr. de Géorgie, W. K. Lewis, Jr. et James Donovan du Massachusetts, et Edwin R. Gilliland de l’Arkansas.
La génération à laquelle appartenait W. K. Lewis a produit un certain nombre d’enseignants inspirants au collège et à l’université. Qu’il faisait partie de ce groupe est bien documenté (1-6). Même lorsqu’il était dans la nonantaine, bien après sa retraite, une foule d’anciens étudiants dans toutes les parties des États-Unis et dans de nombreux pays du monde entier se souvenaient encore de lui avec respect et affection.
Comment cela s’est-il produit ? En particulier, qui étaient les influences clés ? Les réponses à ces questions peuvent éclairer le problème de l’identification, du recrutement et du développement d’enseignants inspirants de calibre universitaire.
ChatGPT
Préoccupation pour Chaque Étudiant
En cherchant des influences clés, j’ai découvert quatre indices. Le premier se trouve dans un article paru il y a quelques années dans un magazine populaire (2). L’article présentait les résultats d’une tentative d’identifier les meilleurs enseignants d’université et de collège aux États-Unis à l’époque. Aucune huit personnes plus différentes en personnalité et en style ne peuvent être imaginées. Néanmoins, l’auteur de l’article a observé qu’ils avaient tous une caractéristique commune. Tous enseignaient avec leur cœur aussi bien qu’avec leur esprit. Apparemment, en matière d’enseignement de qualité, le style est une affaire hautement individuelle. Il dépend de l’expérience et de la personnalité de l’enseignant, de la matière enseignée, des installations disponibles et des expériences et personnalités des étudiants. Cependant, enseigner avec le cœur aussi bien qu’avec l’esprit est essentiel.
La signification exacte de cette observation n’est pas claire en l’état. D’un autre côté, je crois que l’auteur de l’article essayait de faire valoir un point crucial. Lorsqu’un étudiant apprend quelque chose d’importance durable, presque toujours un facteur crucial est la préoccupation de l’enseignant pour lui ou elle en tant qu’individu. L’étudiant peut ne pas se rendre compte de cette préoccupation à l’époque, voire même des années plus tard. Lorsque la réalisation survient, cependant, elle imprègne la contribution d’un enseignant comme rien d’autre ne peut le faire.
Chez Lewis, connu de tous ses amis sous le nom de Doc, la préoccupation pour chaque étudiant en tant qu’individu était forte. En fait, c’était au cœur de sa personnalité. Qui a transmis cette préoccupation à Doc ? Les psychologues nous disent qu’en ce qui concerne les attitudes émotionnelles envers les autres, l’influence première est l’atmosphère entourant un enfant pendant ses premières années. Par conséquent, je pense qu’il est d’une importance capitale que les parents de Doc et les autres membres de la famille élargie dans le foyer où il a grandi étaient tous dominés dans la pensée et l’action par deux individus d’une compagnie rare. Cette compagnie – quelques membres bien connus de l’histoire, beaucoup inconnus – se compose de personnes qui, jour après jour, année après année, essaient d’être au service des autres. Dans le cas des parents et des proches de Doc, les deux personnes qui dominaient leur vie étaient Jésus de Nazareth et John Wesley.
Lorsque Doc s’est marié, il a rejoint l’église de sa femme, Congrégational, et n’était plus sous l’influence quotidienne de John Wesley. L’influence de Jésus a persisté. Tout au long de leur longue vie ensemble, Doc et Rosalind Kenway, la femme qu’il a eu la chance d’épouser, se considéraient comme des personnes cherchant humblement à être au service des autres, tout comme Jésus.
Cela suggère un sujet que les historiens pourraient souhaiter explorer. Beaucoup a été écrit sur le conflit entre la science et la religion pendant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Au cours de la même période, quelles étaient les relations entre l’ingénierie et la religion ? Ont-elles été affectées par le conflit entre la religion et la science ?
Quant à Doc, comme tant d’entre nous, il avait en tête de nombreuses questions sans réponse. Cependant, sur la question particulière de la religion et de la science, il en est venu à croire qu’il n’y a vraiment aucun conflit. Par exemple, il partageait l’avis de Harry Emerson Fosdick selon lequel la science n’a pas sapé la Bible. Au contraire, la recherche établissant l’époque approximative à laquelle chaque livre de la Bible a été écrit a grandement amélioré notre compréhension et notre appréciation de ses enseignements spirituels (7). Doc était d’accord avec Albert Schweitzer selon qui l’analyse critique des preuves historiques concernant Jésus a souligné, plutôt que diminué, sa pertinence pour notre époque. En fait, le dernier paragraphe de l’œuvre de Schweitzer, connue sous le nom de The Quest of the Historical Jesus (8, 9), donne la base de l’allégeance de Doc au Nazaréen. En religion comme en science, croyait Doc, l’approche fructueuse est la même. Pour vivre efficacement, il faut procéder sur la base d’hypothèses. Il aimait la définition de la foi de Fosdick. « La foi consiste à vivre selon ce que vous savez de plus élevé » (10). Le plus élevé que Doc connaissait était le respect intense et la préoccupation pour chaque être humain.
Rencontres avec la Grandeur
En cherchant des personnes ayant une influence clé dans le développement des compétences pédagogiques de Doc, j’ai trouvé ma deuxième piste dans une déclaration d’Alfred North Whitehead. Selon Whitehead, « l’éducation est impossible en dehors de la vision habituelle de la grandeur » (11). Il parlait, bien sûr, de l’éducation à son meilleur. Il disait que les enseignants les plus efficaces réussissent à organiser, de diverses manières, des rencontres avec la grandeur pour les étudiants.
Cela peut être difficile à réaliser, en particulier dans les cours professionnels pour les scientifiques et les ingénieurs. Les domaines évoluent si rapidement qu’un enseignant en physique, par exemple, ne peut souvent pas confronter les étudiants à la profondeur et à la subtilité de la pensée que l’on trouve dans les écrits de Newton ou Planck. Trop de temps doit être consacré aux écrits sur les derniers matériaux, rédigés par des personnes compétentes, certes, mais pas de génie.
Si les enseignants en génie chimique doivent confronter les étudiants à la grandeur, la plupart d’entre eux doivent la puiser dans d’autres domaines et l’intégrer dans l’enseignement des derniers matériaux de génie chimique. Une grande partie de l’intégration doit être subtile, à travers l’intonation, le style, le comportement dans les contacts informels, et l’impact intangible d’un esprit riche. Une partie de l’intégration peut être simple. Pensez, par exemple, à un gaz parfait, cette merveilleuse création de l’imagination de Maxwell, et à un graphique de compressibilité. Il suffit d’une minute pour souligner que, considérées ensemble, l’idée de Maxwell et un graphique de compressibilité illustrent l’utilisation d’un outil intellectuel puissant, exemplifié par La République de Platon (12, 13, 14, 15), et applicable dans de nombreux domaines de l’effort humain. L’idée de Platon est la suivante. Lorsque l’on est confronté à un ensemble de situations complexes, il est souvent d’une aide immense pour la clarté de la pensée d’imaginer un modèle idéalisé, puis de considérer les différences entre le modèle et les situations réelles. En faisant cela, un schéma émerge souvent. Ainsi, au lieu de devoir réfléchir à un fouillis de situations réelles, on peut réfléchir à deux idées simples – un modèle idéalisé et un schéma de déviations.
Pour faire beaucoup de ce type d’intégration, il faut avoir une habitude forte et durable de rechercher régulièrement des rencontres avec la grandeur. Chez Doc, cette habitude était avant tout une habitude de lecture. Tout au long de sa vie, il lisait constamment les œuvres de grands scientifiques et ingénieurs. Il explorait également sans cesse les chefs-d’œuvre d’essayistes, de nouvellistes, de romanciers, de biographes, d’historiens et de philosophes.
La personne qui a planté et cultivé cette habitude était une cousine germaine, Mary Witherbee. De vingt ans son aînée, elle enseignait l’anglais au Lasell Seminary, aujourd’hui le Lasell Junior College, à Newton, dans le Massachusetts, mais passait chaque été à la ferme du Delaware où Doc est né et a grandi. Parmi les mille manières imaginatives dont elle a nourri cette habitude, je mentionnerai seulement une. Son cadeau de mariage à Rosalind Kenway et Doc était l’édition Temple de Shakespeare (16). Chaque pièce était dans un volume de poche séparé. Pendant des années, chaque fois que Doc partait en voyage d’affaires, il glissait l’un de ces volumes dans sa poche pour le lire dans le train. Pas étonnant que son enseignement ait commencé à refléter quelque chose de la perspicacité de Shakespeare dans le cœur humain.
Dans le processus d’intégration, le choix des brins à utiliser dépendra bien sûr des intérêts individuels de l’enseignant, du sujet, du groupe particulier d’étudiants et du climat culturel général. D’un autre côté, Doc estimait qu’un brin était tellement important que des dispositions devraient toujours être prises pour qu’au moins un enseignant d’une matière technique l’intègre à l’éducation professionnelle d’un ingénieur chimiste à un moment donné de l’entreprise. Ce brin est l’histoire.
La conviction de Doc selon laquelle l’histoire est essentielle était basée sur les observations suivantes. D’une part, la plupart des étudiants en ingénierie ont peu d’intérêt pour les problèmes du passé, mais pour une utilisation future, ils ont besoin d’une sorte de sens de la manière dont les plus grands esprits scientifiques et ingénieurs travaillent lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes complexes. Ils doivent également réaliser, pour une utilisation future, l’une des grandes leçons de l’histoire. Les avancées majeures sont rarement réalisées par la persuasion logique seule. Elles exigent de vivre une vie. Enfin, la plupart des étudiants en ingénierie pensent de manière concrète. Essayer de communiquer les idées ci-dessus en parlant de principes abstraits est désespéré. Ce dont la plupart des étudiants se souviendront, et se souviendront toute leur vie, est une histoire dramatique de l’histoire. Ainsi, à partir de l’histoire, et de nombreuses autres régions de la vie, Doc confrontait continuellement les étudiants à des aperçus de grandeur.
Recruter un Accomplisseur du Monde Extérieur
Ma troisième indication est la suivante. Contrairement à de nombreux bons enseignants, Doc a dû être recruté. Comment il a été recruté illustre un principe. Avant que je ne l’énonce, permettez-moi de décrire les circonstances dans lesquelles il s’applique. Pour de nombreux étudiants, les années universitaires comprennent des périodes de réflexion profonde sur la vie. Pour les étudiants et la société, il est important qu’ils fassent cette réflexion en ayant une conscience aiguë de la vaste gamme de possibilités dans la vie. Non rarement, les personnes ayant le plus grand potentiel pour communiquer une telle prise de conscience sont de jeunes diplômés qui réalisent déjà des réalisations significatives dans le monde extérieur, bien loin de l’enseignement académique et de la recherche. Pour obtenir leurs services, ceux qui recrutent des enseignants universitaires doivent faire des offres concurrentielles par rapport aux employeurs non académiques.
Maintenant, pour le principe. Attirer certains de ces jeunes réalisateurs dans l’enseignement est important. Dans leur recrutement, la psychologie est plus importante que l’argent. Pour montrer comment cela fonctionnait dans le cas de Doc, je dois donner un peu de contexte. Comme mentionné précédemment, il est né et a grandi dans une ferme dans le Delaware. Il l’aimait. Quand il est entré au M.I.T. en tant que freshman, ce n’était pas parce qu’il avait un intérêt pour une carrière en science ou en ingénierie. Il pensait qu’une école d’agriculture de l’époque ne lui enseignerait que les pratiques actuelles de l’agriculture. Au M.I.T., il pouvait apprendre les principes de la science et de l’ingénierie sur lesquels l’agriculture serait basée dans les années à venir. Lorsqu’il a obtenu son diplôme, Doc prenait toujours pour acquis que son travail serait en tant que gestionnaire et principal ouvrier agricole sur la ferme du Delaware. Bien qu’il ait postulé et remporté une bourse d’études de deux ans pour étudier en Allemagne, il considérait cela simplement comme une opportunité généreuse pour des rencontres avec la grandeur avant de commencer sa carrière à la ferme.
Pour aider à gagner des dépenses au M.I.T., Doc passait chaque été à la ferme. La Figure 2 est une photo de lui là-bas. Pour le bénéfice de ceux qui n’ont jamais vu un spécimen de cette espèce, l’autre personnage sur cette photo est une mule. Les mules sont fortes, intelligentes et têtues. Les mules ont des opinions très définies, qu’elles expriment sans ambiguïté. Les mules expriment leurs opinions de manière à laisser une empreinte indélébile. Peut-être que je ne devrais pas mentionner cela, mais des personnes familières à la fois avec Doc et une mule ont été connues pour commenter, parfois assez vivement, des ressemblances entre les deux.
Quoi qu’il en soit, l’influence de la ferme était forte. Lorsque Doc est revenu d’Allemagne, il est passé à l’ingénierie et a intégré l’industrie, disant que l’auto-analyse l’avait convaincu qu’il apportait une meilleure contribution aux autres lorsque la compétition était vive. Il savait que la compétition serait plus féroce en ingénierie qu’à la ferme, mais même alors, il restait en contact avec les activités agricoles et rêvait d’y retourner après sa retraite.
Peu de gens savent à quel point Doc était accompli dans l’industrie lorsque le M.I.T. l’a recruté. La valeur que la société pour laquelle il travaillait lui accordait est indiquée par l’action du responsable du siège auquel il rendait compte. J’ai appris cela bien des années plus tard, non de Doc mais de l’officiel. Selon lui, dès qu’il a entendu dire que le M.I.T. cherchait à recruter Doc, il l’a appelé, a souligné la confiance de l’entreprise en lui, a découvert le salaire que le M.I.T. proposait, et a offert le double. Doc a dit, « Non. » L’officiel a offert trois fois plus. Doc a dit, « Non. »
Finalement, l’officiel a observé, « Je suppose qu’il n’y a aucune somme que je puisse offrir qui vous empêchera d’aller au M.I.T. » Doc a dit, « Je suppose que non. » L’officiel a abandonné. Il a reconnu qu’il devait y avoir une attraction plus forte que toute contre-attraction qu’il pourrait rassembler.
Quelle était l’attraction ? Il y a une histoire à ce sujet. Bien que Doc m’ait dit que c’était un mythe, cela transmet des faits historiques. Cela sonne si vrai pour les personnalités des deux individus impliqués. Selon l’histoire, lorsque Walker a approché Doc pour un poste au M.I.T., Doc a indiqué qu’il était heureux là où il était. Mais Walker connaissait son homme. Il savait que parfois il fallait être franc avec lui ; il connaissait son sens de l’humour ; il connaissait son profond désir de servir les autres ; il connaissait la ferme. Walker a explosé. « Warren », a-t-il crié, « j’ai entendu dire que tu as récemment inventé un nouveau type d’épandeur de fumier que tu espères utiliser sur cette ferme dans le Delaware. Tu ne comprends absolument pas les opportunités que tu auras pour répandre du fumier si tu viens enseigner au M.I.T. »
Cela a fonctionné. Le jeune accomplisseur a apprécié les opportunités. Il est venu. Comment il a utilisé ces opportunités est décrit de manière glorieuse dans la brochure où j’ai trouvé ma quatrième indication.
Implication des Étudiants et des Collègues
Ma quatrième indication, je l’ai trouvée dans ce travail d’amour de Tom Sherwood, ce joyau, ce classique, « A Dollar to a Doughnut » (3). Compilé à l’époque de la retraite de Doc, c’est une collection d’histoires préférées à son sujet, que Tom a sollicitées auprès d’anciens étudiants. Les histoires et les illustrations, réalisées par un maître caricaturiste, n’ont pas de prix.
Mon indice est le suivant. Comme tout enseignant le sait, les enseignants apprennent des étudiants. « A Dollar to a Doughnut » révèle que, dans le cas de Doc, l’influence des étudiants dans le développement de son efficacité en tant qu’enseignant était anormalement élevée. Comment cela s’est produit est intrigant. Pour une chose, cela illustre le fonctionnement réussi d’une stratégie éducative souvent négligée, une stratégie qui peut parfois rapporter gros. Surtout intrigant est le rôle de la sérendipité.
Le problème nécessitant une stratégie est assez courant. Aucune méthode d’enseignement n’est parfaite. Un étudiant a souvent une critique constructive à faire. En la communiquant à l’enseignant, quelle stratégie est la plus susceptible d’être efficace ? En génie chimique – du moins aux États-Unis aujourd’hui – la pratique la plus courante est peut-être pour un administrateur ou une organisation étudiante de distribuer des formulaires d’évaluation des enseignants aux étudiants à la fin d’un cours. Ensuite, les formulaires complétés et non signés ou les résultats résumés sont remis à l’enseignant.
Dans « A Dollar to a Doughnut », plusieurs histoires révèlent l’impact exaltant d’une autre approche. Au fur et à mesure que l’instruction progressait, Doc attirait les étudiants dans une activité amusante. De quelque manière, ils se sont retrouvés à rivaliser les uns avec les autres. Qui pouvait être le plus ingénieux pour enseigner à l’enseignant comment enseigner de manière plus efficace ? Le résultat ? Beaucoup de profit et de plaisir !
Je me tourne maintenant vers la sérendipité dans cette affaire. La sérendipité, vous vous en souvenez, est « une aptitude apparente à faire des découvertes fortuites et heureuses » (17). La concentration de Doc sur l’interaction enseignant-étudiant portait sur des questions autres que l’enseignement. L’une de ses grandes concentrations, par exemple, était d’enseigner aux étudiants à penser par eux-mêmes. Je ne crois pas qu’il ait jamais travaillé consciemment pour obtenir un apport anormalement élevé des étudiants sur l’art de l’enseignement. C’était une combustion spontanée.
Le mécanisme de réaction dépendait de deux caractéristiques de sa personnalité. L’une exerçait une poussée, l’autre une traction. La première caractéristique était l’intensité. Une combinaison d’énergie, d’enthousiasme, d’un profond désir d’aider les étudiants, d’une grande puissance de concentration et de la conviction que l’intensité est essentielle à l’éducation, tout cela le poussait à avancer sans être aussi sensible à la réaction individuelle de chaque étudiant qu’on le souhaiterait. L’incident suivant, relaté par un ancien élève, est typique. Jusqu’à ce que Doc le lise dans « A Dollar to a Doughnut » (3), il était complètement inconscient que sa procédure en classe un certain jour avait eu un effet humidifiant sur un certain étudiant de la classe.
« C’est arrivé en 1930. C’était mon premier jour à Tech, et ma première expérience avec Doc Lewis… La salle de classe, telle que je m’en souviens, était assez grande, avec Doc convenablement installé tout en haut d’une estrade très élevée. Tout était très impressionnant pour un débutant. ‘Puisque vous êtes tous des étudiants diplômés et donc de véritables experts scientifiques, j’aimerais faire un rapide survol des lois fondamentales de la nature qui servent de toile de fond à ce cours. Est-ce que quelqu’un ici peut citer une seule loi infaillible de la nature ?’ Silence (complet). ‘Toi là-bas, le premier homme de la première rangée, tu ne peux pas en citer une ?’ Réponse : ‘La loi de conservation de la matière.’ ‘Humph ! As-tu déjà entendu parler des rayons cosmiques ? Ces choses détruisent ta loi jusqu’au royaume des cieux. L’homme suivant.’ Réponse : ‘J’avais l’intention de mentionner la loi de conservation de la matière, mais…’ Inutile. L’homme suivant. Et ainsi de suite jusqu’à ce que Doc me rejoigne. Chaque réponse à son tour avait été démolie sans ménagement. À ce moment-là, Doc avait quitté son perchoir élevé et se tenait à environ trois pieds devant moi. En réponse à son doigt pointé, j’ai balbutié… ‘La loi de la proportion constante.’ ‘As-tu déjà entendu parler des isotopes ?’ (À ce moment-là, il criait presque). ‘Oui, les isotopes sont… ‘ ‘Laisse-moi te dire. Les isotopes sont des choses (et là il se pencha vers moi à environ 12 pouces) – sont des choses qui crachent au visage de la loi de la proportion constante.’ Il n’a pas raté, non plus. Comment aurait-il pu ? Nous étions pratiquement nez à nez à ce moment-là » (3). Par souci d’équité envers Doc, je dois noter que je n’ai pas encore donné la dernière phrase de l’histoire de l’ancien élève. « Mais pour cette douche », a-t-il conclu, « j’aurais très probablement oublié à la fois l’incident et la leçon précieuse qu’il contenait. » Cependant, cette phrase était le verdict calme et réfléchi d’un ingénieur mature, regardant en arrière sur l’occasion de nombreuses années plus tard. Au moment de l’événement, on peut être sûr, son sentiment était radicalement différent.
Une autre histoire de « A Dollar to a Doughnut » illustre la deuxième caractéristique de la personnalité de Doc.
« Doc avait un étudiant effectuant une expérience de laboratoire qui impliquait une titration dépendant de l’obtention d’une couleur d’amidon bleu avec de l’iode libre. L’homme n’avait aucun succès dans la vérification des résultats. Cela devint tellement grave que Doc entra dans le laboratoire pour observer. Son œil infaillible repéra l’amidon, et il exigea de savoir d’où il venait. Après avoir été informé qu’il provenait de l’étagère, Doc explosa et dit, entre autres choses, qu’il ne laisserait personne préparer son indicateur d’amidon. Sur quoi, Doc mélangea un nouvel amidon, fit deux titrations lui-même, qui concordèrent, puis exigea que l’étudiant le fasse pendant qu’il observait. Le premier geste de l’étudiant a été de verser la solution d’amidon frais dans l’évier, et lorsque Doc explosa à nouveau et demanda comment cela se faisait, l’étudiant dit : « Tu m’as dit de ne jamais laisser personne préparer ma solution d’amidon. » « Merveilleux ! » rugit Doc. « Tu sais, vieux cheval, parfois tu montres de faibles signes d’intelligence ! » Lorsque le rapport de l’étudiant sur l’expérience est revenu, la note était un « H », la plus haute note du système de notation à cette époque. Cela signifiait « Honneur » (3).
Invariablement, en réagissant à une réponse vive à ses tactiques d’intimidation, Doc montrait un esprit ouvert, un sens de l’humour aiguisé et une disposition instantanée à changer de direction avec bonne humeur. Une incroyable variété de réponses imaginatives apparaissait avec beaucoup d’hilarité. Comme la poussée et la traction faisaient partie intégrante de la nature de Doc, elles apparaissaient avec une force totale non seulement en classe et au laboratoire, mais aussi dans les conversations avec ses collègues du département. Dois-je ajouter que ses collègues, une équipe remarquable d’individus pleins d’entrain, se sont engagés avec enthousiasme dans son jeu de donner et prendre vigoureux ? En toute sincérité, les mots ne peuvent pas exprimer la valeur pour Doc de leur patience et de leur aide au fil des ans.
Oui, une sorte d’implication active et continue des étudiants et des collègues dans l’enseignement d’un professeur sur la manière d’enseigner peut être un dispositif puissant. D’un autre côté, « A Dollar to a Doughnut » reflète également le fait bien connu que différentes personnes aiment différentes activités. Qu’en est-il de ceux qui n’appréciaient pas la forme d’exercice impliquée dans le jeu de Doc ? Consciemment ou inconsciemment, ils ont répondu à ses tactiques par différents types de signaux. Certains de ces signaux, il a appris à les reconnaître. Chaque fois qu’il en remarquait un, il réagissait avec réflexion et grâce. Malheureusement, dans de nombreux cas, il ne captait pas le signal d’un étudiant à ce moment-là.
À propos des cas de ce dernier type, il y a quelque chose que peu de gens savent. Souvent, des années plus tard, Doc se souvenait d’un tel incident, comprenait le signal et apprenait la leçon. L’impact serait profond car il se souviendrait de la personne impliquée. La pensée qu’il avait blessé cette personne le faisait souffrir. Comme je l’ai écrit en discutant de ma première indication, le souci de chaque individu était au cœur de sa personnalité. Après que les handicaps liés à la vieillesse l’aient obligé à cesser d’enseigner et qu’il ait eu plus de temps libre, cette tendance à se souvenir et à apprendre a augmenté. Les leçons continuaient à lui revenir à l’esprit, à faire de lui un être humain plus sensible. Vraiment, les étudiants et les collègues peuvent influencer les enseignants plus qu’ils ne le réaliseront jamais.
Réflexions
Regardez à nouveau la Figure 1. Dans ses dernières années, ce vieil homme digne avait quelques réflexions intéressantes sur la vie et l’enseignement. En voici quelques-unes.
« Nous vivons dans un univers, pas dans un multivers. Entre autres choses, cela signifie que la science, l’ingénierie, la quête de la justice, la quête de la beauté et la quête de la sainteté sont interdépendantes. »
« En ce qui concerne les humains, l’objectif de l’univers semble être le développement du caractère. »
« La vie est plus importante que la religion. »
« L’enseignant qui échoue à communiquer quelque sentiment d’émerveillement pour l’univers dans lequel nous vivons manque à son devoir. »
« Les chirurgiens opèrent sur les corps. Les enseignants opèrent sur les esprits et les âmes. »
« Les chirurgiens opèrent sur les corps. Les enseignants opèrent sur les esprits et les âmes. »
Bien sûr, Doc savait que de bons chirurgiens considèrent des personnes entières, pas seulement des corps. Il sentait profondément que les enseignants ont une responsabilité particulière envers les esprits et les âmes. Pour y répondre, ils doivent utiliser la précision et le soin d’un chirurgien.
Il y a autre chose. Nous sommes tous enseignants parfois, chaque fois que nos paroles ou nos actions influencent l’esprit et l’âme d’un autre individu. Ainsi, le chirurgien est un symbole merveilleux de ce que chacun de nous doit être parfois. Je termine en citant une autre voix du Massachusetts. Il y a cent vingt ans, Emily Dickinson a exprimé l’idée comme suit (18) :
« Les chirurgiens doivent être très prudents
Quand ils prennent le bistouri !
Sous leurs belles incisions
Remue le Coupable – la Vie ! » (18).
Literature C itea
- Anon. J. Eng. Educ. 1947-8, 38, 2.
- Anon. Life 1950, 29 (16), 109.
- Anon. « A Dollar to a Doudlnut »; privately printed, 1953. Reprint, Amer-
ican Institute of Chemical Engineers: New York, no date. - Pinck, D. C. Technol. Rev. 1963, 65 (5), 16.
- Anon. Chern. Eng. Prog. 1965, 61 (1), 32-3.
- Gilliland, E. R. Chern. Eng. Educ. 1970, 4 (4), 156.
- Fosdick, H. E. ‘7he Modern Use of the Bible »; Macmillan: New York,
- 1924.
- Schweitzer, A. « Von Reimarus zu Wrede »; Mohr: Tuebingen, 1906.
- Montgomery, W. « The Quest of the Historical Jesus. A Critical Study of
its Progress from Reimarus to Wrede »; Black: London, 1910. - Fosdick, H. E., personal communication to W. K. Lewis.
- Whitehead, A. N. « The Aims of Education and Other Essays »; Macmillan:
New York, 1929; Chapter 5. - 1TAaTwv « HOAITEIA »; 4th century B.C. Mss. of later dates.
- « Plato’s Republic. The Greek Text »; Jowett, B., Campbell, L., Eds.;
Clarendon: Oxford, 1894; 3 Vols: I. Text with a Facsimile. II. Essays. III.
Notes. - Jowett, B. « The Republic of Plato Translated into English with Introduc-
tion, Analysis, Marginal Analysis and Index », 3rd ed.; Clarendon: Oxford,
1888. - Plato. « The Republic »; Eng. trans. by P. Shorey, « Plato, with an English translation » Heinemann: London, Macmillan: New York, 1914-1955. The
Loeb classical library (Greek authors). Greek and English on opposite
pages. Contents: 11. Bks. I-V. 12. Bks. VI-X. - Shakespeare, W. « The Temple Shakespeare »; Wright, W. A., Ed.; Prefaces,
Glossaries, and Notes, I. Gollancz; Dent: London, 1895-97. - « Webster’s New World Dictionary of the American Language », 2nd college
ed.; Guralnik, D. B., Ed.; World: New York, 1970. - Dickinson, E. Poem 108. In « The Poems of Emily Dickinson »; Johnson
Thomas H., Ed.; The Belknap Press of Harvard University Press: Cambridge,
1951, 1955; reprinted by pennission.
RECEIVED May 7, 1979.
Les débuts de l’éducation en génie chimique aux États-Unis J. W. WES1WATER
À l’Université de l’Illinois, à Urbana, le génie chimique est né au sein du Département de chimie et y a connu ses premiers développements. Cela était courant pour les premiers départements, tels que ceux des universités de l’Illinois, de Pennsylvanie et du Michigan, du Massachusetts Institute of Technology, ainsi que de Tulane et Case Western Reserve Universities, et de nombreux autres. Dans ces cas, la composante de génie chimique s’est développée, et une scission a été organisée pour créer des départements de génie chimique autonomes. Il est rare que le génie chimique émerge du génie mécanique (Colorado), du génie électrique (Wisconsin) ou d’autres unités non liées à la chimie. Pour les jeunes départements de génie chimique, une origine différente est plus courante : le département est établi soudainement par décret. Le droit d’offrir le programme est établi, un budget et un espace sont définis, et un responsable est nommé pour sélectionner le corps professoral. L’origine a des effets durables…
La discipline du génie chimique a évolué à partir de la chimie. La plupart des départements universitaires de génie chimique sont issus de départements de chimie existants. Cela est vrai pour la plupart des écoles, mais pas toutes. Ce chapitre traite des débuts du génie chimique dans les universités des États-Unis, montrant en particulier que certains départements ont eu des origines étranges et inhabituelles.
Pendant des siècles, le génie signifiait simplement deux choses : le génie militaire concernait les fortifications et autres structures de guerre ; le génie civil comprenait les routes, les ponts, les voies navigables, les mines, les tunnels, et d’autres structures non militaires. D’autres domaines de l’ingénierie sont des inventions modernes. La première école d’ingénieurs aux États-Unis, l’Académie militaire de West Point, a été établie en 1794 à la demande de George Washington (1). Bien sûr, le génie chimique n’existait pas à cette époque.
Certaines universités existaient déjà à cette date, dont Yale (fondée en 1701), Princeton (1746), l’Université de Pennsylvanie (1749), Columbia (1754), Rutgers (1766), Dartmouth (1769), Pittsburgh (1787) et le Tennessee (1794). Certaines d’entre elles proposaient des cours de philosophie naturelle ou d’histoire naturelle. Un professeur de philosophie naturelle était censé enseigner toutes les sciences, y compris la chimie, la physique, l’astronomie, la zoologie, etc. Des sociétés techniques précoces telles que la Royal Society de Londres incluaient des travailleurs dans tous ces domaines, et chaque philosophe était censé s’intéresser et être compétent dans tous les autres. Benjamin Franklin incarnait le philosophe naturel réussi de cette époque.
Origines en chimie
À mesure que les connaissances s’accumulaient, la chimie a commencé à émerger comme une discipline distincte. Son importance a augmenté avec le développement d’applications commerciales. Par exemple, en 1746, la première usine d’acide sulfurique à chambre de plomb a été construite aux États-Unis, en 1791 un brevet a été délivré pour le procédé Le Blanc permettant de fabriquer de l’alcali à partir de sel ordinaire, et en 1842 le procédé Lawes pour fabriquer du superphosphate à partir de phosphate de roche a été breveté (2). Des cours de chimie enseignés dans certaines universités au début comprenaient des descriptions détaillées de ces processus et de processus similaires. En temps voulu, des cours de chimie spécifiques ont été dédiés à de telles connaissances, et leurs titres portaient des labels significatifs tels que Chimie industrielle, Chimie appliquée, Chimie du génie, Chimie technique, Chimie pratique, ou Industries chimiques. De nombreuses listes de ce type figurent dans les catalogues universitaires publiés avant 1900.
Il est difficile de déterminer avec précision le début de l’éducation en génie chimique aux États-Unis. Dans la mesure où elle est apparue par une évolution lente et non par une création soudaine, la question de « qui a été le premier » devient une question de définition. Si l’on soutient que d’anciens termes tels que la philosophie naturelle incluent le génie chimique, alors les débuts remontent aux écoles existant au XVIIIe siècle. Si l’on accepte que la chimie industrielle, la chimie appliquée, etc. soient équivalentes au génie chimique, alors certaines écoles précoces incluent le New Jersey Institute of Technology (un programme de chimie industrielle de deux ans en 1881) et Case Western Reserve (un programme de technologie chimique de quatre ans en 1884).
Il est intéressant d’examiner l’utilisation précoce des mots spécifiques « génie chimique » dans l’éducation. Ces termes ont été inventés par le professeur George E. Davis de la Manchester Technical School, en Angleterre (3). En 1880, il proposa, sans succès, la création d’une Société des ingénieurs chimistes. En 1888, il prononça et publia une série de 12 conférences sur le génie chimique. En 1901, il publia un Manuel de génie chimique. Tous ces événements ont été remarqués aux États-Unis.
Il n’y a en aucun cas eu une utilisation rapide et généralisée des termes « génie chimique » aux États-Unis. Par exemple, en 1882, Case Western Reserve déclarait : « Le programme d’études en chimie sera rendu aussi pratique que possible » (4). On trouve ici une allusion claire au génie chimique. L’année suivante, le catalogue mentionne des « conférences sur la chimie théorique et technique » (5). En 1884, Charles F. Mabery rejoint le corps enseignant, et la tendance s’accélère. Des cours individuels en technologie chimique et en analyse des gaz sont ajoutés (6). Le catalogue de 1904-1905 (7) fait référence au Département de chimie, comprenant la chimie du génie. Le catalogue de 1907-1908 (8) liste le Département de chimie et la chimie du génie. En 1909, le diplôme de génie chimique a été offert (9). En 1913, le programme de génie chimique a été proposé (9, 10), et en 1915, le premier diplôme de BS en génie chimique a été décerné (11). Enfin, en 1925, le Département de génie chimique a émergé (11). Case a été accrédité par l’AIChE la même année (9).
L’adoption hésitante des termes « génie chimique », comme illustré pour Case, était également courante dans de nombreuses autres écoles. L’Université de l’Illinois, Urbana, est un deuxième exemple pratique. Samuel W. Parr rejoint le corps enseignant en 1885 en tant que professeur de sciences naturelles. Il est devenu responsable de la chimie industrielle (12) en 1891. En 1894, un programme de chimie appliquée avec génie a été proposé (13). En 1895, le diplôme de BS en chimie avec génie a été offert (13). En 1901, un programme de quatre ans intitulé Génie chimique a été proposé (14), apparemment le sixième programme du genre dans le pays. En 1903, Clarence Bean a reçu le premier diplôme de BS en génie chimique à l’Illinois (13). L’unité dans laquelle tout cela s’est produit s’appelait le Département de chimie (1891-1894) ; Département de chimie industrielle (1894-1904) ; Division de chimie industrielle dans le Département de chimie (1904-1926) ; Division de génie chimique dans le Département de chimie (1926-1953) ; Division de génie chimique dans le Département de chimie et de génie chimique (1953-1970) ; et enfin le Département de génie chimique dans l’École des sciences chimiques (1970 à nos jours).
De nombreux autres exemples montrent que les termes « génie chimique » ont été adoptés lentement dans les universités, en particulier au sein des départements plus anciens. Dans n’importe quelle école, les dates sont très différentes pour la première utilisation de ces termes pour un cours individuel, un programme, un diplôme, le nom d’un département et le titre d’un professeur. Souvent, plusieurs décennies s’écoulent dans une école avant que tous ces éléments portent simultanément l’étiquette de génie chimique. Cela signifie que toute tentative de dresser une liste des écoles dans l’ordre où elles ont d’abord enseigné le génie chimique devient sans signification à moins qu’une définition précise ne soit donnée de la base utilisée.
Le Massachusetts Institute of Technology est bien documenté comme étant la première école américaine à offrir un programme de quatre ans intitulé Génie chimique. Le catalogue (15) pour 1888-1889 décrit un diplôme de BS en génie chimique et répertorie un cours X, Génie chimique. Le terme « cours » signifiait ici un programme. Désormais, dans ce chapitre, le terme « cours » sera utilisé dans le contexte moderne d’une offre individuelle d’un semestre, telle qu’un cours de 3 heures. Également dans ce chapitre, « programme » signifie un ensemble organisé de cours, pour un groupe d’années, menant à un diplôme spécifique. Le programme de génie chimique était le dixième programme offert au M.I.T. et portait donc l’étiquette Cours X. Il était décrit dans le catalogue comme « une formation générale en génie mécanique – et une étude des applications de la chimie aux arts, en particulier à ces problèmes d’ingénierie qui ‘se rapportent à l’utilisation et à la fabrication de produits chimiques » (15). Le programme comprenait trois cours intitulés Chimie industrielle et deux intitulés Chimie appliquée. Aucun n’était étiqueté Génie chimique. Il n’y avait pas de professeurs de génie chimique. Lewis M. Norton était professeur de chimie organique et industrielle. Il enseignait tous les cours de chimie industrielle, assisté de J. W. Smith, instructeur en chimie textile, et A. J. Conner, assistant en chimie industrielle. Ce département à trois personnes (ou à une ou deux personnes, selon la définition) était appelé le Département de génie chimique. Clairement, ses racines étaient en chimie. Selon Weber (16), il fonctionnait comme une division de chimie appliquée dans le Département de chimie jusqu’en 1920. À ce moment-là, la séparation du Département de chimie fut achevée, et W. K. Lewis fut nommé responsable.
L’Université de Pennsylvanie en 1892 semble être la deuxième école à avoir un programme de quatre ans intitulé Génie chimique (17). Il se composait principalement de génie mécanique (17 cours) et de chimie (six cours). Le programme n’avait pas de professeur de génie chimique. Aucun cours n’était étiqueté Génie chimique, mais deux des cours de chimie étaient intitulés Chimie appliquée et Méthode choisie de chimie industrielle. Le diplôme offert était un BS en génie chimique. Ce programme opérait au sein du Département de chimie jusqu’en 1951, date à laquelle un Département de génie chimique indépendant a été créé avec Melvin Molstad comme président.
L’Université Tulane a été la première école dans le Sud et apparemment la troisième aux États-Unis à proposer un programme de quatre ans intitulé Génie chimique. C’était en 1894 (18). Le diplôme portait l’intitulé BE en génie chimique, et le premier récipiendaire était B. P. Caldwell en 1895 (19). Aucun cours n’était étiqueté Génie chimique, et aucun professeur de génie chimique n’était désigné. Les cours les plus pertinents, trois en chimie industrielle, étaient enseignés par John Ordway. En 1893, cet homme portait trois titres : (1) Professeur de chimie appliquée et directeur de l’école de formation manuelle ; (2) Professeur de chimie industrielle ; et (3) Professeur de chimie industrielle et professeur intérimaire de génie civil. Les cours de chimie industrielle et de chimie étaient enseignés dans le même bâtiment. Ainsi, à Tulane, le génie chimique semble avoir ses racines dans la chimie.
En 1898, deux universités devinrent apparemment les quatrième et cinquième à proposer des programmes de quatre ans intitulés Génie chimique. Le programme de l’Université du Michigan (20) était un agencement de cours existants et ne comprenait aucun cours étiqueté Génie chimique. Il comportait des cours appelés Technologie chimique, Technologie organique et Analyse technique des gaz, enseignés par le professeur E. D. Campbell et M. Alfred H. White. Le premier BS en génie chimique au Michigan a été décerné à Wareham S. Baldwin en 1901 (21). À Tufts, le programme de quatre ans en génie chimique a également débuté en 1898 (22). Le premier étudiant à s’y inscrire l’a fait en 1900, et le premier BS en génie chimique a été décerné en 1905.
Tous les programmes de génie chimique mentionnés ci-dessus avaient leurs racines dans les départements de chimie. Le tableau I répertorie 55 écoles qui ont eu des débuts similaires. Les listes dans les tableaux de ce chapitre sont incomplètes. L’auteur de ce chapitre a envoyé des lettres à 137 chefs de département, leur demandant des informations sur les débuts de leurs départements. Tous les numéros de Chemical Engineering Education ont été examinés. Une recherche bibliographique complémentaire a été effectuée, suivie d’une correspondance avec des bibliothécaires de 16 universités. Par tous ces moyens, des informations ont été obtenues pour 85 écoles. Des conflits occasionnels ont été notés entre les déclarations officielles des catalogues et les déclarations indépendantes d’ordre anecdotique. Pour cet article, les catalogues officiels sont considérés comme corrects.
Les charges d’enseignement à l’époque étaient prodigieuses selon les normes actuelles. Prenons l’exemple de l’Université de l’Arkansas, qui a lancé un programme de quatre ans en génie chimique en 1902 (23). Le catalogue de 1903-1904 répertorie les offres de cours de premier cycle et de cycles supérieurs en génie chimique (24). Ce programme était rattaché au département de chimie, qui comptait en 1901 deux professeurs et déjà un ensemble de 14 cours (25). Des équipes réduites et des charges d’enseignement importantes étaient la norme partout. Le corps professoral identifiable en tant qu’ingénieurs chimistes ne comptait qu’une personne à Case en 1884 ; à Tulane en 1894, c’était un ; à l’Illinois en 1894, c’était un ; et au M.I.T. en 1888, c’était de un à trois (selon la définition). Aussi tard qu’en 1909 au Michigan, il se composait de deux professeurs de génie chimique et d’un instructeur en génie métallurgique. Lorsque le programme a été lancé au Michigan 11 ans plus tôt, il a été administré par des chimistes déjà en place, et le doyen a rapporté aux régents : « Aucun ajout au corps enseignant ne sera nécessaire pour ce cours. On ne s’attend pas à ce que le nombre d’étudiants soit important » (21).
Dès le début, presque chaque département de génie chimique s’est impliqué dans une recherche active. Dans certaines écoles, une structure de recherche hautement organisée a été mise en place. La première station d’expérimentation en génie aux États-Unis a été créée à l’Illinois en 1903. Une autre a été établie en 1904 à l’Université d’État de l’Iowa. Beaucoup d’autres ont suivi rapidement. À l’Université de Pittsburgh, l’établissement de recherche est devenu si important et bien financé que l’administration le considérait comme une menace pour les activités éducatives régulières. En 1927, ces activités de recherche ont été séparées de l’université et ont été constituées en tant qu’Institut Mellon de recherche industrielle (26). Plus tard, l’Institut Mellon a fusionné avec l’Institut de technologie Carnegie à quelques pâtés de maisons de là pour former l’actuelle Université Carnegie-Mellon. Ce transfert d’un grand groupe de recherche d’une université à une autre semble être unique.
Origines hors de la chimie Le tableau II répertorie 13 universités où le génie chimique provient d’un département autre que les départements de chimie existants.
Origines en génie mécanique. L’Université du Colorado a développé le génie chimique à partir du génie mécanique. En 1903-1904, l’École des sciences appliquées proposait un programme de quatre ans en génie mécanique et chimique (27). Les étudiants avaient un programme commun pour les deux premières années, après quoi ils choisissaient soit une option de génie mécanique pur, soit une option de génie chimique. L’option de génie chimique comprenait dix cours de génie mécanique, un de physique, deux de génie électrique et dix de chimie. Les dix cours de chimie étaient les seuls éléments différents de l’option de génie mécanique. Tous étaient enseignés par un professeur en chimie. Le chef du génie mécanique était responsable des deux options jusqu’en 1936. Ensuite, un département indépendant de génie chimique a été créé, dirigé par Henry Coles (28).
Presque deux décennies après le début du génie mécanique au Colorado, une origine similaire a eu lieu à l’Université de Rochester (29). L’union du génie chimique avec le génie mécanique (combiné pendant un certain temps également avec la chimie et plus tard le génie électrique) a continué jusqu’en 1959. Aujourd’hui, à Rochester, le département de génie chimique est indépendant.
Origines en génie pétrolier. Le génie pétrolier a donné naissance au génie chimique dans plusieurs universités. W. L. Nelson a lancé le génie pétrolier à l’Université de Tulsa en 1928. Six ans plus tard, cela s’est scindé en deux parties : production pétrolière et raffinage pétrolier. Le programme de raffinage pétrolier a été rebaptisé Division de l’ingénierie des ressources, ingénierie pétrolière et génie chimique en 1972. Un président du génie chimique existe là-bas depuis 1954 (30). À l’Université du Wyoming, un programme en génie pétrolier a été lancé en 1960. En 1965, cela s’est scindé en deux programmes, l’un en génie pétrolier et l’autre en génie chimique. Actuellement, D. L. Stinson est à la tête des deux programmes (31).
Origines en céramique et en génie minier. Le génie chimique à l’Iowa State University a commencé en 1913 dans un département de génie minier, céramique et génie chimique. Une réorganisation en 1916 a déplacé le génie chimique vers le département de chimie. En 1919, la chimie et le génie chimique se sont séparés en deux départements indépendants. En 1928, le génie chimique s’est joint à un nouveau département de génie chimique et minier. En 1961, le génie chimique est devenu indépendant à nouveau. En 1973, il a été regroupé dans un département de génie chimique et nucléaire. En 1976, le génie chimique est devenu à nouveau indépendant. Au cours de cette période intéressante de 66 ans, le génie chimique a connu quatre « mariages » et quatre « divorces » (32, 33).
Origines dans l’ingénierie sucrière. Le génie chimique a évolué à partir de l’ingénierie sucrière à l’Université d’État de Louisiane (34). En 1897, l’Audubon Sugar School a été créée. Le contenu des programmes de chimie sucrière et d’ingénierie sucrière a progressivement évolué vers le génie chimique, et en 1905, un diplôme en génie chimique a été décerné (35). Au cours des premières années, le statut du génie chimique concernant son administration semblait incertain, mais en 1919, le programme s’est allié à la chimie. En 1925, le génie chimique est devenu indépendant au sein du College of Pure and Applied Science. En 1938, il a été transféré au College of Engineering.
La chimie sucrière a été établie en tant que programme d’études la même année, en 1897, à Tulane, à seulement 80 miles de L.S.U. Cependant, ce programme n’a pas connu de succès et a finalement été abandonné (36).
Origines dans l’ingénierie papetière. Le génie chimique a trouvé ses origines dans l’ingénierie papetière à l’Université de Lowell (37). En 1950, un programme en ingénierie papetière a été mis en place à Lowell Technological Institute, et plusieurs ingénieurs chimistes faisaient partie de son corps professoral. Le programme était fortement basé sur des cours et une approche de génie chimique. En 1963, des diplômes en génie chimique ont été décernés en tant que diplômes associés à l’ingénierie papetière. En 1975, l’Université de Lowell a été formée par une fusion de l’Institut avec le Lowell State College. Dans le cadre de la réorganisation, le département actuel de génie chimique a émergé.
Origines dans le génie électrique. L’Université du Wisconsin est spéciale en ce sens que son département de génie chimique est le seul à avoir ses origines dans le génie électrique. Le College of Engineering a été créé en 1889 avec le génie électrique comme l’une des premières offres. En 1895, un laboratoire d’électrochimie appliquée dans le département de génie électrique a été créé. Il s’est détaché en tant que département d’électrochimie appliquée en 1898 et a ainsi continué jusqu’en 1905. Le catalogue (38) de 1904-1905 utilise pour la première fois les termes « génie chimique ». Le catalogue indique qu’un nouveau bâtiment est en construction pour la chimie et que « lorsque cela sera terminé, l’ancien laboratoire sera probablement utilisé pour le génie chimique » (38). Ce catalogue liste un diplôme de BS en électrochimie appliquée, montre un programme complet de quatre ans avec cette étiquette et liste les noms des trois étudiants de dernière année et de deux membres du corps professoral du département d’électrochimie appliquée. Ce petit groupe de professeurs et d’étudiants était l’origine du génie chimique au Wisconsin. Leur revendication sur le bâtiment de chimie vacant suscitait certaines préoccupations. Hougen (39) donne un récit intéressant de la manière dont, en 1905, ils ont occupé le territoire la nuit et ont érigé une grande enseigne « Génie chimique » sur le bâtiment. En 1905, un programme de quatre ans en génie chimique a été établi, et en 1907, le premier BS en génie chimique a été décerné. Le leader de ces actions était C. F. Burgess (de Burgess Battery), qui est ainsi passé de professeur agrégé de génie électrique à président du département de génie chimique.
Avant 1905, le Wisconsin n’avait rien de libellé chimie appliquée ou chimie industrielle. Le département de chimie proposait des cours individuels en électrochimie (en plus des offres de génie électrique dans ce domaine) et en chimie de la fabrication de gaz. En essence, le moment était propice pour le génie chimique, et le vide a été comblé par Burgess du département de génie électrique.
Origines dans le génie général. Le génie chimique a pris naissance dans le génie général à l’Université de Toledo (40). Le College of Engineering y a été créé en 1931, et un programme en génie général a été mis en place en tant que programme interdisciplinaire. En 1946, un ingénieur chimiste a été ajouté au corps professoral, et une option de quatre ans en génie chimique a été proposée. Le corps professoral était passé à trois en 1963. En 1967, l’école est devenue une université d’État.
Origines dans le génie énergétique. L’Université de l’Illinois à Chicago Circle a été créée en 1965. L’un des quatre départements de génie était (et est toujours) le département de génie énergétique. Une option dans le département est l’option de génie chimique. Le diplôme est en génie énergétique. Une autre école, l’Université du Wisconsin à Milwaukee, a créé un département d’énergétique en 1965. Le génie chimique fait partie de ce département. Le corps professoral actuel comprend deux ingénieurs chimistes, six ingénieurs mécaniciens et un ingénieur civil.
Origines dans l’extension de l’YMCA. L’origine la plus inattendue pour l’enseignement du génie chimique est celle de la Cleveland State University (41). Des cours du soir gratuits sur divers sujets étaient proposés par l’YMCA à Cleveland en 1881. Le projet a grandi, et l’ingénierie (comme le dessin mécanique) a été ajoutée en 1890. En 1909, ce programme est devenu The Technical School. Plus tard, il a été rebaptisé l’YMCA School of Technology. Le bulletin de 1926 contient un grand titre appelé Génie chimique, sous lequel sont répertoriés 29 cours. Vingt-cinq de ces cours sont en chimie, métallurgie, minéralogie et métallographie (42). Deux cours sont intitulés Chimie industrielle, et deux sont intitulés Génie chimique. Plus tard, cette école est devenue le Fenn College qui est aujourd’hui la Cleveland State University.
Indépendant dès le départ o ……-I Le tableau III répertorie 17 départements universitaires de génie chimique qui ont émergé soudainement et sans liens clairs avec les départements précédents. Cela se produisait généralement lorsqu’un administrateur percevait le besoin d’un programme d’ingénierie chimique et entreprenait de le mettre en place. La State University de New York à Buffalo en est un bon exemple (43, 44). Clifford Furnas, un ingénieur chimiste bien connu, était le chancelier de Buffalo à l’époque. Pendant l’année universitaire 1960-1961, il a discuté avec E. A. Trabant, doyen du génie, de l’absence de génie chimique à Buffalo. Un consultant local, Joseph Bergantz, a été embauché pour examiner la situation. Bergantz a signalé qu’il y avait une demande significative d’éducation locale en génie chimique. Le doyen et le chancelier étaient d’accord et ont offert à Bergantz le poste de premier chef du département de génie chimique. En juin 1961, Bergantz a été nommé chef, un espace lui a été attribué, et un budget a été alloué pour le nouveau département. Bergantz a embauché deux autres membres du corps professoral en 1961 et trois autres en 1962. L’année dernière, la SUNY Buffalo avait une faculté de dix personnes et a décerné 42 diplômes de BS.
Pères fondateurs des départements de génie chimique. Pour tout département de génie chimique qui a commencé comme une unité indépendante en une seule étape, il est plutôt facile de dire qui est le fondateur. Trois exemples sont Joseph Bergantz à Buffalo, A. P. Colburn à Delaware et J. R. Crump à Houston.
Pour les départements qui ont pris naissance lentement par évolution, le « père » peut être difficile à identifier. Par exemple, Hougen (3) dit que W. H. Walker est le père du génie chimique au M.I.T. Une annonce imprimée du Warren K. Lewis Lectureship in Chemical Engineering de 1978 à M.I.T. indique que W. K. Lewis est le père du génie chimique au M.I.T. Cependant, W. K. Lewis attribue le mérite à L. M. Norton comme le père au M.I.T. (45). Il y a un meilleur accord sur Samuel W. Parr comme le père du génie chimique à l’Université de l’Illinois, Henry K. Benson à l’Université de Washington, Charles F. Burgess à Wisconsin, Arthur J. Hartsook à Rice et Samuel T. Sadtler à l’Université de Pennsylvanie. Sadtler est devenu le premier président de l’AIChE. Beaucoup d’autres éducateurs talentueux méritent sans aucun doute du crédit pour des services importants au début de l’éducation en génie chimique dans ce pays. Malheureusement, beaucoup ne seront jamais identifiés car ils ont vécu il y a environ trois générations. Ce qui existe peu en termes de documentation peut être enfoui dans les archives universitaires.
Conclusions
Les mots « génie chimique » ont été adoptés lentement et avec beaucoup de prudence par les éducateurs aux États-Unis à partir de 1888. Environ 65% des départements de génie chimique dans ce pays ont leurs origines dans des départements de chimie. Environ 20% ont été établis soudainement en tant qu’unités indépendantes sans lien préalable avec un département. Environ 15% ont des origines peu communes telles que des départements de génie mécanique, électrique, pétrolier, céramique, sucrier, papetier ou général.
Literature C itea
- Grayson, L. P. « Brief History of Engineering Education in the United
States, » En. Educ. 1977, 68(3), 246-264. - Kobe, K. A. ‘Inorganic Process Industries »; Macmillan: New York, 1948.
- Hougen, o. A. « Seven Decades of Chemical Engineering, » Chern. Eng. Prog.
1977, 73(1), 89-104. - « Catalogue of the Case School of Applied Science »; Cleveland, Ohio, 1882-
83, p. 9. - « Catalogue of the Case School of Applied Science »; Cleveland, Ohio, 1883-
84, p. 11. . - « Catalogue of the Case School of Applied Science »; Cleveland, Ohio, 1884-
85, p. 16. - « Catalogue of the Case School of Applied Science »; Cleveland, Ohio, 1904-
05. - « Catalogue of the Case School of Applied Science »; Cleveland, Ohio, 1907-
08. - Angus, John. C., « ChE Department: Case, » Chern. Eng. Educ. 1977, 11 (1),
4-9. - Anon. « Albert W. Smith: Educator, Chemist, and Engineer »; Case Institute
of Technology, Case Western Reserve University: Cleveland, Ohio, 1976;
39 pp. - Angus, John C. « Chemical Engineering at Tech, » In « Case Alummus »; Case
Western Reserve University: Cleveland, Ohio, February 1976; p. 18-20. - « The Study of Chemistry at the University of Illinois »; University of Illinois:
Urbana, 1907; 31 pp. - « Circular of Information on the Department of Chemistry, » Univ. Ill. Bull.
Feb. 21, 1916, 13(25), lOB pp. - « University of Illinois Department of Chemistry 1941-1951 »; University of
Illinois: Urbana, 151 pp. - « Twenty Fourth Annual Catalog of the Officers and Students with a State-
ment of the Courses and Instructions and a List of the Alumni 1888-1889″;
Massachusetts Inst. of Tech.: Cambridge, MA. - Weber, Harold « History of Chemical Engineering at M.LT., » unpublished
data, 1977. - « Catalogu.e and Announcements, 1892-93 »; University of Pennsylvania: Phi-
ladelphia, 1893; p. 134. - « Tulane University of Louisiana, Catalogue 1893-94, Announcement for
1894-95, » New Orleans, 1894; 155 pp. - « The Tulane Universi of Louisiana, College of Engineering, Register of
Graduate 1889-1921′; New Orleans. - « Calendar of the University of Michigan 1898-99 »; Ann Arbor; 1899.
- White, A. H.; Upthesrove, C. « The Department of Chemical and Metal-
lurgical Engineering ; a publication to celebrate a century of engineering at
the University of Michigan, Ann Arbor: 1953; p. 1190-1200. - Gumham, C. F. « A Brief History of Chemical Engineering at Tufts College »;
section of accreditation application, 1951. - « The Chemical Engineering Lecture Series, » Sept. 15, 1977 to Nov. 17, 1977,
Department of Chemical Engineering, University of Arkansas: Fayetteville. - « Catalogue of the University of Arkansas, 1903-1904, » 31st Edition; Fayette-
ville, Arkansas. - « Catalogue of the University of Arkansas, 1901-1902, » 29th Edition; Fayet-
teville, Arkansas. - « University of Pittsburgh, School of Engineering, Past, Present, Future »; a
publication for the dedication of Michael Bendedum Hall, March 18, 1971. - « Catalog of the University of Colorado 1903-04 »; Boulder, Colorado, p.
134-161. - Barrick, P. « Brief History of Chemical Engineering at the University of
Colorado »; unpublished data, 1978. - Bartlett, J. W.; Miller, S. A.; Perry, R. H.; Wiehe, L A. « Chemical Engi-
neering at Rochester-I966″; introduction to a report of a Committee on
Self-Assessment of a Department. - Thompson, R. E. « A Brief History of Chemical Engineering at the University
of Tulsa »; unpublished data, 1978. - Stinson, D. L., personal communication, Sept. 26, 1978.
- Arnold, L. K. « History of the Department of Chemical Engineering at Iowa
State University »; Iowa State University: Ames, 1970. - Larson, M.; Seagrave, R. « ChE Department: Iowa State, » Chern. Eng. Educ.
1976, 10(3), 108-111. - Anon. « LSU-A Center of Excellence, » Eng. Educ. 1979, 69(5), 380-2.
- Harrison, D. P., personal communication, Oct. 3, 1978.
- Dyer, J. P. ‘tulane, The Biography of a University 1834-1965″; Harper and
Row: New York, 1966; p. 78. - Keeney, N. H., Jr., personal communication, Oct. 3, 1978.
- « University of Wisconsin Catalogue 1904-1905 »; Madison, Wisconsin, 1905.
- Hougen, O. A. « Beginning of the Chemical Engineering Department »; Uni-
versity of Wisconsin: Madison, unpublished data, August 1976. - « Focus on Engineering »; College of Engineering, The University of Toledo:
Toledo, Fall 1972. - Coulman, G. A. « Department of Chemical Engineering, Fenn College of
Engineering, Cleveland State University »; unpublished data, 1978. - ‘the Cleveland YMCA School of Technology Bulletin, Announcement of
Courses »; YMCA: Cleveland, Ohio, July 1926; Vol 1, Number 7, p. 88-89. - Brutvan, D. R., personal communication, Sept. 18, 1978.
- Vermeychuk, J. G.; Bergantz, J. A. « SUNY at Buffalo, » Chern. Eng. Educ.
1973, 7(3), 112-116. - Lewis, W. K. « Evolution of the Unit Operations, » Chern. Eng. Progr. Symp.
Ser. 1959, 55 26, 1-8.